samedi, 08 juillet 2023
Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Vers un monde multipolaire: les défis à relever
Foad Izadi
Source: https://katehon.com/ru/article/dvizhenie-k-mnogopolyarnomu-miru-vyzovy-kotorye-neobhodimo-preodolet
Texte d'un discours prononcé lors de la Conférence mondiale sur la multipolarité, le 29 avril 2023.
Note de la rédaction: Le texte du politologue iranien Foad Izadi est intéressant à plus d'un titre, non seulement parce que nous avons ici accès à son contenu, mais parce qu'il nous permet de saisir la vision iranienne des relations internationales, à une époque où l'OTAN nous induit à considérer l'Iran comme un ennemi absolu alors qu'aucun pays d'Europe centrale et occidentale n'a eu, au cours de l'histoire, de conflit avec la Perse. Pour rétablir la bonne santé économique de l'Europe, les relations économiques avec l'Iran devront être rétablies, même si le pays opte pour des rapports privilégiés avec les structures de coopération eurasiennes, pilotées par la Russie et la Chine, voire l'Inde. L'Europe n'a aucun intérêt, à long terme, à obéir aux injonctions de Washington et à pérenniser le bellicisme de l'Alliance atlantique.
L'évolution vers un monde multipolaire, où le pouvoir est partagé entre plusieurs grands acteurs mondiaux, peut s'accompagner de divers obstacles. Voici quelques défis courants qui peuvent se présenter :
1. Dominance des puissances existantes : les puissances mondiales établies, telles que les États-Unis, résisteront à l'idée de renoncer à leur position dominante et à leur influence dans le système international. Elles considéreront un monde multipolaire comme une menace pour leurs intérêts et chercheront à maintenir leur statut hégémonique.
2. Concurrence et conflits : comme le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles, la concurrence et les conflits d'intérêts peuvent s'intensifier. Les rivalités entre les nouvelles puissances et les puissances existantes peuvent s'intensifier, entraînant des tensions géopolitiques, des guerres par procuration, voire des affrontements purs et simples.
3. absence de gouvernance mondiale : la transition vers un monde multipolaire nécessite des mécanismes de gouvernance mondiale efficaces. Cependant, il peut y avoir un manque de consensus sur les structures, les processus de prise de décision et les règles de la gouvernance mondiale. Cela peut entraver la coopération et la coordination entre les pays, ce qui rend difficile la résolution collective des problèmes mondiaux.
4. Conflits régionaux non résolus : de nombreux conflits régionaux en cours peuvent compliquer l'évolution vers un monde multipolaire. Les différends et les conflits non résolus entre les pays peuvent entraver l'établissement de relations stables et coopératives nécessaires à l'épanouissement d'un système multipolaire.
5. interdépendance économique : les interdépendances économiques existantes, telles que les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement, peuvent être perturbées par la transition vers un monde multipolaire. La concurrence économique et le protectionnisme entre les grandes puissances peuvent créer de l'instabilité et entraver les progrès vers la multipolarité.
6. Différences d'idéologie et de valeurs : les pays d'un monde multipolaire sont susceptibles d'avoir des idéologies, des valeurs et des systèmes politiques différents. Ces différences peuvent entraîner des conflits d'intérêts et entraver la coopération sur les questions mondiales, rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente.
7. Dilemmes sécuritaires : dans un monde multipolaire, les pays peuvent être confrontés à des dilemmes sécuritaires, où les mesures prises par un État pour renforcer sa sécurité peuvent être perçues comme une menace par d'autres États. Cela peut conduire à une course aux armements, à la méfiance et à l'instabilité.
8. Manque de confiance et de coopération : l'instauration de relations de confiance et de coopération entre les pays est cruciale pour le succès d'un monde multipolaire. Toutefois, les rivalités historiques, les suspicions profondément ancrées et les intérêts nationaux divergents peuvent entraver le développement de la confiance et les efforts de coopération.
9. Asymétrie de puissance : la transition vers un monde multipolaire peut être difficile s'il existe une importante asymétrie de puissance entre les pays. Les États plus faibles peuvent se sentir marginalisés ou menacés par les puissances dominantes, ce qui entraîne une résistance ou des tentatives d'alliance contre elles.

Pour surmonter ces obstacles, il faut de la diplomatie, du dialogue, des institutions multilatérales et une vision commune de la gouvernance mondiale. Cela nécessite un engagement en faveur du respect mutuel, de la coopération et du compromis entre les pays afin d'assurer une transition harmonieuse et pacifique vers un monde multipolaire.
Comme indiqué précédemment, les États-Unis résisteront farouchement à l'abandon de leur position dominante dans un monde multipolaire sur la base de schémas historiques et de considérations géopolitiques. Voici quelques stratégies que les États-Unis peuvent utiliser pour maintenir leur position :
1. la puissance économique : Les États-Unis se sont traditionnellement appuyés sur leur économie forte et sur l'innovation technologique pour maintenir leur influence mondiale. Ils peuvent continuer à donner la priorité à la croissance économique, à investir dans la recherche et le développement et à promouvoir l'innovation pour rester compétitifs.
2. Alliances diplomatiques : les États-Unis peuvent chercher à renforcer leurs alliances et leurs partenariats avec des pays aux vues similaires afin de maintenir une influence collective dans les affaires internationales. Le renforcement des alliances avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres démocraties peut constituer un front uni face aux défis posés à la domination américaine.
3. Capacités militaires : les États-Unis ont toujours maintenu une forte présence militaire dans le monde. Ils peuvent continuer à investir dans des technologies militaires de pointe, à maintenir une présence militaire mondiale et à assurer leur préparation militaire afin de projeter leur force et de dissuader leurs adversaires potentiels.
4. domination technologique : l'accent mis sur les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'exploration spatiale et la biotechnologie peut aider les États-Unis à conserver un avantage concurrentiel et à accroître leur influence mondiale dans un monde en mutation rapide.
5. Soft power et influence culturelle : les États-Unis s'appuient depuis longtemps sur leur puissance douce (soft power), y compris les exportations culturelles, pour exercer une influence au niveau mondial. Un accent soutenu sur la propagande et la diplomatie publique, ainsi que sur la construction de perceptions internationales positives, peut contribuer à maintenir leur domination.
6. Adaptabilité et engagement multilatéral : conscients de l'évolution de la dynamique mondiale, les États-Unis pourraient être amenés à adapter leur approche et à s'engager auprès des puissances émergentes et des régions en plein essor. Cela pourrait inclure une participation active aux institutions internationales, aux négociations et aux structures multilatérales afin de façonner les normes et les règles mondiales.
7. politiques économiques et commerciales : les États-Unis peuvent mener des politiques économiques et commerciales stratégiques afin de protéger l'industrie nationale et d'aborder la question des droits de propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Ces politiques peuvent viser à préserver les avantages économiques et à empêcher l'érosion de la position dominante des États-Unis.

Il est important de noter que le paysage mondial est complexe et que les États-Unis sont susceptibles d'utiliser une combinaison de ces politiques, en s'adaptant à l'évolution des circonstances.
Pour contrer l'hégémonie américaine vers un monde multipolaire, les ONG et les intellectuels peuvent jouer un rôle important. Voici quelques moyens par lesquels ils peuvent affronter et influencer la dynamique du pouvoir mondial:
1. recherche et sensibilisation : les ONG et les intellectuels peuvent mener des recherches et fournir des analyses fondées sur des preuves afin d'exposer les implications et les limites de l'hégémonie américaine. Ils peuvent attirer l'attention sur des questions telles que les inégalités, les violations des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement et l'exploitation économique résultant des structures de pouvoir dominantes. En sensibilisant l'opinion et en plaidant pour le changement, ils peuvent favoriser un discours critique sur la nécessité d'un ordre mondial plus juste et plus inclusif.
2. Mobilisation de la société civile : les ONG peuvent mobiliser la société civile et les mouvements de base pour promouvoir une vision alternative de la gouvernance mondiale. En organisant des campagnes, des manifestations et des initiatives de plaidoyer, elles peuvent amplifier les voix des communautés marginalisées, remettre en question les récits dominants et exiger une plus grande responsabilité de la part des acteurs puissants, y compris les États-Unis.
3. Mise en réseau et création de coalitions : les ONG et les intellectuels peuvent collaborer au-delà des frontières pour créer des réseaux et des coalitions qui promeuvent des perspectives alternatives et remettent en question les structures de pouvoir hégémoniques des États-Unis. En développant la coopération entre les organisations et les intellectuels de différentes régions, ils peuvent accroître leur influence et présenter un front uni contre la domination.
4. Promouvoir le dialogue et l'échange : les intellectuels peuvent promouvoir le dialogue et l'échange entre différentes cultures, sociétés et systèmes de connaissance. En encourageant le débat et en créant des plateformes pour des voix diverses, ils peuvent remettre en question les récits centrés sur l'Occident et promouvoir une compréhension plus inclusive des questions mondiales. Cela peut contribuer à un discours plus équilibré et multipolaire.
5. Plaidoyer politique : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager auprès des décideurs politiques, des institutions internationales et des forums multilatéraux pour influencer les politiques et promouvoir des approches alternatives. En apportant leur expertise, en proposant des conseils politiques et en participant aux processus décisionnels, ils peuvent contribuer à façonner un ordre mondial plus juste et multipolaire.
6. Interaction avec les puissances en développement : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager activement auprès des puissances en développement et des régions émergentes pour promouvoir le dialogue et la coopération. En facilitant la coopération entre ces acteurs et en partageant les connaissances et les meilleures pratiques, ils peuvent contribuer à la diversification du pouvoir et remettre en question la domination des puissances occidentales.
7. Promouvoir la solidarité mondiale : les ONG et les intellectuels peuvent plaider en faveur de la solidarité et de la coopération mondiales, en soulignant l'interconnexion des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les conflits. En soulignant les intérêts communs et l'interdépendance des pays, ils peuvent promouvoir des efforts collectifs pour résoudre ces problèmes, réduisant ainsi l'influence d'une puissance hégémonique.

Il est important de noter que la lutte contre l'hégémonie des États-Unis et la promotion de la multipolarité nécessitent des efforts soutenus, une coopération et une perspective à long terme. Les ONG et les intellectuels peuvent apporter une contribution significative en fournissant une analyse critique, en mobilisant la société civile et en défendant une vision alternative de la gouvernance mondiale. Le plus important est de fournir des principes pour une idéologie qui cherche à résister à l'hégémonie des États-Unis. Voici quelques principes qui peuvent être liés à la remise en cause de l'hégémonie américaine :
1. Multipolarité : l'idéologie doit promouvoir l'idée d'un ordre mondial multipolaire dans lequel le pouvoir est réparti plus équitablement entre de multiples acteurs. Elle met l'accent sur la nécessité de remettre en cause la domination américaine et cherche à créer un système mondial plus équilibré et plus inclusif.
2. Souveraineté et autodétermination : l'idéologie reconnaît l'importance de la souveraineté nationale et le droit des nations à déterminer leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux sans ingérence extérieure. Elle s'oppose aux interventions, aux occupations militaires et à l'imposition de positions par les puissances dominantes qui sapent la souveraineté et l'autodétermination des nations.
3. Égalité et justice : l'idéologie souligne l'importance de l'égalité et de la justice dans les relations internationales. Elle remet en question les dynamiques de pouvoir inégales qui perpétuent les injustices mondiales telles que l'exploitation économique, l'inégalité sociale et les violations des droits de l'homme. Elle promeut des systèmes équitables et justes qui donnent la priorité au bien-être et à la dignité de tous les individus.
4. Solidarité et coopération : l'idéologie promeut la solidarité et la coopération entre les pays et les peuples. Elle recherche des alliances et des partenariats fondés sur des intérêts communs et le respect mutuel, encourageant la coopération pour trouver des solutions collectives aux problèmes mondiaux. Elle souligne l'importance du dialogue, de la diplomatie et du multilatéralisme dans la résolution des conflits et la réalisation d'objectifs communs.
5. Diversité culturelle et respect : l'idéologie reconnaît et valorise la diversité culturelle, en promouvant le respect des différentes cultures, traditions et perspectives. Elle s'oppose à l'homogénéisation culturelle. Elle soutient au contraire la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la compréhension et du dialogue interculturels.
6. Développement durable et gestion de l'environnement : l'idéologie met l'accent sur le développement durable et la gestion de l'environnement. Elle reconnaît la nécessité d'une gestion responsable des ressources, d'une action climatique et d'une durabilité environnementale. Elle remet en question les modèles économiques dominants qui privilégient le profit au détriment du bien-être de la planète et des générations futures.
7. Anti-impérialisme et anti-colonialisme : l'idéologie s'oppose à l'impérialisme et au colonialisme sous toutes leurs formes. Elle cherche à supprimer l'héritage historique du colonialisme, notamment l'exploitation économique, l'esclavage culturel et l'occupation territoriale. Elle soutient le droit à l'autodétermination des peuples colonisés et opprimés.
Ces principes ne sont pas exhaustifs et les idéologies et mouvements peuvent mettre l'accent sur des aspects différents. Il est également important de noter que la lutte contre l'hégémonie est une tâche complexe et que les principes et stratégies spécifiques peuvent varier en fonction du contexte et des objectifs de ceux qui contestent les structures de pouvoir dominantes.
17:34 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, relations internationales, politique internationale, foad izadi, iran, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, multipolarité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 juillet 2023
La fin de la démocratie et la montée de la pensée unique

La fin de la démocratie et la montée de la pensée unique
par Fabrizio Pezzani
Source : Fabrizio Pezzani & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-fine-della-democrazia-e-l-affermazione-del-pensiero-unico
L'État éthique est défini comme la forme institutionnalisée par les philosophes Hobbes et Hegel, dans laquelle l'institution étatique est la fin ultime vers laquelle les actions des individus doivent tendre pour la réalisation d'un bien universel.
Au fil du temps, cependant, le concept d'État éthique a pris une composition différente et en est venu à revêtir une dimension totalitaire dans laquelle le bien et le mal sont le résultat d'une imposition indépendante de ce qui devrait être le contrat de base entre l'État et le citoyen. Thomas Hobbes est considéré comme le père de la philosophie politique moderne avec sa prise de distance par rapport à la réflexion du monde classique sur la socialité et la politique de l'homme ; Hobbes inaugure la méthode contractualiste où les hommes trouveront des règles communes en sacrifiant une partie de leur liberté en échange de la protection et du respect des règles établies et se référeront à un seul grand représentant institutionnel qu'il définit comme le Léviathan ; en ce sens, Hobbes est défini comme le principal théoricien de l'État absolu ou de l'absolutisme dans lequel le souverain est considéré comme étant au-dessus de la loi universelle.

Après Hobbes, Hegel (illustration, ci-dessus), le philosophe idéaliste, définit l'État comme une substance éthique consciente d'elle-même ; l'État est la plus haute expression de l'éthique, une théorie qui contraste fortement avec le droit naturel et le contractualisme de la philosophie politique moderne. L'État, affirme Hegel, est la source de la liberté et de la norme éthique pour l'individu, il est la fin suprême et l'arbitre absolu du bien et du mal.
Cependant, l'État hégélien n'est pas un véritable État absolutiste et totalitaire, mais une unité organique vivante qui doit s'adapter aux circonstances évolutives naturelles de la société humaine. Pour Hegel, l'État éthique est le dernier moment de l'esprit subjectif et objectif, Hegel affirme que la liberté est et reste à tout moment la condition historique de la philosophie depuis la Grèce antique. Pour Hegel, une combinaison du bien commun et du bien personnel doit être trouvée dans l'État dans les limites dues à l'interaction des individus. La position de Hegel a ensuite été contrée par la critique de Karl Popper, qui a défini l'État éthique comme une société fermée, par opposition à l'État de droit propre à une société ouverte.
La théorie de l'État éthique a ensuite été reprise au 20ème siècle pour expliquer les États fasciste et communiste, qui étaient en fait des États totalitaires dans lesquels les libertés individuelles étaient réprimées selon les règles supérieures du "Léviathan" de Hobbes.
Les constitutions démocratiques successives qui ont régi l'État de droit jusqu'au siècle dernier fondent leur existence sur un équilibre fragile entre le droit et la liberté, entre l'intérêt général et la protection des minorités qui s'oppose à la pensée unique.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un état éthique oppressif car si la démocratie libérale reconnaît et défend la liberté d'expression avec comme limite la protection de la dignité humaine, l'extrémisme progressiste voudrait, au contraire, censurer tout ce qui n'est pas conforme à la pensée unique proposée par une élite qui semble viser une gouvernance mondiale et impose ses propres règles du bien et du mal qu'elle définit en fonction d'un changement culturel qui répond à des intérêts supérieurs. La culture de l'annulation (cancel culture) est la représentation la plus destructrice d'un monopole culturel qui efface la liberté d'expression et la véritable démocratie dont la survie est de plus en plus en jeu.
La culture de l'annulation sévit dans les universités où l'on interdit aux enseignants non alignés de s'exprimer, sur les places où l'on démolit des statues comme celle de Churchill déclaré fasciste et celles de Lincoln posé comme raciste et de Colomb également campé comme raciste, et même dans le journalisme où l'on impose des modes d'expression qui ne heurtent la sensibilité de personne, puis dans la politique qui chevauche la pensée unique et le débat sur le genre et l'économie verte deviennent les chevaux de bataille d'une pensée unique qui, dans la non-pensée de la société, devient un despotisme culturel sans freins. Entendre la secrétaire du DP faire l'éloge d'une société libre sans freins sur le genre, énumérer plus de dix acronymes auxquels elle pourrait ajouter les Indiens Apaches, les Mescaleros, les Hutus, les pygmées de Bornéo, sans faire de bruit mais en se montrant comme un exemple d'universalité, tout cela a du sens. C'est ainsi que l'on passe de l'Etat de droit à l'Etat éthique absolutiste où la censure, la démission, la répression et la mise au pilori sont la fin des non-alignés ; le phénomène est endémique dans les pays anglo-saxons sans repères éthiques et moraux, prompts à gommer le peu de culture qu'ils possèdent.
L'attaque contre la démocratie libérale s'appuie sur un populisme sécuritaire qui redécouvre l'État fort qui protège le citoyen de plus en plus seul, sans défense et désorienté, mais aussi plus facile à dominer et à gouverner, et donc l'État éthique entre de force dans la vie des particuliers, proposant des modèles absolus à suivre de manière ordonnée, perturbant le système social qui est à la merci de la pensée unique.
A côté du genre, mythe et bible, l'économie verte sert des intérêts supérieurs mais risque de ruiner la classe moyenne et de bouleverser la hiérarchie sociale où les super-riches imposent leur "culture de l'annulation", indifférents aux drames sociaux qu'ils sont en train de créer.
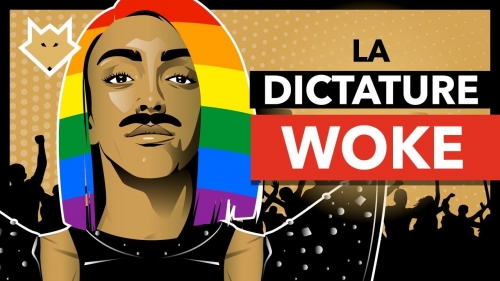
Le monde occidental est en train de creuser sa propre tombe avec une forme de nihilisme extrême et désespéré qui prône un mondialisme sans règles morales. Le mondialisme est une idéologie complexe qui oppose une apparente liberté débridée à un contrôle social invasif et parfois criminel et à un contrôle toujours plus profond et invasif des opinions exprimées par les acteurs sociaux. Nous vivons dans une liberté éphémère qui devient condamnable si nous allons au-delà des opinions autorisées et des idées politiquement correctes, nous vivons dans une illusion de liberté sans limites, hédoniste sans limites morales qui sont l'expression d'un minimum de décence mais gouvernée par une oligarchie étroite qui contrôle, guide et punit sans pitié les pauvres et innocents transgresseurs.
Nous sommes dans un monde éthéré, fait de jeux et d'illusions, mais en proie à une pensée unique qui s'est donné pour objectif de changer le monde ; pourtant, face à cette descente aux enfers, il ne semble pas y avoir une seule voix de protestation, mais un troupeau sans fin de lemmings qui se jettent dans le ravin.
18:35 Publié dans Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, démocratie, pensée unique, définition, philosophie, philosophie politique, théorie politique, état éthique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 juillet 2023
Une société sans confiance

Une société sans confiance
par Roberto Giacomelli
Source: https://centrostudiprimoarticolo.it/la-societa-senza-fiducia/
Le culte de la Fides
À la base de la vie communautaire, il y a des valeurs incontournables qui permettent la coexistence et le développement des relations sociales, parmi lesquelles la confiance entre les membres et dans les institutions. À l'époque de la Rome archaïque, une divinité, Fides, personnifiait la bonne foi qui devait régir les relations entre les peuples et les affaires entre les citoyens. Son culte, plus ancien que celui de Jupiter, remonte au roi Numa Pompilius, à qui l'on attribue la construction du temple sur le Capitole, Fides Publica.

Fides présidait à la loyauté et à la fidélité, valeurs fondatrices des grandes civilisations qui ont disparu avec le temps. La déesse était représentée sur les pièces de monnaie sous la forme d'une vieille femme à cannes, plus âgée que le père des dieux, dont l'apparence inspirait l'admiration et représentait la sagesse.
La fides exigeait le respect de la parole donnée qui permettait d'accéder au pouvoir, ce à quoi un politicien menteur n'aurait jamais eu accès. Parce qu'il incarnait l'essence de l'État et qu'il médiatisait la relation entre celui-ci et ses citoyens en garantissant le pacte avec le peuple centré sur la Fides.
Les valeurs qui donnent vie à un peuple
Les Romains considéraient la confiance et la loyauté comme les pierres angulaires du Mos maiorum et aucune relation publique ou privée ne pouvait échapper à cette règle. La dignité d'hommes dignes de confiance parce que loyaux et fidèles a fait la grandeur de ce phare de la civilisation que Rome représente encore dans le monde. La décadence de la civilisation qui a culminé avec l'avènement du capitalisme a rendu obsolètes les qualités humaines qui étaient indispensables et inaliénables dans le monde classique.

L'honneur d'une personne basé sur la confiance qu'elle inspirait à son prochain n'a plus de valeur, remplacé par le prix de chaque individu et son pouvoir d'achat. Il n'y a plus de confiance entre les vendeurs et les acheteurs, qui craignent non sans raison d'être trompés, car le premier n'est pas intéressé à sauvegarder l'intégrité de sa réputation, mais seulement à réaliser le maximum de profit avec le minimum d'effort. La relation fiduciaire entre l'État et le citoyen a disparu, ce dernier craignant que l'organisme qui devrait le protéger ne soit un persécuteur sadique. Les impôts injustes, les amendes et les pénalités de toutes sortes empoisonnent la vie des citoyens réduits à l'état de consommateurs et de contribuables pour l'entretien d'un appareil éléphantesque et injuste.
La difficulté d'être une tribu
La confiance dans l'affection a diminué, les gens doutent de la sincérité de leurs partisans, de leurs amis et de leurs parents, soupçonnant que derrière l'attachement sentimental se cache l'intérêt économique. L'éclipse des valeurs, du sens de l'honneur, du plaisir de l'honnêteté, de la fidélité aux principes, aux règles morales, fissure inexorablement la relation de confiance entre les membres de la communauté. C'est à cette grave carence que l'on peut attribuer la disparition du patriotisme, de l'amour de la patrie, des traditions des ancêtres. Les valeurs résiduelles ne vivent que dans les réalités tribales : supporters sportifs, communautés spirituelles, mouvements révolutionnaires.
Là, où la relation humaine reste basée sur la confiance, le partage et la complicité, apparaissent les dernières lueurs de l'esprit de clan. En dehors de ces espaces protégés par la dégénérescence de la société nourricière, le vide est absolu. Il est difficile de faire confiance à une justice qui ne punit pas les massacres comme celui du pont Morandi, qui enquête sur les citoyens qui se défendent contre les criminels et qui condamne les policiers qui frappent les criminels dangereux.
En revanche, il n'y a pas de poursuites contre les responsables de l'instabilité hydrogéologique qui a tué et détruit le territoire de la Romagne. L'État, qui a acquitté le pirate qui a éperonné un navire de la marine, met en examen la Capitainerie et la Guardia di Finanzia pour le naufrage d'immigrés clandestins imputable aux seuls trafiquants de nouveaux esclaves.

Ce qu'il reste de l'État
Il est tout aussi difficile de croire aux politiciens qui ont réduit l'État à un tas de décombres, détruisant l'économie, l'école, la culture et la langue italienne. Ne méritent pas la moindre confiance les syndicats qui n'ont pas protégé les travailleurs aux salaires les plus bas d'Europe, qui n'ont pas défendu les non-vaccinés suspendus de leur travail. Le manque de confiance dans la politique conduit les masses à se retirer du choix électoral, de l'engagement social, du devoir de participer à la vie de l'État.
Le monde américanisé, individualiste et égoïste, a éliminé le sens de l'appartenance, de l'identité et de l'esprit communautaire. La solitude, la dépression, les addictions en sont les conséquences pathologiques, une faiblesse généralisée qui laisse les citoyens à la merci des puissances de dissolution. La phase terminale du capitalisme, avec la tyrannie de la surveillance, a poussé la folle dérive commencée à la fin du Moyen Âge jusqu'à ses conséquences extrêmes.
Le cycle s'achève avec le remplacement des peuples et la disparition des cultures locales, mais ceux qui restent éveillés à l'heure la plus sombre de la nuit verront la lumière de l'aube. Les derniers hommes encore en vie se tiennent sur les ruines, tandis que les chiens se régalent des cadavres de lions croyant avoir gagné, mais les lions restent des lions tandis que les chiens ne restent que des chiens.
20:12 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fides, confiance, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 juin 2023
Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)

Andrea Zhok, "Au-delà de la droite et de la gauche" (Il Cerchio, 2023)
Compte rendu de Venceslav Soroczynski
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/25758-venceslav-soroczynski-andrea-zhok-oltre-destra-e-sinistra-il-cerchio-2023.html
On sait qu'il y a essentiellement deux façons de voter: avec les enfants et sans les enfants. Lorsqu'on est parent, on manipule délicatement le bulletin de vote, on entre dans l'isoloir comme dans les églises d'autres religions mystérieuses, on lit les noms pensivement et on fait son choix le cœur sur la main. Le vote, après avoir commis l'imprudence de confier un enfant à la réalité, semble avoir plus de poids dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, dans ces moments-là, l'idée fulminante et insoutenable de Flaiano selon laquelle, si l'on n'est pas de gauche à vingt ans et de droite à cinquante ans, on n'a rien compris à la vie, ne nous vient même pas en aide. C'est une plaisanterie, bonne pour les années soixante-dix, mais désormais inadaptée. Aujourd'hui, au contraire, on est, mais seulement par instinct, de gauche à cinquante ans et de droite à quatre-vingts ans, étant donné qu'à vingt ans, on sait publier une vidéo sur TikTok et qu'à cinquante ans, quelqu'un est encore engagé dans un stage gratuit.

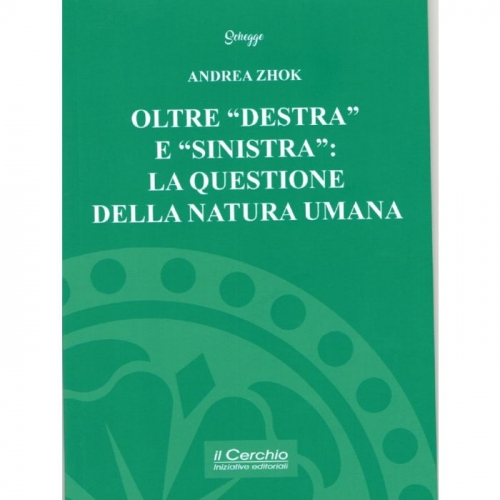
L'aphorisme de Flaiano, cependant, a toujours du sens et est très clair: quand on est jeune, on vote pour révolutionner; quand on est vieux, pour conserver. Parfois, l'impulsion persiste et l'on continue à croire que la gauche est progressiste et la droite modérée.
Mais l'impulsion est la grande erreur, c'est la croyance, c'est l'exercice d'une confiance inexplicable, voire infondée. En effet, les résultats des dernières élections suggèrent que le calcaire fidéiste est en train de fondre, mais ils laissent aussi le soupçon que le corps électoral est passé d'une erreur à l'autre: lorsque nous votons, nous nous trompons. Nous n'en faisons pas une seule de bonne. Mais pourquoi ? Parce que nous ignorons une grande partie de la géographie, une longue période de temps, une grande partie de la réalité.
Ce qu'Andrea Zhok tente de faire avec ce court essai, c'est de combler ces lacunes: de nous expliquer, patiemment, avec des mots compréhensibles, dans un texte qui n'est pas du tout maniable, que la droite et la gauche ne sont que des "simulacres".
Zhok est professeur de philosophie, donc obstinément attiré par la recherche de la clarté, de la vérité, des relations de cause à effet. Et de temps en temps, cela ne nous fait pas de mal non plus de nous plonger dans cette chose curieuse et peu fréquentable qu'est la réalité. C'est pourquoi, au lieu de lire les journaux les plus populaires et les plus distrayants de notre époque, je me suis jeté sur "Au-delà de la droite et de la gauche", comme quelqu'un qui se noie dans l'information mais qui passe à côté de la vue d'ensemble.
L'auteur part d'une analyse historique qui explique comment le "progressisme", depuis le 19ème siècle, a été l'expression du besoin de la bourgeoisie de changer, de progresser afin de se défaire des privilèges de la propriété foncière. Mais, sous le couperet de la révolution industrielle, les classes populaires, les paysans, les enfants, les mères, ont fini. Ainsi, le progrès pour les uns signifie déjà la régression pour les autres. En effet, l'auteur souligne que ses effets n'ont été positifs que pour un dixième des personnes concernées, tandis que pour les neuf autres, les conditions se sont dégradées. Le progressisme devient donc déjà libéral-capitaliste.
Dès lors, le Manifeste de Marx et Engels ne pouvait qu'être critique à son égard, affirmant qu'il ne suffit pas de progresser dans le sens du changement, mais qu'il faut corriger les erreurs du passé, tout en préservant sa valeur - aujourd'hui, nous dirions "ses valeurs". Ainsi, si le progressisme est une impulsion névrotique ou cynique au profit de certains, le progrès est le résultat d'une action réfléchie au profit de tous.
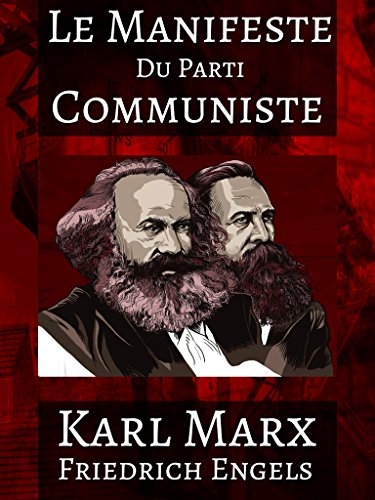 Le progressisme critiqué par Marx est un progressisme libéral, qui supporte mal les contraintes car il n'a pas de temps à perdre: il doit chercher de nouveaux marchés et accumuler du capital. Il nage bien dans la société liquide qui est telle d'un point de vue social, identitaire, anthropologique. Le socialisme scientifique perd sa connotation historique originelle et se disperse dans le sens scientifique de la science naturelle. Ce que la science rend possible est autorisé, surtout si cela sert le capital, indépendamment des dispositions naturelles de l'individu. Aujourd'hui encore, l'"expert" influence l'opinion des masses, tandis que l'intellectuel n'est pas écouté. Il est impossible de ne pas évoquer, à cet égard, les paroles lumineuses de Thomas Stearns Eliot : "Où est la sagesse que nous avons / Perdue dans la connaissance / Où est la connaissance que nous avons / Perdue dans l'information" (The Rock, 1934).
Le progressisme critiqué par Marx est un progressisme libéral, qui supporte mal les contraintes car il n'a pas de temps à perdre: il doit chercher de nouveaux marchés et accumuler du capital. Il nage bien dans la société liquide qui est telle d'un point de vue social, identitaire, anthropologique. Le socialisme scientifique perd sa connotation historique originelle et se disperse dans le sens scientifique de la science naturelle. Ce que la science rend possible est autorisé, surtout si cela sert le capital, indépendamment des dispositions naturelles de l'individu. Aujourd'hui encore, l'"expert" influence l'opinion des masses, tandis que l'intellectuel n'est pas écouté. Il est impossible de ne pas évoquer, à cet égard, les paroles lumineuses de Thomas Stearns Eliot : "Où est la sagesse que nous avons / Perdue dans la connaissance / Où est la connaissance que nous avons / Perdue dans l'information" (The Rock, 1934).
Ainsi, dans les pays "avancés", la gauche et la droite copient les pires modèles, qui érodent la qualité et la quantité des services publics essentiels, sous prétexte d'alléger la machine étatique. Les droits sociaux, sous prétexte d'augmenter la flexibilité. Comme le dit l'auteur, gauche et droite sont devenues de simples variantes du progressisme libéral (rappelons d'ailleurs que Gianni Agnelli avait laissé entendre qu'en Italie, seule la gauche pouvait faire des réformes de droite. Et, de fait, quelques années plus tard, c'est le gouvernement PD/socialiste de Renzi qui a dépriorisé les protections inscrites à l'article 18 du Statut des travailleurs).
Zhok affirme qu'il y a maintenant une véritable attaque contre la nature humaine, une attaque visant à éliminer toute institution non négociable, y compris la famille : "... tout lien de caractère affectif stable représente un problème du point de vue du capital, parce qu'il rend le comportement de l'individu dépendant d'une contrainte étrangère aux exigences du marché". Et si l'on considère que "... la famille est le lieu principal où se déchargent toutes les tensions et contradictions du monde, où elles s'amortissent, et où elles cherchent, laborieusement, une solution. Les familles, surtout celles qui fonctionnent bien, sont donc des lieux de travail intensif, de travail sur les attentes, sur la communication, sur la construction des motivations, sur le sens de l'existence", on comprend bien la dévastation sociale que la thèse laisse présager.
L'auteur poursuit en nous donnant des exemples de la manière dont le progressisme libéral sape les institutions sociales et les institutions intimes de l'individu : la gestation pour autrui, qui commence à ressembler à une rente de plus ; la fluidité des genres, qui rend désormais les identités biologiques floues, fuzzy, adaptables, flexibles, précaires; le "féminisme de la deuxième vague", qui n'a plus pour objectif propre l'égalité, mais vise à identifier l'autre sexe comme sujet exploiteur: ce n'est donc pas la nouvelle société libérale qui est source d'injustice, mais un homme qui est dans le rouage de la structure.

Le livre dit beaucoup plus, diagnostiquant ainsi précisément un malaise dont le symptôme est corroboré par le fait qu'après tout, nous ne votons pas: nous achetons des marchandises. Selon Debord, "toute la vie des sociétés où règnent les conditions modernes de production se présente comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était vécu directement a reculé dans une représentation" (La société du spectacle, 1967). Nous choisissons des images, nous achetons des billets pour des monologues, en fait "le spectacle est le contraire du dialogue" (Debord encore). Alors, où en sommes-nous ? J'ai le sentiment que, pendant la décennie de distraction, le navire a simplement fait un lent virage à droite. La politique intérieure - parce que la politique étrangère, nous le savons maintenant, n'est rien d'autre que l'exécution des ordres des États-Unis - est de droite.
Et cette droite est soit libérale, soit libéraliste, soit fasciste. En matière de politique fiscale, elle est libérale : pour les parts de revenus même très élevées, le contribuable peut appliquer une flat tax violemment inconstitutionnelle - et ce n'est pas un fait théorique: simplement, ceux qui ont plus paient proportionnellement moins. En matière de politique de santé, soit on est libéral (s'il a des moyens matériels, le malade peut payer une visite privée pour 150 euros ; s'il n'en a pas, il attend 14 mois pour une visite), soit on est fasciste (soit vous vous injectez une substance inefficace et potentiellement toxique, soit vous renoncez à votre salaire et vous rejoignez les rangs des sans-protection de la loi Zan). Je n'ai donné que quelques exemples.

La politique italienne, dans ses grands choix, se déplace sur des rails de tramway et le conducteur du tramway ne peut pas tourner à gauche ou à droite quand il le souhaite. Le conducteur du tramway, pour les choses importantes, doit suivre la route de fer dont le concepteur se trouve de l'autre côté de l'Atlantique et nous regarde comme on regarde un allié dont on peut se passer. Ce dans quoi nous sommes impliqués n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine : c'est la guerre des États-Unis contre toute l'Europe. Ils nous ont pris l'approvisionnement en matières premières bon marché, les marchés de débouchés pour les produits de luxe italiens, les touristes qui avaient l'habitude de dépenser davantage sur nos plages et dans nos montagnes. Ils nous ont pris tout cela, et peut-être pour des décennies. Et ils s'efforcent de nous priver de l'industrie manufacturière chinoise.
Comme l'a admirablement écrit le même auteur il y a quelque temps, "nous ne sommes pas sous le parapluie de l'OTAN, nous sommes le parapluie de l'OTAN". À mon avis, elle agit comme la mafia, c'est-à-dire qu'elle vient vous voir et vous dit : "Vous avez besoin de quelqu'un pour vous protéger de ceux qui veulent mettre le feu à votre magasin". Il se trouve que si vous ne payez pas sa "protection", votre magasin est effectivement incendié, mais c'est la mafia elle-même qui a fait cela. Ce "modèle d'entreprise" est le même que celui qui a été appliqué à l'Italie chaque fois qu'elle a voulu se passer de la protection imposée par le bloc d'intérêts basé aux États-Unis et au Royaume-Uni, depuis l'assassinat de Mattei.
Nous ne pouvons certainement pas ignorer l'avertissement de Machiavel, qui a observé que dès qu'une personne "populaire" s'élevait au rang des "seigneurs" dans le gouvernement de Florence, elle affaiblissait ses revendications révolutionnaires, car elle se rendait compte des réalités de la République : "Et comme il était monté à cette place et qu'il voyait les choses de plus près, il connut les désordres d'où ils provenaient et les dangers qui en résultaient et la difficulté d'y remédier ... et il devint immédiatement d'un autre esprit et d'une autre pensée" (Discorsi, I, 47). Et manifestement, même à notre époque, une force politique, tant qu'elle est dans l'opposition, peut facilement critiquer l'action des gouvernants, mais lorsqu'elle en vient à comprendre les véritables rapports de force, elle finit par reproduire la politique précédente.
Cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras, mais qu'il faut au moins avoir la lucidité de juger un parti non pas lorsqu'il est dans l'opposition, mais lorsqu'il gouverne. Et surtout, que nous avons encore une chance : donner confiance à ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche, parce qu'ils ne sont pas encore "montés à cette place".
14:52 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, gauche, andrea zhok, actualité, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qu'est-ce que la propagande? Réflexions sur un livre ancien de Jacques Ellul

Qu'est-ce que la propagande? Réflexions sur un livre ancien de Jacques Ellul
par Pierluigi Fagan
Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/propaganda
Ce livre de Jacques Ellul sur la propagande a été écrit en 1962, donc sans des phénomènes tels que l'Internet et les réseaux sociaux, la mondialisation, la télévision privée, les chaînes de télévision en ligne, la diffusion par satellite et par câble, la mobilité cellulaire, la segmentation statistique psychographique et le Big Data. Cependant, le livre d'Ellul reste un ouvrage de référence pour l'étude du phénomène 'propagande", tel qu'il est encore enseigné dans de nombreuses facultés (avec Bernays, Lasswell, Dobb jetant toujours un coup d'œil en privé sur Goebbels, un coup d'oeil grossier mais efficace). La première considération à faire est de savoir combien de penseurs, en Europe mais souvent aussi aux Etats-Unis, avaient dans les années 60 des idées très claires sur les contours fondamentaux de la société qui est encore la nôtre, une société devenue pire sous certains traits. Plutôt que de porter un jugement d'actualité, nous devrions nous demander pourquoi nous redécouvrons aujourd'hui mille et une fois une eau chaude qui avait déjà été chauffée pour de bon il y a soixante ans. Il est clair qu'un des problèmes majeurs qui se pose aux idées et aux systèmes mentaux critiques et donc non dominants est leur dispersion dans le temps, ils ne s'accumulent pas, ils ne font pas masse.

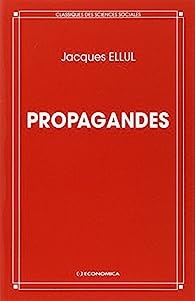
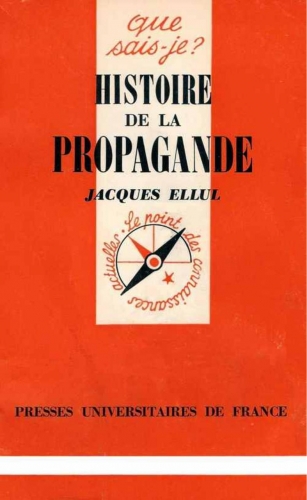
L'auteur, Ellul, est un Français inclassable. Historien du droit, théologien protestant, critique de la société technique telle qu'abordée par Gunther Anders, de tendance anarcho-libertaire, marxologue non marxiste, il a anticipé les thèmes de la décroissance. Jacques Ellul est ici dans le rôle du sociologue, peut-être sa spécialité la plus complète et la plus pointue.
Compte tenu du sujet et de l'actualité récente, il convient de commencer par dire qu'"il y a propagandiste et propagandiste". Le premier est souvent un fonctionnaire du système qui doit fondre psychologiquement les individus en une masse pour qu'ils se conforment au système. Cela s'applique aussi bien aux dictatures qu'aux démocraties ou pseudo-démocraties. Selon Ellul, la propagande (qui coïncide avec la diffusion d'une image précise de l'homme et du monde qui lui donne raison et sens) est une nécessité pour les sociétés modernes et techniques, quel que soit le régime politique. Le propagandiste connaît la psychologie sociale, l'individu, la psychologie profonde, la sociologie, la mythologie, les formes religieuses, de sorte que, du haut de son pouvoir cognitif, il méprise le propagandisé, même s'il l'a bien étudié, ou peut-être à cause de cela.

Elle implique le rationnel et l'irrationnel, le public et le privé, le conscient et l'inconscient, ainsi que tous les médias possibles et imaginables, ceux-ci étant toujours la propriété de l'État ou des capitalistes, comme en Occident. Mieux vaut un seul média, ou au moins quelques-uns et accordés entre eux.
Dans les sociétés "libérales", la liberté ,e peut se mouvoir que dans deux camps qui se détestent et sont incapables de dialoguer, d'où la mortification de la pâle prétention au pluralisme démocratique au profit d'un bipolarisme de fait. De toute façon, deux pôles font le milieu du jeu, et c'est donc finalement la structure de pouvoir qui gouverne de toute façon. Cela cristallise les images du monde à partir d'un puissant travail de simplification dont le propagandiste est l'artisan.
Que d'angoisses dues à l'impréparation et à la peur engendrées par la cascade de nouvelles incompréhensibles, inquiétantes et anxiogènes ! Puisque les pouvoirs ont toujours besoin d'une légitimité donnée par le peuple et qu'on voit mal comment des gens qui travaillent huit heures par jour, plus le temps passé dans les transports et le temps destiné aux soins personnels, peuvent savoir vaguement quoi que ce soit sur l'économie, la finance, la technologie, la géopolitique, la culture, la politique, la société, l'avenir, l'environnement, etc, Ce sont des mots à la mode, des mantras, des refrains pré-packagés, des slogans, des témoignages, des experts, des fragments de rationalité lubrifiés avec d'importantes doses d'émotivité pour des cerveaux faibles, distraits, sans mémoire, dépendants, déstabilisés et rendus incertains par une ignorance évidente, avides de Vérité et de bonnes choses à penser.
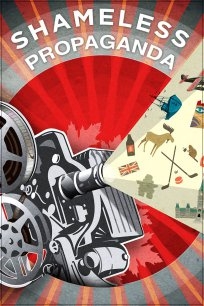
Aujourd'hui, avec des problèmes de plus en plus complexes et globaux, la propagande devient de plus en plus exaspérante, pointilliste, des étincelles d'attention déconnectées du tout, des kaléidoscopes impressionnistes. L'efficacité de la propagande est conditionnée par son immensité enveloppante, sa continuité, sa cohérence invisible, sa répétitivité et, de façon perverse, son utilité pour donner de la raison et du sens à ce qui n'en a pas. Plus il y a de "sens" moins il y aura de dissidence.
La connaissance et l'exploitation scientifique des mécanismes de contagion et de synchronisation des masses, du fait que, comme le disait Durkheim, "le groupe pense et agit d'une manière complètement différente de celle dont ses membres individuels penseraient et agiraient s'ils étaient isolés", de l'isolement mutuel actuel entre des personnes qui ne transmettent pas réciproquement des informations et des connaissances (elles ne débattent pas) mais proposent des données et des interprétations provenant d'une source unique, le public qui se fait une opinion ou plutôt acquiert l'opinion qu'on lui donne puisqu'il n'a pas le temps ou les outils pour se faire sa propre opinion, créent la situation idéale. La propagande, comme la publicité, n'invente presque rien, elle pêche parmi les préjugés, les stéréotypes, les catégorisations, les modèles, les traditions, les conformismes, les mythes profonds (il y a une faim primitive de mythe, surtout du côté masculin), qui existent déjà (la Nation, le travail, le Héros, le bonheur, la liberté).
Un mythe éternel est celui du Grand Homme que l'on adore tout en le manipulant et en l'entubant; un autre de ces grands hommes (Berlusconi) vient de mourir, un "grand homme" qui a recodé nos codes socioculturels, éthiques, moraux et politiques sous les applaudissements convaincus de ses adorateurs propagandistes. Je me suis mis en tête de faire la liste des orphelins éplorés à son enterrement, de Boldi à Razzi, un instantané sociologique du niveau de l'imaginaire national de ces trois dernières décennies, puis j'ai laissé tomber, c'est de toute façon inutile par les temps qui courent. Si l'imbécile était capable de se rendre compte qu'il en est un, il n'en serait pas un.
La taxonomie d'Ellul est élaborée. Il y a la propagande politique et sociologique, verticale et horizontale, l'agitation et l'intégration (modèle de lutte des partis, puis de gouvernement qui change radicalement d'arguments et de ton), le rationnel et l'irrationnel. En Occident, elle tend à s'adapter à une société de masse individualiste et abrutissante après la destruction ou l'affaiblissement de toute structure intermédiaire. Les allusions au prototype américain de son époque donnent l'idée d'un véritable "rayonnement social", ce sont les formes, les modes, les symboles mêmes de notre société environnante qui communiquent avant qu'on leur ordonne de parler.

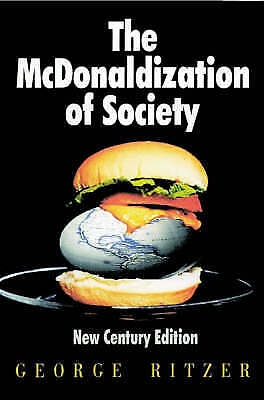
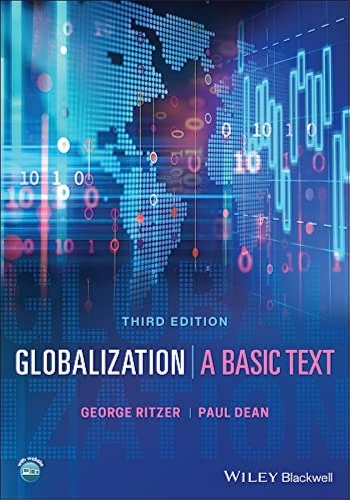
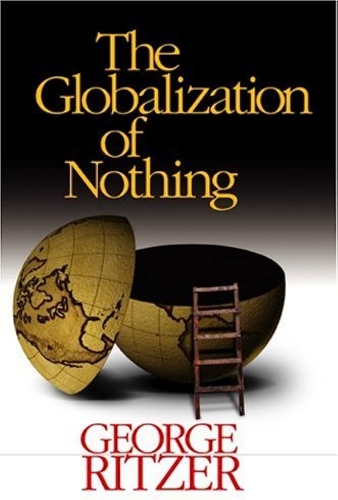
Un autre sociologue plus récent, George Ritzer (2005), a publié dix livres en anglais jusqu'à il y a deux ans, avec un livre sur la "forme McDonal"d de nombreuses structures sociales: efficacité, calculabilité, prévisibilité, uniformité dans un univers de McUniversité, McMedia, McChildren et, en fin de compte, une McConscience de soi. Tout cela rayonne avec cohérence directement de la société, le discours propagandiste ne devenant qu'un simple accompagnement. La nécessité de simplifier le discours correspond à la nécessité de simplifier la société. Ses effets ne sont pas superficiels et transitoires, ils façonnent l'esprit avant le contenu par les formes, par exemple en dichotomisant tout (bien-mal, juste-mal), en jugeant avant même d'analyser, en ordonnant la pensée dans les chemins déjà tracés (dont on sait déjà où ils aboutissent de toute façon), en étant obsédé névrotiquement par le présent pour que les causes s'échappent, en ne se demandant jamais "pourquoi"... en essayant bien sûr de dépasser les réponses de pacotille des historiettes qui nous sont assénées.
Dernièrement, pousser compulsivement des boutons sur un parallélépipède plat à tenir devant ses yeux. L'efficacité de la propagande a pour condition préalable l'immensité enveloppante, la continuité, la cohérence invisible, la répétitivité.
L'autre soir, je suis tombé sur une soirée Rampini sur la 7, avec pour thème les Etats-Unis d'Amérique (et dont le decorum reproduisait les couleurs et les formes du drapeau) suivie d'une autre sur la Chine. Selon Rampini, qui revendiquait fièrement sa nouvelle citoyenneté américaine, les Etats-Unis sont forts, inatteignables et gagnants dans tous les grands domaines de la puissance (armes, dollar, PIB, technologie, démographie) et le resteront, heureusement pour nous, encore longtemps. Le seul problème, c'est que ces derniers temps, ils semblent manquer de confiance en eux (zut !).

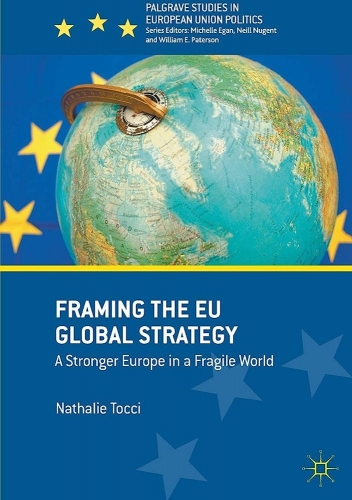

J'ajouterai encore quelques remarques sur cette Nathalie Tocci, "experte" convoquée pour nous expliquer les choses. La dame semble diriger un think tank italien de politique internationale. Mais l'on découvre sur son site qu'il reçoit près de 50% de ses fonds d'"organismes et fondations étrangers" (pas de honte). La dame avait tendance, lorsqu'elle parlait des Etats-Unis, à hausser les pointes intérieures de ses sourcils puis à les abaisser, comme si elle parlait sous les traits d'un pauvre petit chaperon rouge en proie aux mille embûches de la forêt mondiale. Lorsqu'elle parlait de la Russie et de la Chine, elle faisait l'inverse, abaissant les pointes intérieures et relevant les pointes extérieures, comme si elle parlait du grand méchant loup qui s'apprêtait à dévorer la pauvre grand-mère. Après tout, il était tard dans la soirée et les histoires à dormir debout ont leur public. Je me suis senti nostalgique de Luttwak.
Nous en sommes à la régression infantile des opinions publiques, qui va de pair avec un autre concept de la sociologie contemporaine, la "gamification", c'est-à-dire l'introduction de mécanismes de jeu dans des environnements non ludiques tels que l'internet, les systèmes sociaux, d'apprentissage ou d'entreprise, en sollicitant une participation active et "spontanée". Le récent déclin qualitatif des propagandistes correspond à celui des propagandistes et, plus généralement, à l'esprit du temps.
Je termine sur une note positive, que faire, quels antidotes, comment surmonter cette condition de servitude psycho-intellectuelle volontaire, propédeutique à la servitude volontaire de participation à la termitière sociale au rythme des tambours joués pour nous par les propagandistes du système ? Le temps. Passer du travail sur les choses au travail sur soi, gagner du temps à consacrer à l'auto-formation de sa mentalité. Une mentalité, formée a maintenir une distance critique par rapport à la propagande, brise la magie, l'enchantement, devient immunisée, regarde de haut le fatras propagandiste, rompant ainsi la servitude volontaire. Mais au milieu de plus de tradition, plus de travail, plus d'ordre, plus de justice, plus de liberté, plus d'innovation, plus de sécurité, plus d'opportunités, la propagande politique semble unanime à éviter de promettre le seul plus dont vous avez besoin pour décider pour vous-mêmes, juger par vous-mêmes, agir avec le plein sens de vous-mêmes: le plus de temps.
Moins de travail, plus de temps, moins de propagande. C'est l'utopie ultime et irréalisable.
12:07 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : propagande, définition, théorie politique, jacques ellul, george ritzer, politologie, philosophie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 juin 2023
Des guerres plus "démocratiques" que "justes"

Des guerres plus "démocratiques" que "justes"
par Theodore Katte Klitsche de la Grange
Source: http://italiaeilmondo.com/2023/06/18/guerre-piu-democratiche-che-giuste-di-teodoro-katte-klitsche-de-la-grange/
Cet article a été publié dans la revue "Il giusto processo" n° 18/19 (octobre 2005 - avril 2006).
Il est courant aujourd'hui de considérer que les guerres justes sont celles qui sont menées pour exporter les "valeurs" (et les institutions) de la démocratie libérale, parmi lesquelles figure (et se distingue) l'idéologie des droits de l'homme. À cela s'ajoute la thèse - souvent liée - selon laquelle des tribunaux internationaux sont nécessaires pour prévenir les "guerres injustes" et punir leurs auteurs. Ce qui revient à inverser, ou plutôt à appliquer dans un mauvais contexte, le jugement de De Maistre selon lequel "là où il n'y a pas de jugement, il y a affrontement".
Disons que le contexte est mauvais car De Maistre est la synthèse d'un discours sur la souveraineté dont l'exemple est précisément le Tribunal: "On voit dans les Tribunaux la nécessité absolue de la souveraineté; parce qu'il faut gouverner les hommes comme il faut les juger, et par la même raison; c'est-à-dire, parce que là où il n'y a point de jugement, il y a affrontement". Mais chez De Maistre, le tout présuppose la souveraineté et l'État, et un tribunal - l'office de ce dernier.
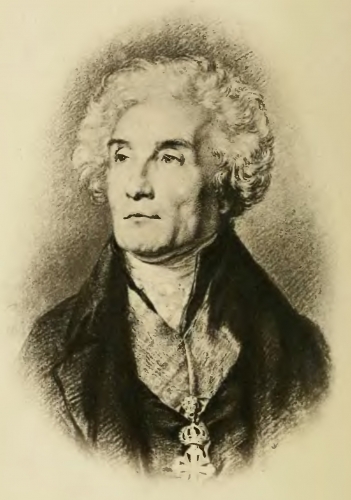
Au contraire, dans la pensée postmoderne, le tribunal (international) est l'alternative/substitution de l'État. En d'autres termes, c'est le contraire du jugement de Hegel selon lequel "il n'y a pas de préteur parmi les États" [2]. Ici, au contraire, on suppose qu'il peut y en avoir un, et qu'il est capable d'appliquer (c'est-à-dire de faire appliquer) ses jugements, tout comme le font, au sein de l'État, la police et d'autres services et bureaux de l'État, en se prévalant du monopole (de l'État) quant à l'usage légitime de la force. On oublie cependant que c'est bien là le problème et non celui du jus dicere, tout comme les diverses expériences historiques qui le prouvent.
Mais ce type de guerre est-il vraiment juste ?
Et est-elle conforme aux véritables critères de justice ? Un examen historique peut contribuer à la réponse.
À l'aube du jus publicum europaeum, la théologie chrétienne, qui en a esquissé les principes, a identifié les exigences de la guerre juste dans l'autorité (légitime) de ceux qui la mènent (et la déclarent), dans le bon motif (de la guerre), dans la bonne intention et dans la bonne manière de la mener. La juste cause était comprise dans le sens juridique "classique", c'est-à-dire comme la protection des droits concrets violés. La nécessité (et la légitimité) de la guerre découlait alors de l'absence d'une autorité capable de régler les différends en réparant les violations des droits par un ordre efficace et applicable par les parties au différend. Dans cette construction juridique, il n'y a pas de place pour des "droits" abstraits, mais seulement pour des droits (très) concrets. Suarez, en énumérant des exemples de "causes justes" pour la guerre, fait presque une énumération des "actions" reconnues dans le droit romain pour la restauration des droits violés: occupation des provinces d'autrui (rivendica), entrave au transit (confessoria servitutis), ainsi que les blessures infligées au droit d'entretenir des relations économiques coutumières. Il s'agit de droits fondés sur l'histoire et la coutume, c'est-à-dire sur un ordre concret, au maintien et à la préservation duquel le recours à la guerre contribue.
L'évolution ultérieure a conduit à faire de la guerre juste, plutôt qu'un moyen de rétablir le droit, le moyen de préserver la puissance (la sécurité, l'équilibre) des États, et par conséquent de la communauté internationale, fondée sur le pluralisme des unités politiques. Ce n'est pas que la protection du droit (qui est en soi une puissance) ne constitue plus une cause juste, mais à côté, ou plutôt au-dessus, s'est ajoutée (et a prévalu) la raison de la défense de la puissance. Montesquieu en donne un exemple : "La vie des États est semblable à celle des hommes: ceux-ci ont le droit de tuer pour se défendre, ceux-là ont le droit de faire la guerre pour se conserver" et poursuit "Entre citoyens, le droit de légitime défense n'implique pas la nécessité de l'attaque. Au lieu d'attaquer, ils n'ont qu'à recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer ce droit de défense que dans des cas subjectifs, dans lesquels ils seraient perdus s'ils attendaient le secours de la loi. Mais au niveau des Etats, le droit de légitime défense implique quelquefois la nécessité d'attaquer, lorsqu'un peuple s'aperçoit qu'une paix plus longue donnerait à un autre État la possibilité de le détruire, et que l'attaque est à ce moment le seul moyen d'empêcher cette destruction" pour conclure: "Le droit de guerre dérive donc de la nécessité et d'un strict respect de la justice. Si ceux qui dirigent la conscience ou les conseils des princes ne se conforment pas à ces règles, tout est perdu; et, s'il faut les fonder sur des principes arbitraires de gloire, de bien-être, d'utilité, des flots de sang inonderont la terre" [3].

Que le droit de guerre découle de la nécessité ne signifie rien de plus, puisque necessitas non habet legem, qu'il n'est pas nécessaire de rétablir un droit: au contraire, qu'en cas de nécessité, il est légitime de violer le droit.
La situation a changé avec la Révolution française : jusqu'alors, il était normal que les guerres soient un moyen de régler des conflits (de pouvoir ou de droit) entre des États qui se reconnaissaient et se respectaient. La conséquence en était l'intangibilité du droit interne et des États eux-mêmes. Les guerres se terminaient par la "remise" de quelques provinces ou (plus souvent) de quelques colonies qui laissaient l'ordre en l'état.

Ce système a commencé à être ébranlé par la Révolution française: avec le décret La Révellière-Lépeaux de la Convention sur l'exportation des principes révolutionnaires, l'"indifférence" des événements de guerre à l'égard de l'ordre interne des États concernés a commencé à être ébranlée. De même, le respect de l'existence des États qui, pendant la période révolutionnaire et napoléonienne, s'est traduit par la création d'États entièrement nouveaux (les républiques-sœurs puis les États du système napoléonien), lesquels étaient politiquement homogènes avec le vainqueur, ce qui a porté une atteinte positive au droit "constituant" et originel de former une communauté.

Kant écrit que contre l'ennemi injuste, les vainqueurs ne peuvent aller "jusqu'à se partager le territoire de cet État et à faire disparaître un État de la terre, car ce serait une véritable injustice à l'égard du peuple qui ne peut perdre son droit originel de former une communauté" [4]. Et ce qu'il dit pour la disparition des Etats s'applique également à la création de nouveaux Etats par le vainqueur. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec la formule "guerre aux châteaux, paix aux chaumières", l'exportation de principes formulés de manière abstraite a commencé et a été légitimée, étrangère aux communautés qui ont dû les importer de force et générant souvent une "nouvelle" forme de guerre, la guerre partisane (moderne) dans laquelle la communauté "importatrice", par le biais du mouvement de guérilla, ne pouvait pas être la seule à avoir le droit de former une communauté.

La communauté importatrice, à travers le mouvement de guérilla, prend progressivement le caractère de l'ennemi (et du sujet belligérant), en tant que peuple en armes. Les formulations les plus radicales sont celles de Mao-tse-dong et la pratique associée est celle des guerres anticoloniales du 20ème siècle.
La conclusion de la Seconde Guerre mondiale l'a confirmé dans un contexte complètement différent: il était déjà écrit dans la Charte de l'Atlantique que les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni déclaraient à l'époque qu'ils "respectent le droit de tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils désirent vivre, et souhaitent le rétablissement des droits souverains et du libre exercice du gouvernement à ceux à qui ils ont été enlevés par la force", comme cela a été confirmé à Yalta [5] "pour chaque État libéré en Europe, pour chaque ancien État satellite de l'Axe". Et ce, même si personne n'en avait exprimé l'intention.
La mise en œuvre de cette déclaration a consisté, comme on le sait, à ce que chacun des États libérés se dote d'une forme de constitution correspondant "à la couleur des uniformes des libérateurs (occupants)".
Le pouvoir constituant, tel qu'il était alors explicitement prévu pour la souveraineté, était (pour le moins) limité. Et l'on peut se demander, à ce stade, si limiter des pouvoirs en eux-mêmes illimités (comme, précisément, le pouvoir constituant et la souveraineté) ne revient pas à les nier à la base, comme le fait implicitement la doctrine de l'État moderne de Sieyès à Victor Emmanuel Orlando.
Quant aux tribunaux pénaux internationaux, institutions qui se sont généralisées au siècle dernier, pour juger l'ennemi vaincu (par les vainqueurs), ils étaient totalement inconnus, car rejetés par le jus publicum europaeum, dans lequel le principe in parem non habet jurisdictionem était en vigueur. Ainsi, entre États souverains, l'un ne pouvait juger l'autre (et cela valait aussi bien pour les organes "faîtiers" que pour les autres); en outre, Kant considérait que la "clause d'amnistie" (réciproque) entre les parties contractantes était inhérente à tout traité de paix. Ce qui frappe le plus dans cette pratique (consolidée pendant des siècles), c'est son réalisme qui l'adapte, bien mieux que le pan-juridisme contemporain, à l'ordre concret des communautés dotées de droits et de dignités égaux. En premier lieu, parce que le problème de la justice (et du droit) en termes concrets se pose: l'activité du juge n'est pas un simple énoncé de normes, mais l'application de normes à un fait concret: même des normes justes et acceptées si elles sont appliquées de manière sélective, ou par un juge non partial, ou si elles aboutissent à des jugements inapplicables, ne possèdent pas les caractéristiques communément attribuées à la justice, ni l'utilité réelle de la justice.

Les caractéristiques communes de ces tribunaux sont: (toujours) que l'accusé coïncide avec le vaincu; (très souvent) que les juges sont les vainqueurs; que pour des raisons pratiques (c'est-à-dire pour conformer le nouvel ordre à la situation de fait -et de pouvoir- créée à la suite de la guerre), les décisions des tribunaux n'ont aucune incidence. La fonction dominante est liturgique: revêtir des habits solennels de la justice ce qui a été décidé pendant la guerre, en disqualifiant moralement l'ennemi vaincu. Ils sont par essence l'autodafé à l'ère de la mondialisation.
Mais que la nécessité à résoudre ait déjà été résolue avec la guerre, dont l'issue est en réalité la "conformité" à l'ordre, et que le jugement du tribunal n'y ajoute ni n'y retranche rien, c'est évident. Contrairement à celui d'un juge "interne" dont la décision est essentielle pour les droits (et la vie) du jugé.
Ces deux "innovations" ont en commun le caractère "démocratique" que l'État et la guerre moderne ont acquis au cours des deux derniers siècles. Ainsi, la démocratie, considérée comme un bien précieux par les peuples qui ont lutté pour l'acquérir, serait un cadeau - tout aussi important - pour ceux qui n'en ont jamais rêvé. Mais, très probablement, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne la considéraient pas si précieuse qu'elle valait la peine d'une guerre ou d'une révolution. En outre, et plus encore, les guerres "d'exportation" et les tribunaux internationaux sont liés à une aspiration (illusion) à la paix. On considère qu'il est préférable d'avoir des gouvernements démocratiques au pouvoir dans d'autres pays parce qu'ils sont jugés moins enclins à la guerre; et les tribunaux seraient le moyen de préserver la paix en punissant ceux qui la violent.
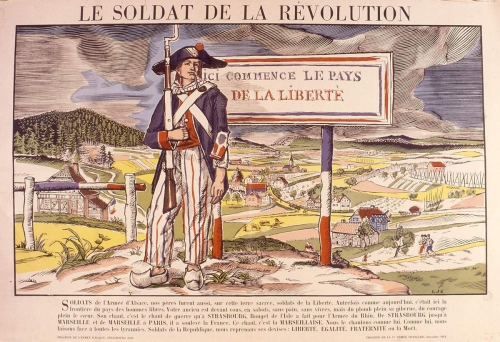
Mais pour ce qui est du premier point, l'histoire montre que les démocraties ne sont pas moins bellicistes que les autres formes d'État: en fait, elles le sont même davantage en termes d'intensité de la guerre. Déjà en décrivant le caractère de l'Athénienne, Périclès, dans le discours rapporté par Thucydide [6], jette la main, pour ainsi dire, sur ses exploits (et ses vertus) guerriers. Plus encore, à l'époque moderne, la démocratie s'est (le plus souvent) combinée avec la levée en masse et l'intensification de l'hostilité.
Mais si, pour la démocratie, on peut encore espérer que l'aspect "moderne" de celle-ci l'emporte (selon la distinction bien connue de Benjamin Constant), c'est-à-dire l'élément libéral, la tolérance, l'esprit de commerce qui conditionne de toute façon l'esprit de conquête, pour le remède des tribunaux, aucun espoir raisonnable n'est en vue.
Car dans ce cas, il s'agit essentiellement de remplacer la politique (et le politique) par le droit. C'est une vieille recette, qui ne peut fonctionner que si le tribunal prend des connotations politiques, c'est-à-dire qu'il cesse d'être un organe (purement) judiciaire et devient - sur le plan organisationnel et fonctionnel - une unité politique ou un organe de ce dernier. C'est-à-dire capable d'utiliser la force (donc avec une organisation spéciale) et donc d'être un "pouvoir" au sens wébérien, c'est-à-dire capable de faire respecter - concrètement - ses ordres. Ceux qui croient cela pensent avoir inventé la politique sans (les moyens de) la force. Un Prince tout renard et non pas lion. Un sujet qui n'est pas encore apparu dans l'histoire, et qui, étant contraire à une conception réaliste de l'homme, ne semble pas pouvoir y apparaître un jour. Aussi parce que si la Cour utilise la force des Etats, c'est elle, et non le jugement, qui déterminera la relation réelle entre la justice internationale et l'Etat (ou les Etats) exécutant(s): puisque l'exécution des jugements est le fait décisif, ce sera la capacité ou la volonté de le faire qui déterminera la possibilité de ce qui compte vraiment; que la décision soit observée et passe de l'imaginaire normatif à l'ordre concret, en s'y conformant.
En outre, le rationalisme qui sous-tend la doctrine de l'État moderne a construit comme son "mode d'emploi" la Raison d'État. La "raison d'État" était fondée - et c'était l'une de ses conséquences - à la fois sur la sécularisation, se configurant (également) comme une séparation/limitation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et sur l'autonomie du politique, sur son extranéité/indifférence par rapport aux autres sphères de l'expérience humaine.
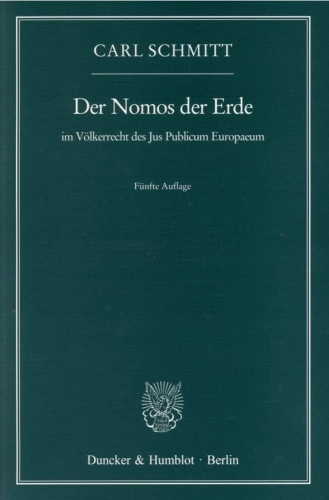
L'objectif spécifique de la politique était également déterminé par ce dernier: la protection, la sécurité et le bien-être de la communauté de référence, avec l'exclusion - ou le passage à l'arrière-plan - des objectifs de nature religieuse ou morale. Si un pape du Moyen Âge pouvait proclamer une croisade, il n'en va pas de même pour un monarque absolu de l'époque moderne, dont la fonction spécifique est celle mentionnée ci-dessus, et non de promouvoir la diffusion d'une foi ou d'une morale. Il en va différemment, mais seulement en partie, pour le (ou les) droit(s): dans ce cas, la protection de ceux-ci, s'ils correspondent à un intérêt de l'État, est la tâche de l'État lui-même. Cependant, selon la doctrine du jus publicum europaeum, le terme "droit" signifie dans ce cas le droit appartenant à l'État et à ses sujets ; d'autre part, il est exclu [7] qu'il soit justa causa belli de protéger des droits qui n'appartiennent pas à son propre État ou à ses propres sujets. Ce qui, dans les "guerres pour la démocratie", est sacrifié à un altruisme démesuré, et dont l'effet probable (et visible) est de multiplier les conflits (les justae causae).
C'est précisément ce que la rationalité des juristes-théologiens (voir note 7 ci-dessus) de la Contre-Réforme cherchait à éviter.
En ce sens, cette conception était conforme à la théorie de la Raison d'État: qui n'est pas une conception juridique (bien qu'elle ait de grandes répercussions juridiques) en ce sens qu'elle ne repose pas sur le concept de droit, mais plutôt sur le concept d'intérêt: il incombe à l'État de protéger l'intérêt (public-général) de la communauté politique (salus rei publicae suprema lex). Ce qui est conforme à cet intérêt est licite et doit être fait. En revanche, dans le cas des "guerres démocratiques", la lex suprema de l'intérêt de l'État finit, précisément dans les situations d'exception, par passer à l'arrière-plan; et au premier plan se trouve plutôt une justice abstraite, promouvant des droits dont il n'est pas clair si et dans quelle mesure les "protégés" aspirent à en jouir (et combien ils veulent sacrifier pour cela). L'objectif de la politique et de l'État n'est plus principalement le bien commun de l'État et de la communauté, mais l'affirmation et la protection de droits (abstraits) ou d'un régime politique.

Certes, les intérêts de l'État et la défense des démocraties libérales peuvent coïncider, comme dans l'aide apportée par Roosevelt à la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, avant même l'entrée en guerre des États-Unis [8]; mais le fait que le motif idéologique soit extériorisé et celui de la puissance dissimulé, confirme, et constitue une application sui generis, de la théorie parétienne des résidus et des dérivations, comme de l'oubli de la leçon de Thucydide [9] selon laquelle le premier déterminant de l'action politique est (la défense, la préservation, l'accroissement de) la puissance.
La preuve en a été faite, à maintes reprises, pendant la guerre froide: les États-Unis ont très souvent laissé faire, voire soutenu et eu pour alliés des régimes politiques qui n'avaient pas meilleure réputation en termes de démocratie que les régimes soviétiques, c'est-à-dire la même réputation que celle de véritables ennemis.
Un choix aussi politiquement correct qu'idéologiquement contradictoire.
En effet, les exemples cités ci-dessus démontrent le caractère essentiel de la bonne perception de l'ennemi. Si l'ennemi est perçu comme tel parce qu'il a un ordre différent, un régime politique différent ou d'autres valeurs de référence, comme la politique (et l'ordre international) est un plurivers de communautés humaines différentes, chaque peuple, auquel on reconnaît en soi le droit de se donner l'ordre qu'il préfère, devient, du seul fait de l'ampleur des différences, un ennemi. Il le devient parce que son mode d'existence politique et sociale n'est pas homogène avec celui de la (ou des) puissance(s) "dominante(s)". Il est un ennemi non pas en raison des actions qu'il accomplit (à la limite des actions qu'il peut accomplir) mais seulement parce qu'il existe d'une certaine manière: dans ce cas, les "guerres pour la démocratie" deviennent facilement le moyen de promouvoir l'homogénéisation politique, qui à son tour peut conduire non pas tant à la mondialisation (politique) qu'à la construction d'une nouvelle entité politique, impériale et non étatique, avec des règles, des formes, des types de comportement que nous ne connaissons pas encore, mais dont on entrevoit quelque chose. En particulier, on peut entrevoir la perte (partielle) de l'impénétrabilité de l'État, dont les frontières marquaient la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ordre interne et l'ordre international.
D'autre part, un tel critère de choix de l'ennemi conduit à contredire la première règle de l'action politique, qui est de réduire le nombre d'ennemis possibles. Cette règle s'est exprimée dans l'histoire de multiples façons, tant au niveau de la politique intérieure qu'internationale: de la pratique politique du Sénat romain, dont la maxime constante était de diviser les peuples [10] potentiellement ennemis (diviser pour régner), au précepte "jamais de guerre sur deux fronts" de la stratégie allemande au siècle dernier, violé à deux reprises, avec les résultats que l'on sait. Si l'on ajoute à l'ennemi réel (c'est-à-dire celui qui l'est par les actions et les contrastes de pouvoir et d'intérêts) celui (ou ceux) qui le sont par les différences d'idéaux, la règle est définitivement violée.

Les "guerres démocratiques" apparaissent ainsi comme la négation de certaines idées propres à l'État et à la politique modernes, telles qu'elles ont été définies à partir de la Renaissance, grâce à la forme particulière d'unité politique de l'époque post-médiévale, à savoir l'État, mais anticipées et en tout cas pratiquées depuis des millénaires.
C'est précisément l'État qui est la première victime de ce changement de perspective. Ses traits saillants: la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, le temporel et le spirituel, l'impénétrabilité, le monopole du politique (et de la violence légitime) sont plus ou moins contredits par la diffusion des "guerres pour la démocratie". La conséquence en est l'imposition d'un régime politique, avec ses institutions et ses valeurs de référence, d'une prétention à la perméabilité des frontières, et donc à une souveraineté limitée sur son propre territoire, où s'affrontent différents pouvoirs (de commandement). Tout cela est incompatible avec le jus publicum europaeum. Celui-ci a été fondé sur la tentative (réussie pendant des siècles) de faire vivre ensemble des peuples différents. A cela a succédé l'actuelle tentative de le faire avec des peuples (relativement et artificiellement) homogènes, au prix d'un accroissement du pouvoir "supranational".
Certes, la démocratie repose sur une certaine homogénéité des peuples, mais il s'agit là d'un présupposé, non d'une conséquence du choix du régime politique [11]; et, de toute façon, il s'agit ici de relations extérieures entre États, non de relations intérieures entre les différentes composantes d'une communauté. À moins qu'il ne s'agisse des prémisses de l'établissement d'une nouvelle forme politique impériale, dans laquelle les relations entre États sont remplacées par celles à l'intérieur de l'empire. Dans ce cas, la logique interne/externe (et autres) aurait un sens différent, qui reste à écrire.
Cependant, étant donné que les formes politiques impériales étaient (principalement) caractérisées par la répartition du jus belli entre les différents sujets de l'unité politique, il reste à voir si un avenir d'union entre des États (institutionnellement) homogènes est plus pacifique que la coexistence entre des États différents, sur laquelle reposait le jus publicum europaeum.
Notes:
[1] V. Du Pape, II, 1, trad. it. par A. Pasquali, Milan 1995, p. 155).
[2] Grundlinien der Philosophie des rechts, § 313.
[3] Ésprit des lois, X, 2, trad. it. 1965, pp. 247-248.
[4] I. Kant, Metaphysik der Sitten § 61.
[5] Voir sur ce point Jeronimo Molina Cano, La costituzione come colpo di Stato, in Behemoth n° 38, juillet-décembre 2005.
[6] La guerre du Péloponnèse, II, 35-47.
[7] Voir par exemple. Suarez De Charitate- De Bello, Sectio IV "Unde, quod quidam aiunt, supremos reges habere potestatem ad vindicandas iniurias totius orbis, est omnino falsum, et confundit omnem ordinem, et distinctionem iurisdictionum : talis enim potestas, neque a Deo data est, neque ex ratione colligitur" ; voir aussi Bellarmin maintenant dans Scritti politici, Bologne 1950, p. 260.
[8] La phrase bien connue du président, selon laquelle les États-Unis seraient "l'arsenal des démocraties", n'exprimait pas le fait que l'intérêt des États-Unis était d'aider la Grande-Bretagne et de contenir l'Allemagne et le Japon, même si les régimes politiques de ces trois puissances ne l'étaient pas.
[9] Voir la célèbre ambassade des Athéniens auprès du peuple de Mélos.
[10] V. Montesquieu Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ch. VI.
[11] La dernière tentative de former une unité politique entre musulmans et chrétiens, turcs et slaves, protestants et orthodoxes a été le Traité d'Union prévu par Gorbatchev et qui s'est terminé comme chacun sait. Nous renvoyons à ce sujet à notre article Du communisme au fédéralisme, paru dans L'Opinione - juin 1991.
18:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, guerres justes, guerres démocratiques, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 juin 2023
La tentation malsaine du "marxisme occidental"
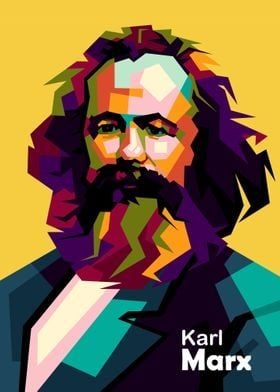
La tentation malsaine du "marxisme occidental"
par Greg Godels (*)
Source: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/25743-greg-godels-la-malsana-tentazione-del-marxismo-occidentale.html
L'histoire du marxisme trouve son reflet dans celle de l'antimarxisme - les courants intellectuels qui se présentent comme le véritable marxisme.
Avant même que le marxisme ne constitue une idéologie cohérente, Marx et Engels ont consacré une partie souvent négligée de leur Manifeste communiste de 1848 à démolir les idéologies rivales qui aspiraient à représenter le véritable socialisme.
Alors que le mouvement ouvrier s'efforçait de trouver un système de pensée susceptible d'inspirer sa réaction au capitalisme, les idées de Karl Marx et Friedrich Engels ont progressivement gagné les travailleurs, les paysans et les opprimés. Cette victoire n'a pas été facile à remporter. Le libéralisme - l'idéologie dominante de la classe capitaliste - avait aidé la lutte des ouvriers et des paysans contre la tyrannie absolutiste.
Une fois le capitalisme et les institutions libérales consolidés, l'anarchisme - l'idéologie de la petite bourgeoisie désillusionnée - a commencé à défier le marxisme pour la direction du mouvement ouvrier. Cependant, les anarchistes, qui professaient contradictoirement un individualisme extrême et une démocratie utopique dérivée du capitalisme, tout en manifestant une haine féroce pour les institutions et les structures économiques du capitalisme, n'ont pas été en mesure d'offrir une issue viable à la lourde oppression capitaliste.
Avec la prise du pouvoir par le bolchevisme en 1917, le mouvement ouvrier s'est trouvé face à un exemple de socialisme authentique et existant, dirigé par des marxistes authentiques et avoués - un puissant phare montrant la voie à suivre dans la lutte contre le capitalisme.
La victoire de la révolution russe a consolidé le rôle du marxisme en tant que voie la plus prometteuse pour la majorité des exploités, et celui du léninisme en tant que seule idéologie victorieuse pour le changement révolutionnaire et le socialisme. Aujourd'hui encore, le léninisme reste la seule voie éprouvée vers le socialisme.

Cependant, peu après la révolution, des "marxismes" rivaux sont apparus.
L'échec des révolutions européennes ultérieures en dehors de la Russie, en particulier la révolution allemande, a conduit au détachement de nombreux intellectuels, tels que Karl Korsch et György Lukács, qui ont émis l'hypothèse d'une voie différente et prétendument meilleure vers la révolution prolétarienne. Les critiques et les détracteurs du léninisme, forts du soutien matériel que leur apportaient divers bienfaiteurs, de leur nomination à l'université et de l'appui de nombreuses personnes désireuses de consommer la trahison de classe, ont ainsi commencé à se multiplier.
C'est surtout en Occident - en Amérique du Nord et en Europe - où la classe ouvrière était importante et se développait rapidement, que la dissidence, la trahison de classe et l'opportunisme sont apparus comme des forces perturbatrices au sein du mouvement communiste mondial - des forces que les classes dirigeantes capitalistes étaient heureuses de favoriser. Les jeunes, les travailleurs non qualifiés, les intellectuels en herbe et les éléments déclassés étaient particulièrement vulnérables aux sirènes de l'indépendance, de la pureté, de l'idéalisme et des valeurs libérales. L'argent, les opportunités de carrière et la célébrité étaient à la portée de ceux qui étaient prêts à vendre ce genre d'idées.
En réalité, tous les critiques du marxisme-léninisme - c'est-à-dire du communisme révolutionnaire - n'étaient pas ou ne sont pas de mauvaise foi ou sans mérite ; si nous voulons être honnêtes, nous devons cependant reconnaître qu'aucun véritable partisan du renversement du capitalisme n'a jamais pu aspirer à un rôle de premier plan, à la célébrité ou à la prédominance médiatique dans l'Occident capitaliste. Tout au plus peut-il constituer une curiosité, ou un pion exhibé pour sauver les apparences - une marionnette.
Et inversement, toute figure intellectuelle ou politique qui gagne effectivement en importance ou en influence ne peut constituer une véritable menace existentielle pour le capitalisme lorsque le chemin vers l'importance et l'influence est patrouillé par les gardiens du capitalisme.
Malgré cela, le mouvement syndical a toujours été en proie à des tendances idéologiques ou à des modes qui divisent et qui sont promues par des acteurs indépendants qui, intentionnellement ou non, se laissent exploiter par la classe capitaliste et jouent son jeu.
En Occident, il est presque impossible pour un jeune radical de résister à la tentation exercée par un véritable marché idéologique de théories prétendument anticapitalistes ou socialistes qui se disputent sa loyauté. Après la fin du socialisme réel et sans fioritures de l'Union soviétique, la désorientation de nombreux partis communistes et ouvriers a rendu cette concurrence des idées encore plus confuse.
Il est clair que le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste révolutionnaire, a besoin d'être guidé pour échapper aux distractions, aux fausses théories et aux idéologies contrefaites. Le fait que des néophytes politiques se perdent dans une galerie marchande où l'on vend des idéologies spécieuses et fantastiques est une grande tragédie, surtout lorsque ces idées sont déguisées en marxisme.
* * * *
Heureusement, une nouvelle génération de penseurs marxistes défie les sirènes du faux marxisme, en particulier ce que l'on appelle le "marxisme occidental". Un article positif de Wikipedia offre peut-être la meilleure définition que l'on puisse souhaiter de cette expression : "L'expression désigne un ensemble peu cohérent de théoriciens qui ont promu une interprétation du marxisme qui diffère autant du marxisme classique et orthodoxe que du marxisme-léninisme soviétique". La définition ne pourrait être plus claire : le marxisme occidental peut être tout sauf le marxisme-léninisme qui a animé les partis révolutionnaires des travailleurs depuis la révolution bolchevique !

Le 21 novembre 2022, l'historien et journaliste marxiste Vijay Prashad a donné un séminaire à la Marx Memorial Library au cours duquel il a fustigé le marxisme occidental des années 1980 :
À cette époque, une attaque de grande envergure a été lancée contre le marxisme, menée par l'éditeur londonien New Left Books (aujourd'hui Verso Books), qui a publié Hegemony and Socialist Strategy d'Ernesto Laclau et Chantal Mouffe en 1985. Ce livre a prodigieusement exploité les travaux d'Antonio Gramsci pour lancer une attaque contre le marxisme et promouvoir ce que les auteurs ont appelé le "post-marxisme". Post-structuralisme, post-marxisme, post-colonialisme : tel est le ton dominant de la littérature académique produite dans les pays occidentaux depuis les années 1980... Surtout depuis l'effondrement de l'Union soviétique, notre capacité à contrer ce dénigrement du marxisme mené au nom du post-marxisme s'est avérée extrêmement faible... Lorsqu'ils [Laclau et Mouffe] parlent d'"agence", de "sujet", etc., ils montrent qu'ils ont essentiellement abandonné l'héritage interprétatif de l'économie politique, revenant à une époque pré-marxiste ; en fait, ils ne sont pas allés de l'avant, au-delà du marxisme, mais en arrière, à l'époque qui a précédé le marxisme. (Viewing Decolonisation through a Marxist Lens, publié dans Communist Review, hiver 2022/2023)
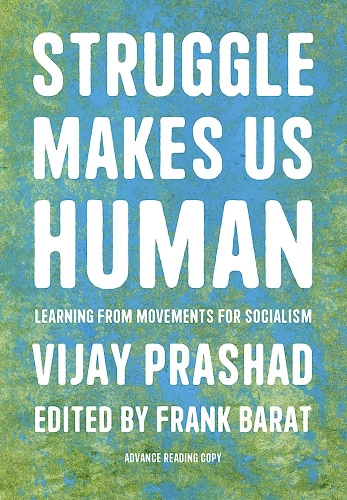


Prashad place les travaux influents de Hardt, Negri, Deleuze et Guattari dans la même veine post-marxiste.
Il dresse un bilan négatif du tournant multiculturaliste, car il a "essentiellement enlevé le mordant de la critique anticoloniale et antiraciste ; globalement, nous avons assisté à la montée de la pensée "postcoloniale" et même de la "décolonialité" - comme dans : nous examinons le pouvoir, nous examinons la culture, mais nous n'examinons pas l'économie politique qui structure la vie quotidienne et le comportement et reproduit la mentalité coloniale ; cela doit rester en dehors du débat...". C'est ainsi que nous sommes entrés dans une sorte de marécage académique dans lequel le marxisme, pour ainsi dire, n'avait pas le droit d'entrer".
Prashad aurait également pu citer l'intrusion dans le marxisme de la théorie du choix rationnel qui s'est produite dans les années 1980 - une analyse tout à fait gratuite de la théorie marxiste menée à travers le prisme de l'individualisme méthodologique et de l'égalitarisme libéral. Un représentant prestigieux de ce que l'on appelle aujourd'hui le "marxisme analytique" a entrepris de démolir le solide concept marxiste d'exploitation en "démontrant" que si l'inégalité est une condition initiale, il est logique que l'inégalité se reproduise - une déduction plutôt triviale, qui ne contribue guère à la compréhension de l'évolution historique du concept d'exploitation de la main-d'œuvre...
Prashad aurait également pu mentionner l'influence persistante exercée sur la théorie marxiste - dans les années 1980 et par la suite - par le relativisme postmoderne, qui vise à démolir complètement l'idée que le marxisme est la science de la société. Pour les postmodernes, le marxisme ne peut être au mieux qu'une interprétation rivale de la société parmi d'autres, qui a sa propre cohérence au sein des cercles marxistes, mais dont toute prétention à l'universalité est niée. Les postmodernes nient en outre la possibilité de parvenir à une théorie globale valable du capitalisme, à un "méta-récit" capable de retracer la trajectoire d'un système socio-économique. S'il n'est pas possible de souligner ici les défauts de cette théorie, on peut rappeler que la regrettée historienne marxiste Ellen Meiksins Wood a dénoncé cette tendance académique avec une grande clarté.

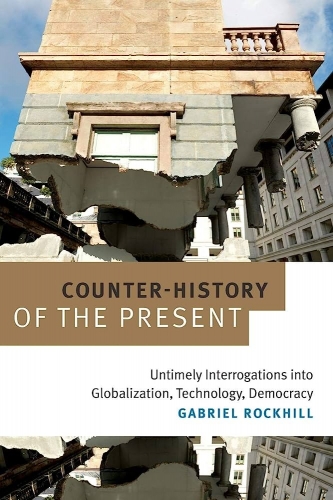
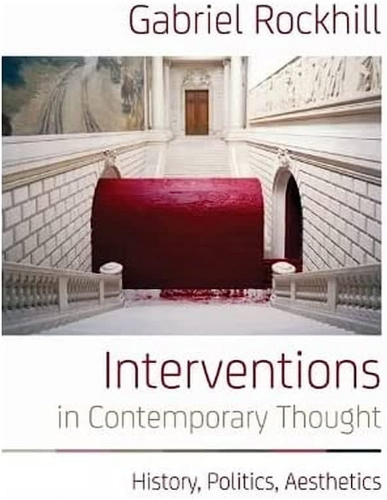
Une autre excellente critique contemporaine du marxisme occidental est offerte par les travaux de l'écrivain marxiste Gabriel Rockhill. Rockhill démolit habilement et radicalement l'école néo-marxiste de Francfort, et en particulier ses représentants les plus célèbres - Horkheimer, Habermas, Adorno et Marcuse - en démasquant ses liens avec divers sponsors. Ceux qui ont payé les factures ont obtenu des idéologies favorables en retour - un schéma que l'on retrouve souvent chez les partisans du marxisme occidental.
Rockhill démonte également sans pitié le faux marxiste le plus en vue actuellement, Slavoj Žižek. Dans un billet précédent, j'ai déjà eu le plaisir de faire l'éloge de la manière dont Rockhill a dégonflé le gigantesque ego de Žižek. Le démasquage de l'École de Francfort par Rockhill et la démolition du culte de Žižek constituent des lectures clés dans la bataille contre le marxisme occidental.
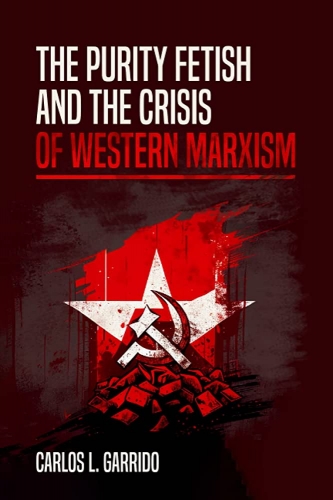
Plus récemment, le philosophe Carlos L. Garrido s'est engagé dans un duel ambitieux avec le marxisme occidental dans son livre The Purity Fetish and the Crisis of Western Marxism, Midwestern Marx Publishing Press, 2023. L'argument central de Garrido est l'idée qu'au cœur de l'attaque des marxistes occidentaux contre le marxisme-léninisme se trouve un "fétichisme de la pureté". Cette thèse pointue et originale encadre efficacement un trait commun à toutes les stars de l'anticommunisme de gauche occidental : de Friedrich Ebert à Slavoj Žižek, tous ces "marxistes" ont hypocritement insisté sur le fait que les révolutionnaires sont tenus d'adopter des normes de gouvernance démocratique, de perfection judiciaire, de non-violence et de perfection politique supérieures à toute réalité existant dans la société bourgeoise ou raisonnablement réalisable dans une société révolutionnaire qui ne soit pas purement fantaisiste.
Les marxistes occidentaux n'ont aucune difficulté à passer sous silence l'histoire criminelle du capitalisme en matière de génocide, de déni de démocratie et d'exploitation, tout en reprochant aux partisans de Fidel d'avoir réglé leurs comptes avec quelques centaines de tortionnaires de Batista. Ils déplorent les grands changements introduits par les communistes soviétiques et chinois dans l'agriculture pour éviter les famines fréquentes qui ravageaient leurs pays, au motif que ces changements ont malheureusement coïncidé avec de graves famines - comme si les grands changements positifs étaient capables d'échapper aux catastrophes naturelles, ce qui ne peut se produire que dans leur imagination.
Ils ferment les yeux sur les coûts humains imposés à l'humanité par la résistance des élites dirigeantes aux grands changements, tout en dénonçant les révolutionnaires qui aspirent à ces changements et osent œuvrer pour un avenir meilleur. Le marxisme occidental minimise les grands succès obtenus par le socialisme réel, tout en dénonçant sans relâche les erreurs commises dans la construction du socialisme. Garrido met clairement en évidence les erreurs et les souffrances qu'implique inévitablement la construction d'un monde nouveau, libéré des griffes impitoyables du capitalisme.

L'auteur observe :
C'est le genre de "marxisme" que l'impérialisme aime - ce que l'agent de la CIA Thomas Braden appelait "la gauche compatible". C'est ce "marxisme" qui sert d'avant-garde à une contre-hégémonie contrôlée.
Le résumé est donc éloquent :
Pour les marxistes occidentaux, le socialisme est, pour citer Marx, une question purement académique. Ils ne s'intéressent pas à la lutte réelle, au changement du monde, mais à la purification incessante d'une idée, destinée à être débattue par d'autres marxistes enfermés dans leur tour d'ivoire et à servir d'étalon pour évaluer le monde réel. L'étiquette "socialiste" ou "marxiste" est simplement utilisée comme une identité contre-culturelle et "branchée", reléguée en marge de la société réelle. C'est à cela que se réduit le marxisme en Occident : une identité individuelle.
J'ajouterais qu'une autre tendance typique des marxistes occidentaux est d'investir massivement dans le socialisme des autres. Au lieu de se référer à la classe ouvrière de leur propre pays, les marxistes occidentaux s'engagent dans des luttes "ersatz" pour le socialisme par le biais de mouvements de solidarité, en choisissant les batailles les plus "pures" et en discutant par procuration des mérites des différents socialismes.
Garrido approfondit le thème du "socialisme en tant qu'investissement identitaire" :
- Dans le contexte du traitement hyper-individualiste du socialisme en tant qu'identité personnelle mis en œuvre en Occident, la pire chose qui puisse arriver à ces "socialistes" serait, précisément, la réalisation du socialisme. Elle impliquerait en effet la destruction totale de leur identité marginale et contre-culturelle. Leur aliénation absolue des masses laborieuses de leurs pays peut être interprétée en partie comme une tentative de rendre les idéaux socialistes si marginaux qu'ils ne pourront jamais conquérir les travailleurs - et par conséquent ne pourront jamais conquérir le pouvoir politique.
- La victoire du socialisme entraînerait une perte d'individualité, une destruction de l'identité du socialiste au sein du capitalisme. Le socialisme occidental est fondé sur une identité qui déteste l'ordre existant, mais qui déteste encore plus la perte d'identité qu'impliquerait le dépassement de cet ordre.
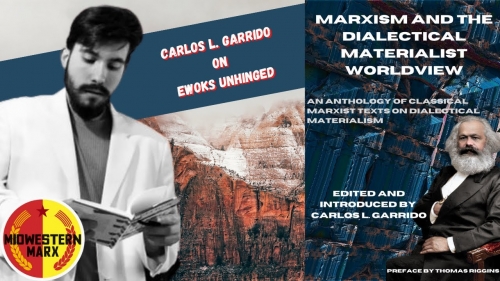
Garrido ne se contente pas de disséquer magistralement le marxisme occidental. En effet, il consacre également beaucoup d'attention à la critique du marxisme occidental à l'égard de la République populaire de Chine dans un chapitre intitulé "La Chine et le fétichisme de la pureté du marxisme occidental". Bien entendu, il a raison de déplorer la collaboration sans scrupules du marxisme occidental avec les idéologues bourgeois pour condamner toutes les politiques et initiatives mises en œuvre par la Chine populaire depuis la révolution de 1949. Comme dans le cas de l'URSS, toute évaluation honnête et raisonnée de la trajectoire de la Chine populaire ne peut que voir en elle - avec toutes ses limites - une étape positive dans le voyage de l'humanité vers le nécessaire dépassement du capitalisme.
En tant qu'anti-impérialistes, nous devons défendre le droit de la République populaire de Chine (et d'autres pays) à choisir sa propre voie.
Et en tant que marxistes, nous devons défendre le droit du parti communiste chinois à choisir sa propre voie vers le socialisme.
Cependant, Garrido va plus loin en se lançant dans une apologie passionnée mais partiale du socialisme chinois. Pour un partisan radical de la méthode dialectique, il s'agit là d'un curieux dérapage. Comme le souligne le prestigieux marxiste R. Palme Dutt, la question essentielle pour un matérialiste dialectique est "Où va la Chine ?", et non "La République populaire de Chine coïncide-t-elle ou non avec une forme pure et platonicienne de socialisme ?
Une évaluation plus équilibrée de la République populaire de Chine devrait tenir compte de l'importance de la base du Parti communiste, essentiellement composée de paysans, à l'époque de sa fondation, de sa relation avec le nationalisme chinois et des fortes tendances volontaristes qui caractérisent la pensée de Mao Zedong. Elle devrait tenir compte de la fracture qui s'est ouverte dans les années 1960 au sein du mouvement communiste mondial et du rapprochement de la Chine avec les éléments les plus réactionnaires du pouvoir américain dans les années 1970, couronné par l'aide matérielle honteuse apportée aux marionnettes américaines et sud-africaines pendant les guerres de libération de l'Afrique du Sud. La Chine populaire a financé Jonas Savimbi et l'UNITA pendant que des internationalistes cubains mouraient en les combattant, eux et leurs alliés de l'apartheid. Ce qui soulève la question suivante : la Chine populaire pourrait-elle faire davantage pour aider Cuba à faire face au blocus imposé par les États-Unis, comme l'Union soviétique l'a fait dans le passé ?
Une évaluation honnête devrait inclure l'invasion du Viêt Nam par la Chine populaire en 1979 et sa défense inconditionnelle des Khmers rouges. Tous ces éléments ne peuvent manquer d'avoir une incidence sur l'évaluation de la voie chinoise vers le socialisme.
Ces réalités inconfortables font qu'il est difficile de souscrire à l'affirmation de Garrido selon laquelle la République populaire de Chine a été "un phare dans la lutte anti-impérialiste".
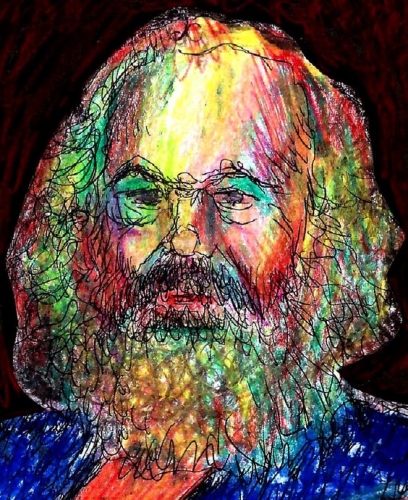
Aujourd'hui, bien sûr, la situation est tout à fait différente. Mon opinion personnelle est que les dirigeants du parti communiste chinois - pour reprendre une image typique du maoïsme classique - "chevauchent le tigre" d'un important secteur capitaliste. On peut débattre de la qualité de leur action, mais elle n'en est pas moins efficace. Il y a de nombreux signes prometteurs, mais aussi des signes inquiétants.
Quoi qu'il en soit, les camarades critiques ou sceptiques à l'égard de la voie chinoise ne méritent pas d'être sommairement jetés dans la poubelle du marxisme occidental.
Là où Garrido fait mouche avec son "fétichisme de la pureté", c'est dans son analyse de l'organisation socialiste aux États-Unis. L'auteur jette un regard critique sur le caractère de classe d'une grande partie de la gauche américaine, en soulignant sa matrice petite-bourgeoise et l'influence des idées petites-bourgeoises. Il identifie les vecteurs de ces idées dans le monde universitaire, les médias et les ONG. L'idéologie petite-bourgeoise trouve un soutien supplémentaire dans les entreprises à but non lucratif et, bien sûr, dans le parti démocrate.
La tendance petite-bourgeoise de la gauche américaine renforce son attitude hypercritique à l'égard des mouvements qui tentent de construire concrètement un avenir socialiste. Chaque fois que les socialistes ou les radicaux d'orientation socialiste sont confrontés aux énormes obstacles auxquels ils sont confrontés, de nombreux gauchistes les accusent d'être liés à des idéaux libéraux chevaleresques qui sont aussi irréalistes que garants d'échec. Garrido ridiculise l'insistance sur la pureté révolutionnaire : "...le problème est que les choses, dans le monde réel appelées socialisme, n'étaient pas vraiment du socialisme ; le socialisme en réalité est cette idée merveilleuse qui existe sous sa forme pure dans mon esprit...".
Le fétichisme de la pureté des classes moyennes infecte les radicaux qui méprisent les travailleurs en les qualifiant d'"arriérés" ou de "misérables". Garrido contrecarre cette obsession de la pureté en recourant à une magnifique citation de Lénine : "Nous pouvons (et devons) commencer à construire le socialisme non pas avec un matériel humain fantastique, spécialement créé, mais avec le matériel que le capitalisme nous a légué".
Sur la question du vote de la classe ouvrière en faveur de Trump, Garrido n'écarte pas la gauche américaine : ...elle ne réalise pas qu'implicitement, dans ce vote, il y a un désir de quelque chose de nouveau, quelque chose que seul le mouvement socialiste pourrait offrir - certainement pas Trump ou un quelconque parti bourgeois. Au contraire, il ne voit dans ce bloc de la classe ouvrière rien de plus qu'une masse de racistes, une menace "fasciste" qui ne peut être vaincue qu'en renonçant à la lutte des classes et en rejoignant les démocrates. Aussi stupide que cela puisse paraître, c'est la ligne qui domine le mouvement communiste contemporain aux États-Unis.
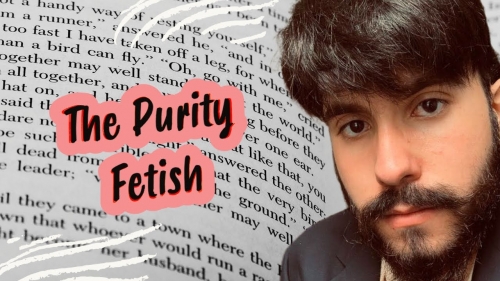
Tous les gauchistes ne peuvent être blâmés pour cet échec, mais l'accusation fait mouche.
Enfin, Garrido critique la tendance d'une grande partie de la gauche américaine à rejeter sans appel toutes les tendances progressistes et les succès qui ont marqué l'histoire des États-Unis. De nombreux membres de la gauche minimisent les luttes héroïques menées tout au long de l'histoire des États-Unis en la dépeignant comme une succession ininterrompue de réaction, de racisme et d'impérialisme. Garrido met le doigt sur le problème lorsqu'il voit dans cette tendance un exemple de fétichisme de la pureté dans le négatif - en dénonçant chaque page de l'histoire américaine comme étant désespérément en faillite et bidon, "...les marxistes fétichistes de la pureté augmentent encore leur manque de pertinence dans la création des conditions subjectives de la révolution en s'isolant complètement des traditions que les masses américaines ont fini par s'approprier".
C'est sans doute vrai, mais il faut rappeler qu'il y a toujours un risque que l'histoire américaine soit célébrée avec tant d'ardeur que l'ardeur patriotique finisse par éclipser l'héritage de cruauté et de carnage sanglant qui pèse sur ce pays. Par exemple, à l'époque du Front populaire, le slogan "Le communisme est l'américanisme du 20ème siècle" promu par le dirigeant communiste Earl Browder signalait un surinvestissement dans l'américanisme en termes de justice sociale et un sous-investissement dans le communisme.
L'histoire et la tradition des États-Unis sont contradictoires, et un marxiste devrait toujours souligner cette contradiction - un héritage composé de changements sociaux grandioses et historiques et, en même temps, d'actes horribles et inhumains. Les origines de ce pays partagent un passé tragique de colonialisme et de colonisation avec des pays comme l'Australie et l'Afrique du Sud, en termes de génocides perpétrés contre les peuples indigènes. Les colons eux-mêmes ont introduit ou toléré l'exploitation brutale des Africains réduits en esclavage. Nous pouvons blâmer la classe dirigeante américaine, mais l'histoire des États-Unis est aussi faite de cela.
En même temps, la révolution américaine a été la plus radicale de son temps, et chaque génération successive a engendré un mouvement qui aspirait à corriger les erreurs du passé ou à élargir les horizons du progrès social. L'histoire du peuple américain est marquée par une guerre civile pour l'émancipation, l'élargissement du droit de vote, les conquêtes des travailleurs contre les entreprises, l'État-providence, les retraites et une myriade d'autres jalons.
En réfléchissant et en écrivant sur le bicentenaire de la Révolution française (Echoes of the Marseillaise), l'historien marxiste Eric Hobsbawm n'a pu s'empêcher d'être frappé par le peu d'influence que la Révolution américaine a eu globalement sur les changements sociaux du 19ème siècle. Selon lui, les réformateurs et révolutionnaires de l'époque étaient plus enclins à voir un point de départ "dans l'Ancien Régime français que dans les colons libres et les esclavagistes d'Amérique du Nord". Il ne fait aucun doute que la tache représentée par le génocide des peuples indigènes et l'esclavage brutal a influé sur cette attitude.

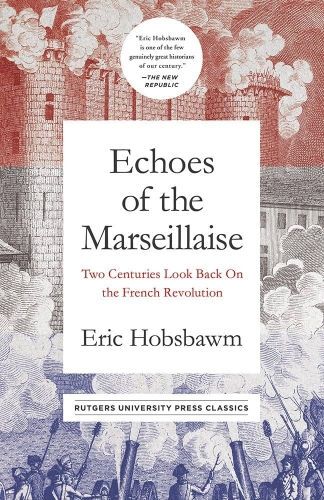
Les remarques de Hobsbawm soulignent en effet le caractère contradictoire du passé américain. Ce jugement ne dépend pas d'un "fétichisme de la pureté", mais de la réalité concrète et factuelle de l'histoire américaine.
Malgré cela, Garrido a raison de rappeler les nombreux révolutionnaires - Marx, Lénine, Mao, Ho Chi Minh, William Z Foster, Herbert Aptheker, Fidel et d'autres - qui se sont inspirés (et ont transmis) les victoires populaires et la résistance acharnée contre l'oppression des classes dominantes qui ont marqué l'histoire américaine. À cet égard, il cite à juste titre le rejet par le dirigeant communiste Georgi Dimitrov du nihilisme national, qui consiste à dénigrer toute manifestation de fierté et de réussite nationales. Chaque identité nationale contient en son sein une identité qui mérite d'être célébrée dans la mesure où elle résiste à l'oppression et lutte pour une vie meilleure. Les travailleurs doivent apprendre l'humilité nationale à partir des échecs passés et, en même temps, tirer une fierté nationale des victoires contre l'injustice. Une gauche qui n'accomplit qu'une seule de ces deux tâches, et non les deux, ne sera pas en mesure de gagner la classe ouvrière.
*
Le marxisme occidental - un marxisme scolaire, déconnecté de la pratique révolutionnaire - égare trop de compagnons de route potentiels, sincères et avides de changement, sur le chemin ardu du socialisme. Il est rafraîchissant d'entendre des voix s'élever pour dénoncer la nature stérile et obscurantiste de cette tromperie, tout en défendant la tradition du marxisme-léninisme et du communisme. Nous devons encourager et soutenir des marxistes comme Prashad, Rockhill et Garrido dans cette bataille.
(*) zzs-blg.blogspot.com
17:09 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marxisme, marxisme occidental, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique, vijay pashad, gabriel rockhill, carlos l. garrido |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 17 juin 2023
L'esthétique de la guerre dans la pensée de Giovanni Gentile et de Carl Schmitt

L'esthétique de la guerre dans la pensée de Giovanni Gentile et de Carl Schmitt
par Flaminia Incecchi
(2018)
Source: https://legio-victrix.blogspot.com/2019/11/flaminia-incecchi-estetica-da-guerra-no.html
Introduction [1]
Cette note de recherche est une version préliminaire de ma recherche doctorale. Elle a pour objectif d'établir un dialogue entre Giovanni Gentile (1875-1944) et Carl Schmitt (1888-1985). Le dialogue que je souhaite présenter repose sur plusieurs points communs entre les deux penseurs, à la fois biographiques et intellectuels. Schmitt et Gentile ont tous deux été impliqués dans les régimes national-socialiste et fasciste, Schmitt en tant que juriste et Gentile en tant que réformateur et ministre de l'éducation. Sur le plan intellectuel, ils partagent plusieurs traits : affiliations et intérêts théoriques, ainsi que leurs critiques d'approches et de traditions similaires. Les deux penseurs mettent l'accent sur le concret et s'intéressent à l'histoire conceptuelle. Bien que pour des raisons différentes, Schmitt et Gentile ont vivement critiqué le positivisme, le libéralisme, le mécanisme, toutes les théories qui adoptent une approche intellectualiste (transcendantale) de la politique et du droit (Schmitt), ainsi que de la philosophie (Gentile). Le dialogue conduit à une comparaison de leurs interprétations de la guerre, que j'analyse à travers un cadre offert par l'esthétique. Dans ce qui suit, je présente brièvement Gentile, puis j'ébauche ma lecture des interprétations de la guerre de Schmitt et de Gentile, et les points sur lesquels je m'oriente dans leur utilisation de l'esthétique.
Commentaires introductifs
 Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).
Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).
L'œuvre de Jaja s'inspire des études hégéliennes italiennes de la période du Risorgimento, en particulier celles de Bertrando Spaventa, un penseur pratiquement inconnu qui a tenté de réformer la dialectique hégélienne, tout en cherchant à utiliser la pensée de Hegel comme un manuel pour le programme politique italien (Piccone, 1977, p. 51).
Lorsque Gentile a commencé ses études universitaires, des personnalités comme Jaja étaient marginales dans le paysage intellectuel du début du siècle. Grâce à la domination hégémonique du positivisme en philosophie, le discours s'attachait principalement à mettre en évidence et à favoriser les liens entre les méthodes philosophiques et scientifiques, en marginalisant la métaphysique et surtout l'idéalisme.

En 1896, Gentile a entamé une correspondance avec Benedetto Croce, qui était à l'époque une jeune voix dissidente et couronnée de succès sur la scène intellectuelle. Gentile lit plusieurs articles dans lesquels Croce critique la méthodologie historique du positivisme [2]. La relation Croce-Gentile donnera naissance au mouvement néo-idéaliste, qui occupera la scène intellectuelle italienne pendant près d'un demi-siècle.
Bien que Gentile soit principalement connu pour son engagement politique et sa contribution à la philosophie, son œuvre reflète son parcours intellectuel. Ses œuvres sont une combinaison d'histoire conceptuelle et culturelle, de philosophie (métaphysique, esthétique, éthique), de philosophie du droit, de philosophie de l'histoire, de philosophie de l'éducation (pédagogie) et de philosophie politique. La carrière intellectuelle extrêmement prolifique de Gentile a commencé en 1896 et s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son assassinat en 1944. Le corpus de Gentile comprend plus de 50 volumes [3].
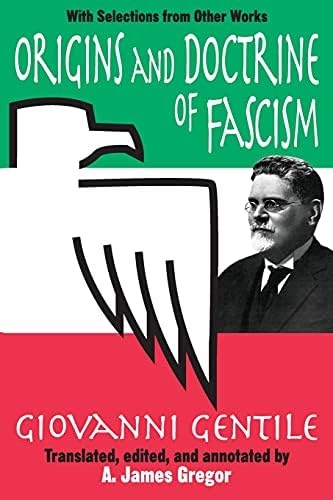 En dehors du monde universitaire, l'engagement politique de Gentile était fondamentalement orienté vers la culture. Sous le régime fasciste, il a été ministre de l'éducation (1922-1924) et a entièrement réformé le système éducatif italien. Au cours de cette période, il a également écrit plusieurs articles pro-fascistes, ainsi que Origines et doctrine du fascisme (1928), un texte exposant la philosophie du fascisme. Pour ces activités, Gentile est toujours soumis à la damnatio memoriae, son rôle d'idéologue du fascisme, une "tache" difficilement oubliable, ternissant son nom jusqu'à aujourd'hui. En conséquence, les contributions intellectuelles de Gentile sont aujourd'hui essentiellement négligées dans tous les domaines où il a été actif.
En dehors du monde universitaire, l'engagement politique de Gentile était fondamentalement orienté vers la culture. Sous le régime fasciste, il a été ministre de l'éducation (1922-1924) et a entièrement réformé le système éducatif italien. Au cours de cette période, il a également écrit plusieurs articles pro-fascistes, ainsi que Origines et doctrine du fascisme (1928), un texte exposant la philosophie du fascisme. Pour ces activités, Gentile est toujours soumis à la damnatio memoriae, son rôle d'idéologue du fascisme, une "tache" difficilement oubliable, ternissant son nom jusqu'à aujourd'hui. En conséquence, les contributions intellectuelles de Gentile sont aujourd'hui essentiellement négligées dans tous les domaines où il a été actif.
Seuls quelques textes de Gentile sont disponibles dans d'autres langues [4], et à la lumière de la négligence des sources primaires, il n'est pas surprenant que les études sur Gentile soient peu nombreuses. La plupart des ouvrages récents visent à réintroduire sa pensée, ou plus précisément à sortir Gentile de l'oubli dans lequel il se trouve actuellement. Malgré l'étendue et la richesse de sa pensée, ainsi que son influence sur Collingwood, Gramsci et Croce, Gentile n'a pas encore été redécouvert.
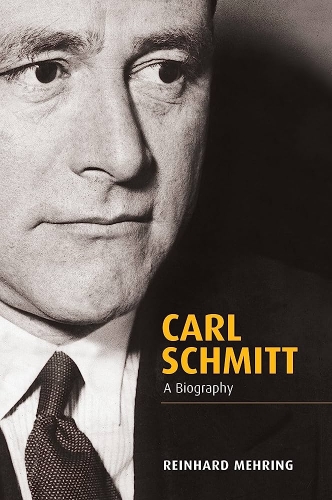
Le destin de Schmitt aujourd'hui ne pourrait être plus différent: nous disposons de deux biographies (Bendersky, 1983 ; Mehring, 2014) ainsi que d'une biographie intellectuelle (Balakrishnan, 2002). Dans Controverses on Carl Schmitt : A Review of Recent Literature, Caldwell (2005) écrit: "The authors of the books under review here variously view him as an Eighteenth-century liberal, a fascist in the Italian line, as a revolutionary conservative, as a critic of Marx, as an anti-Semite, and as a brilliant theorist of democracy" ("Les auteurs des livres recencés ici présentent une variété de points de vue quant à Schmitt, le percevant tour à tour comme un libéral du 18ème siècle, un fasciste selon la ligne italienne, un révolutionnaire conservateur, un critique de Marx, un antisémite et un théoricien brillant de la démocratie") (p. 357).
Ce passage révèle la grande variété des lectures de l'œuvre de Schmitt et ne rend pas compte de la multiplicité des articles traitant des comparaisons entre Schmitt et d'autres penseurs, des tentatives d'utilisation de la pensée de Schmitt aujourd'hui et des efforts de la gauche pour utiliser Schmitt comme critique de la démocratie libérale, ainsi que de la réception de la pensée de Schmitt dans différentes parties du monde. Cela montre qu'en dépit de la nature controversée du personnage de Schmitt et de certaines de ses idées, Schmitt est aujourd'hui pleinement accepté dans les cercles académiques.
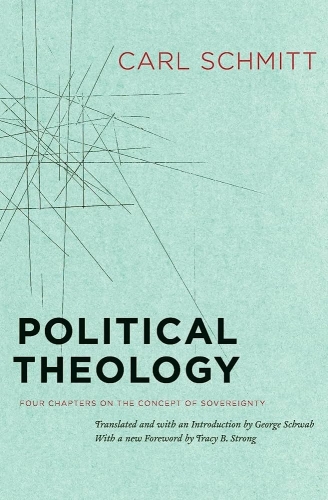
Un projet de dialogue entre Schmitt et Gentile est un exercice nouveau dans les milieux universitaires anglo-américains et italiens. A ma connaissance, le seul ouvrage dans lequel Schmitt et Gentile apparaissent dans le même paragraphe est un article co-écrit par Lacoue-Labarthe et Nancy (1990), ils écrivent: "Il faudrait ici montrer rigoureusement quels types de rapports l'idéologie, ainsi conçue comme Weltanschauung totale, entretient avec ce qu'Arendt appelle la "domination totale" (OT, p. 436), c'est-à-dire avec ce que Carl Schmitt - s'appuyant ici à la fois sur l'autorité du discours proprement fasciste (celui de Mussolini et de Giovanni Gentile) et sur le concept jüngerien de "mobilisation totale" (qui a fourni une première définition de la technique comme puissance mondiale totale) - appelle l'État total" (p. 293).
Malheureusement, rien ne prouve que Schmitt ait lu Gentile, et Lacoue-Labarthe et Nancy ne fournissent aucune référence indiquant le contraire. L'objectif de cette recherche est de simuler un dialogue entre Schmitt et Gentile, en mettant en lumière les similitudes et les connexions entre les deux. Ce faisant, ce projet comble plusieurs lacunes académiques. Premièrement, il contribue aux études sur Schmitt en fournissant une enquête sur son approche de la guerre et en l'explorant à travers une lentille esthétique. Deuxièmement, il met en lumière la profondeur de la pensée de Gentile, tant politique que philosophique. Enfin, dans le domaine de l'esthétique, il montre comment un concept (la guerre) peut conserver un qualificatif esthétique.
Il existe des différences disciplinaires entre Schmitt et Gentile, qui se traduisent dans les domaines auxquels ils ont contribué, ainsi que dans le mode de théorisation qu'ils emploient. Gentile, par exemple, n'a apporté aucune contribution à la théorie politique, tandis que les écrits de Schmitt n'ont jamais atteint la complexité et la rigueur philosophiques de ceux de Gentile. Malgré la nature et la portée distinctes de leurs contributions intellectuelles, Gentile et Schmitt partagent en fait certains fondements théoriques communs. L'un de ces points communs est l'accent mis sur le concret. À plusieurs reprises, Schmitt expose l'inefficacité d'une vision "scientifique" des concepts et suggère une approche concrète de leur analyse. La position philosophique de Gentile est la formulation d'un type d'idéalisme - idéalisme réel ou spiritualisme absolu - qui vise à réfuter le transcendantalisme des courants philosophiques précédents. Pour Gentile (1912), le positivisme, l'intellectualisme et les formes antérieures d'idéalisme impliquent l'existence d'une réalité antérieure à la pensée (p. 232). Cette réalité n'est pas touchée par la pensée humaine, qui ne joue qu'un rôle périphérique dans ces perspectives métaphysiques. Le rôle de la pensée dans ces perspectives est périphérique, elle est un "spectateur" plutôt qu'un "acteur", parce qu'elle reflète simplement ce qui a déjà été délimité (que ce soit par l'esprit de Dieu, les lois de la nature, ou la nécessité et la fatalité) (Gentile, 1922, p.6). Cette forme de pensée, Gentile (1922) la qualifie d'"abstraite" (43). À cela, il juxtapose les "pensées concrètes" - à savoir la pensée capable de façonner la réalité, avant laquelle rien n'existe (Gentile, 1922, p. 4). Le centre du système philosophique de Gentile est donc la pensée humaine et concrète. Le rôle central joué par la pensée concrète chez Gentile explique sa réfutation de toute théorie qui réduit les initiatives humaines (politiques, juridiques, historiques et philosophiques) à des mécanismes. Bien que de manière différente, Schmitt et Gentile théorisent avec une attention particulière au concret, ce qui les conduit à rechercher les origines, les définitions et les métamorphoses des concepts. Il y a donc un sens dans lequel Schmitt et Gentile sont tous deux concernés par l'idée de "rupture". La rupture de Schmitt est la foi en l'exception, et la rupture de Gentile est le sens dans lequel l'esprit humain peut - et doit - être situé au centre des discussions théoriques, brisant ainsi un discours qui, depuis son origine, soutenait l'existence d'une entité antérieure à la pensée.
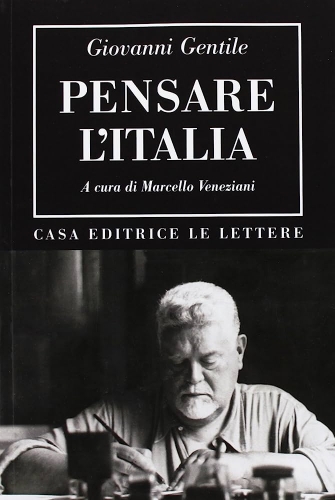
Schmitt et Gentile sur la guerre
Un lecteur de Schmitt pourrait remarquer que sa pensée et, par conséquent, sa plume, semblent avoir deux visages. D'une part, nous sommes confrontés au Schmitt juriste, dont la prose analytique et synthétique est essentiellement orientée vers l'ordre et la politique étatique. D'autre part, nous rencontrons parfois une autre plume, qui semble abandonner momentanément la normativité de l'ordre qui caractérise son œuvre, au profit de tendances décisionnistes et quasi-irrationalistes, ainsi que d'une forme de foi en l'extraordinaire. Ce Schmitt abandonne le style lapidaire et froid au profit d'une prose métaphorique, obscure et parfois prophétique.
Dans ce projet, je souhaite montrer que les deux visages de Schmitt sont liés à sa profonde fascination pour la guerre. Dans La notion du politique (Schmitt, 1996, pp. 25-26), Schmitt explique à ses lecteurs qu'une définition du politique ne peut être donnée que si nous découvrons les "catégories politiques spécifiques". Celles-ci doivent être indépendantes des autres catégories d'activités humaines, telles que l'éthique, l'esthétique, etc. Pour Schmitt (1996), "la distinction politique spécifique à laquelle les actions et les motivations politiques peuvent être réduites est celle entre l'ami et l'ennemi" (26). Or, contrairement à d'autres antithèses (le beau et le laid en esthétique, le bien et le mal en éthique), seule la politique possède le "degré maximal d'intensité", ce qui signifie que "l'ennemi politique [...] est existentiellement quelque chose de différent, d'étranger et de divergeant". ("est existentiellement quelque chose de différent et d'étranger, de sorte que, dans le cas extrême, des conflits avec lui sont possibles") (p. 27). Le politique est donc la seule antithèse qui puisse conduire à un combat justifié, car l'ennemi menace notre existence et notre mode de vie. Ainsi, la distinction politique (ami/ennemi) implique essentiellement la possibilité de la guerre.

Deux passages de la Notion méritent d'être cités pour comprendre l'approche de la guerre par Schmitt. Le premier passage indique que la guerre est le résultat des antithèses politiques entre l'ami et l'ennemi: "La guerre découle de l'inimitié. La guerre procède de la négation existentielle de l'ennemi. Elle est la conséquence la plus extrême de l'inimitié. Elle ne doit pas être commune, normale, idéale ou souhaitable. Mais elle doit rester, néanmoins, une possibilité réelle tant que le concept d'ennemi reste valide (33)".
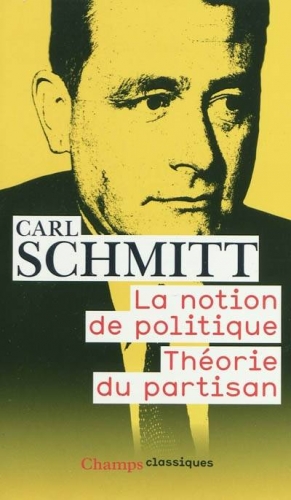
Le second passage développe la fonction de la guerre en tant que négation existentielle de l'ennemi et souligne le fait que la guerre n'est justifiable que dans la situation extrême de l'inimitié et à travers l'antithèse politique: "Il n'existe aucune finalité rationnelle, aucune norme aussi vraie soit-elle, aucun programme aussi exemplaire soit-il, aucun idéal social aussi beau soit-il, aucune légitimité, aucune légalité qui puisse justifier le massacre d'hommes par des hommes pour cette raison. Si la destruction physique d'une vie humaine n'est pas motivée par une menace existentielle sur le mode de vie, alors elle ne peut être justifiée (49)".
Schmitt réitère ici indirectement l'argument précédent selon lequel la distinction politique est la seule antithèse ou le seul motif qui motive légitimement le combat. Ces passages nous permettent de conclure, à juste titre, que Schmitt n'exalte ni n'encourage la guerre. En outre, il semble fournir une raison pour une guerre défensive plutôt qu'offensive, dans la mesure où le combat n'est justifié que dans le cas d'une négation existentielle.
En outre, dans La notion, il semble que la guerre représente un test final de la foi en l'entité politique et de sa validité. Schmitt nous dit que l'État est l'entité politique par excellence, parce qu'il est le seul à posséder "la possibilité réelle de décider dans une situation concrète de qui est l'ennemi et la capacité de le combattre avec le pouvoir émanant de l'entité" (45). En outre, le jus belli, pour Schmitt, "implique une double possibilité : le droit d'exiger de ses propres membres qu'ils soient prêts à mourir et à tuer des ennemis sans hésitation" (46).
Dans ce même texte, Schmitt rappelle également que si une autre entité décide de la distinction politique, alors cette entité deviendra l'entité politique, remplaçant l'Etat précisément parce que la nouvelle entité détient le pouvoir de décision. Cette mention de la décision politique nous amène au traitement de l'état d'exception par Schmitt. Dans Théologie politique, Schmitt (2006) écrit: "Dans l'exception, la puissance de la vie réelle perce la croûte d'un mécanisme rendu torpide par la répétition" (5). Ensuite, Schmitt (2006) affirme que "tous les concepts pertinents de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés... l'exception dans la jurisprudence est analogue au miracle dans la théologie" (36).
Les passages de La notion du politique et de Théologie politique montrent les deux Schmitt que j'ai illustrés plus haut. Alors que dans le premier texte, la guerre fait l'objet d'un traitement systématique et froid et est mentionnée parce qu'elle fait partie d'un phénomène inévitable, celui qu'est la distinction politique ami/ennemi, le second texte nous présente une image différente. L'approche de la situation extrême dans Théologie politique est agrémentée d'une métaphore puissante, qui donne au lecteur l'impression que Schmitt souhaite presque que l'état d'exception se matérialise.
L'agere nécessaire dans l'état d'exception semble mettre en échec le deliberare infinido libéral. A première vue, l'assimilation de l'exception à un miracle semble indiquer la matérialisation de l'exception en tant que miracle. Dans ce cas, nous lirions la matérialisation d'un miracle comme quelque chose de souhaitable, fruit de la Providence. Ce mouvement interprétatif, typique de la lecture majoritaire de Schmitt comme penseur irrationaliste dans l'esprit duquel les germes du nazisme ont toujours existé, n'est pas la seule lecture disponible.

La définition du miracle donnée par David Hume ouvre la voie à une seconde interprétation. Selon Hume, un "miracle est une violation des lois de la nature" (Hume, 2007, p.83). Le miracle est ainsi présenté comme une suspension temporelle des lois de la nature, tout comme l'exception exige une suspension temporelle des lois de l'État. Ce qui advient après un miracle et après une exception est la même chose: la normalité et l'ordre. Après avoir traité l'exception, l'État revient à son fonctionnement normal. A mon sens, la lecture de l'exception par Schmitt ne pourrait être plus éloignée du diagnostic benjaminien qu'Agamben fait de notre monde politique, où l'état d'exception serait devenu un paradigme de gouvernement (Agamben, 2005, p. 6-7).
Pour Schmitt, il s'agit de faire en sorte que nos structures politiques et juridiques puissent réagir de manière appropriée et opportune à l'état d'exception. Le fait que l'état d'exception ne puisse pas être codifié fait partie de sa nature, caractérisée par sa propre exceptionnalité qui le place en dehors du paradigme des règles établies. L'interprétation que j'ai proposée vise à montrer que Schmitt, loin de prôner un état d'exception perpétuel, a foi en ce moment en raison du pouvoir miraculeux dont il est porteur. Grâce à ce pouvoir, l'exception devient plus intéressante que la règle. Ainsi, même s'il n'est pas un défenseur de l'exception, Schmitt est fasciné par son pouvoir car face à l'exception, les désirs du libéralisme de l'effacer révèlent son insuffisance.
Pour Schmitt, la guerre ne serait jamais le point de la politique, "mais en tant que possibilité perpétuellement présente, elle est le présupposé principal qui détermine de manière caractéristique l'action et la pensée humaines et crée ainsi un comportement spécifiquement politique " (Schmitt, 1996, p. 34). Son affirmation descriptive selon laquelle la guerre pourrait se matérialiser, associée à l'affirmation normative selon laquelle elle ne devrait pas se matérialiser, est d'une importance vitale dans mon analyse de Schmitt en tant que penseur d'ordre. En affirmant que la guerre est une possibilité logique perpétuelle résultant d'une distinction politique nécessairement inévitable, Schmitt fournit un argument modal. Je veux dire par là que Schmitt souligne la possibilité que le conflit découle d'une condition nécessaire du monde politique. En reconnaissant cette situation de fait, Schmitt comprend alors que la guerre est un moment révélateur à plusieurs égards. Premièrement, la volonté de mourir est un aspect crucial du politique: "Si on lui ordonne d'aller à la guerre, l'agent schmittien obéira parce que sa fin ultime est la préservation de l'entité politique à laquelle il appartient" (Slomp, 2009, p. 164). Si l'État n'est plus en mesure de faire la distinction ami/ennemi, il se désintégrera et succombera devant une véritable entité politique émergeant d'ailleurs.
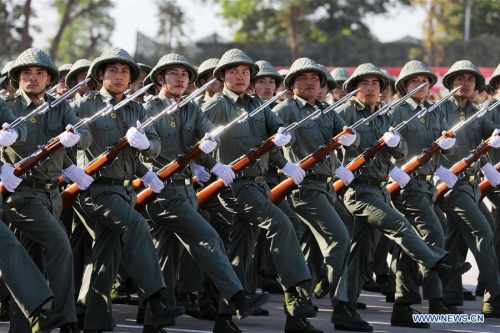
Par conséquent, au moment de la guerre, ou de la possibilité perpétuelle de guerre, la question de l'appartenance est fondamentale. Pour parler crûment, un agent ne risquera pas sa vie pour une entité politique dont il ne se sent pas membre, révélant ainsi sa loyauté envers un groupe politique. Ce fait (ou plutôt, le lieu des loyautés) ne se manifestera que dans l'antagonisme le plus extrême. Dans ma lecture de Schmitt, la question de la guerre est une question extrême mais révélatrice. Deuxièmement, si l'exception devait se concrétiser, l'Etat en tant qu'unité serait en danger, ce qui explique pourquoi Schmitt veut laisser carte blanche aux canaux qui permettent de traiter l'exception le plus rapidement possible. Cependant, en vertu de cette force potentiellement dévastatrice, l'exception a le pouvoir de mettre en échec un ordre inefficace.
Je fonde ma lecture de l'approche de la guerre par Schmitt en tant que "politique de la distance" sur les deux arguments susmentionnés. L'affirmation selon laquelle Schmitt propose une politique de la distance par rapport à la guerre est compatible à la fois avec le Schmitt normatif et irrationaliste et, plus important encore, rend compte de leur coexistence. Même si ses théories sont caractérisées par une normativité de l'ordre, Schmitt est fasciné par la guerre. Cette fascination est évidente dans le pouvoir révélateur que possède la guerre, ainsi que dans la capacité de l'exception à vaincre le mécanisme libéral. Schmitt contemple donc esthétiquement la guerre à distance, sans l'inviter directement dans ses images politiques et juridiques. Pourtant, sa propre contemplation esthétique peut générer un certain nombre de réponses et façonner le comportement politique dans son ensemble.
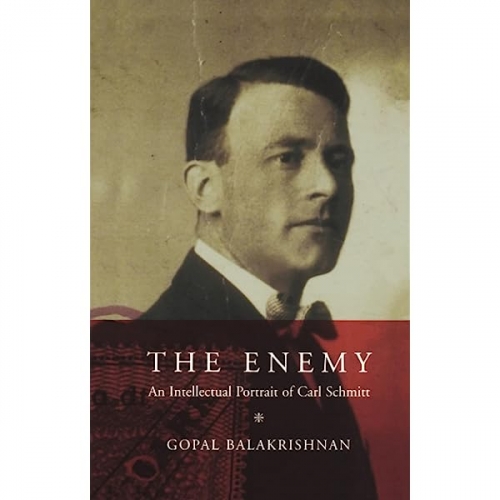
Les deux visages de Schmitt ont été détectés précédemment dans des études sur l'auteur. Par exemple, Wolin (1990) a suggéré une réconciliation par le biais de ce qu'il appelle l'existentialisme politique. Il écrit: "Il existe des préceptes "existentialistes" spécifiques qui lui permettent d'unir à la fois un décisionnisme radical et une philosophie concrète de l'ordre. Il ne fait guère de doute qu'il a perçu l'union parfaite de ces deux doctrines dans le Führerstaat d'Adolf Hitler" (394). Je souhaite éloigner mon interprétation de cette lecture. Ce que je propose, c'est une enquête sur les deux visages de Schmitt et une explication de l'attrait oscillant de la fascination de Schmitt pour la guerre en tant que fascination esthétique.
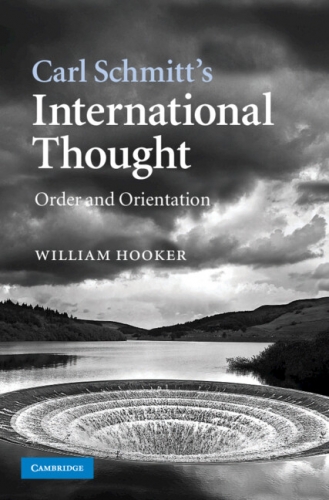
Plusieurs essais traitent de l'esthétique chez Schmitt. Certains se concentrent sur l'influence de Shakespeare sur Schmitt (Pan: 1987; Pye: 2009). Ces articles n'explorent pas la dimension esthétique d'un aspect de la pensée de Schmitt. D'autres contributions identifient un angle esthétique dans les théories de Schmitt. A ma connaissance, la première de ce type est celle de Wolin (1992), où l'auteur affirme que Schmitt donne à l'état d'urgence une "justification presque esthétisante" (434). L'exception perturbe nécessairement un état tranquille de normalité typique de la société bourgeoise, ce qui confère à l'état d'urgence un pouvoir esthétique en tant que subjugueur de la Lebensphilosophie libérale. Le traitement esthétique de l'exception par Schmitt est une "esthétique de l'horreur" (terme emprunté à Bohrer) dans laquelle il y a une tendance à "propager une sémantique temporelle de rupture, de discontinuité et de choc" (Wolin, 1992, p. 433). Le passage de Wolin illustre une tendance commune dans la littérature sur l'esthétique de Schmitt: la négligence de définir et donc d'occuper le terme "esthétique" avec une définition. Qu'est-ce que cela signifie que quelque chose - un concept, un moment ou une théorie - est esthétique? Dans Wolin (1992), il semble que "l'esthétique" soit considérée comme le pouvoir étonnamment violent de l'exception. Si ma modeste lecture de Wolin est correcte, il semblerait que l'on puisse remplacer "esthétique" par des mots proches de "mystifiant", "mystique", "troublant", montrant ainsi que l'attribut "esthétique" n'a rien de spécial. En d'autres termes, "esthétique" dans ce sens est utilisé comme un mot, plutôt que comme un concept.
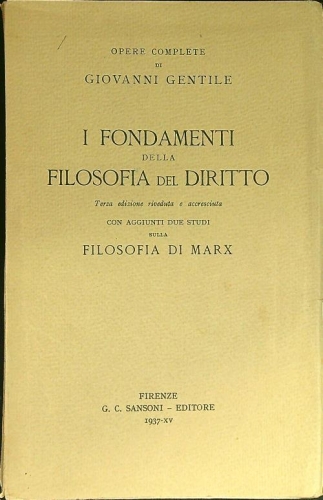
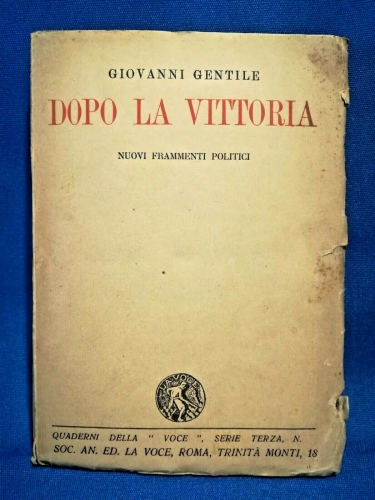
Comme je l'ai mentionné précédemment, Gentile n'était pas un théoricien politique, de sorte que son traitement de la guerre est radicalement différent de celui de Schmitt en termes de portée et de nature. Les écrits de Gentile sur la guerre peuvent être répartis en trois segments théoriques et temporels. Premièrement, les Fondamenti della Filosofia del Diritto [Fondements de la philosophie du droit] (1916). Deuxièmement, les articles journalistiques écrits juste avant la Première Guerre mondiale, rassemblés dans Guerra e Fede (1919), et ceux écrits juste après la guerre, maintenant dans Dopo la Vittoria (1920). Troisièmement, dans les œuvres de la période fasciste, en particulier I Profeti del Risorgimento Italiano (1923) et Origines et doctrine du fascisme (1928). Je me concentrerai ici sur les premier et troisième segments.
Les "Principes fondamentaux" ont été conçus comme un cours de philosophie du droit donné en 1916 aux étudiants de la faculté de jurisprudence de l'université de Pise. Le texte est une analyse typiquement actualiste de la discipline, tant dans sa portée que dans sa téléologie. Dans un chapitre traitant du concept de dialectique en tant que développement et de la place de l'individu dans la société, Gentile (2003) écrit : "la guerre n'a pas sa fin en soi ; la guerre est l'établissement de la paix, la résolution d'une dualité ou d'une pluralité dans la volonté collective, dont la réalisation est immanente au conflit, représentant sa véritable raison d'être, et sa signification correcte" (72). Il poursuit en affirmant que la guerre est le résultat d'intérêts particuliers, qui doivent encore comprendre leur propre particularité - des intérêts qui ne peuvent être pacifiés que par l'ordre de la guerre. Il précise ensuite que le conflit doit être compris non pas comme une phase de transition entre l'individualisme et une substance universelle qui nie l'individualisme, mais comme un moment nécessaire dans la vie dialectique de l'esprit, car il ne peut y avoir de paix sans guerre (Gentile, 2003, p.73).
Ainsi, d'un point de vue philosophique, Gentile comprend la guerre comme un phénomène dialectique qui fait partie du processus d'unification de la multiplicité des volontés dans la société. En ce sens, la guerre est à la fois le signe d'un manque d'unité et le premier pas vers sa résolution. Sur le plan politique, Gentile est un fervent partisan de l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale [5], ce qui suscite son intérêt pour les Fasci di Combattimento (Bedeschi, 2004, p.74). I Profeti traverse la tradition spécifiquement italienne du Risorgimento, avec ses principales figures (Giuseppe Mazzini et Vincenzo Gioberti dans la sphère théorique, Goffredo Mameli et Giuseppe Garibaldi dans la sphère pratique) et les aspects fondamentaux de leur pensée.
 L'objectif de I Profeti est de ressusciter la philosophie et la conception de la vie du Risorgimento et de poursuivre son projet dans le nouveau moment historique de l'Italie: le fascisme. Étant donné que la guerre a été l'idée fondamentale des fascistes, Gentile (2004) montre comment la guerre et le conflit ont été au cœur de la pensée de Mazzini et de l'exemple vivant de Mameli. Gentile définit Mazzini comme "l'éducateur, l'apôtre: l'idée devenue personne" (212), ouvrant ainsi la voie à une exploration de sa pensée orientée vers son propre emploi en tant que source d'inspiration pour le peuple italien. Le plus intéressant est l'affirmation selon laquelle Mazzini est le prophète de l'Italie fasciste, qui partagerait tous les postulats de la philosophie de Mazzini (Gentile, 2004, p. 152). Le lecteur apprend rapidement que la philosophie de Mazzini forme une conception religieuse de la vie (Gentile, 2004, p. 17) qui englobe une conception de l'éthique selon laquelle les devoirs (le caractère sacré du devoir) précèdent toujours les droits et, par conséquent, où les droits ne peuvent être revendiqués que si les devoirs sont remplis.
L'objectif de I Profeti est de ressusciter la philosophie et la conception de la vie du Risorgimento et de poursuivre son projet dans le nouveau moment historique de l'Italie: le fascisme. Étant donné que la guerre a été l'idée fondamentale des fascistes, Gentile (2004) montre comment la guerre et le conflit ont été au cœur de la pensée de Mazzini et de l'exemple vivant de Mameli. Gentile définit Mazzini comme "l'éducateur, l'apôtre: l'idée devenue personne" (212), ouvrant ainsi la voie à une exploration de sa pensée orientée vers son propre emploi en tant que source d'inspiration pour le peuple italien. Le plus intéressant est l'affirmation selon laquelle Mazzini est le prophète de l'Italie fasciste, qui partagerait tous les postulats de la philosophie de Mazzini (Gentile, 2004, p. 152). Le lecteur apprend rapidement que la philosophie de Mazzini forme une conception religieuse de la vie (Gentile, 2004, p. 17) qui englobe une conception de l'éthique selon laquelle les devoirs (le caractère sacré du devoir) précèdent toujours les droits et, par conséquent, où les droits ne peuvent être revendiqués que si les devoirs sont remplis.

Sur le plan politique, Mazzini utilise la primauté des devoirs pour défendre l'idée que les gens ont le devoir de former un peuple et, par conséquent, une nation. La construction d'une nation doit se faire "non par la solidarité, mais par la lutte et la guerre: cette guerre qui - comme l'écrivait Mazzini en 1855 - 'est sacrée comme la mort, et comme la mort, donne accès à une vie plus sacrée, et à un idéal plus élevé'" (Gentile, 2004, p. 22). L'idée que la nation est créée par le conflit et la guerre correspond à la croyance de Mazzini selon laquelle "la vie n'est ni un spectacle ni un loisir, mais une lutte, un sacrifice... les droits ne peuvent être obtenus d'en haut, ils doivent être gagnés par l'insurrection et le martyre" (Gentile, 2004, p. 26). Ainsi, pour Gentile, la foi dans le projet mazzinien du Risorgimento ne doit pas être abandonnée, mais ravivée dans le nouvel esprit italien.
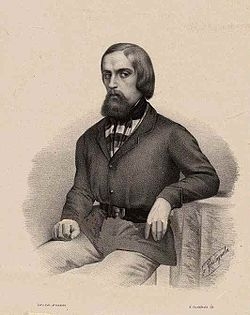 Dans la pensée mazzinienne de Gentile, la guerre est la stratégie de l'unification. Une stratégie qui ne semble pas avoir été abandonnée même en temps de paix, car elle semble être l'essence même de la vie. En ce sens, Gentile (2004) inclut Mameli (gravure, ci-contre) dans la liste des "prophètes" en écrivant qu'"il est le martyr par excellence: le martyr dont la vie et la mort éclairent les origines de cette Italie" (158). Plus loin, Gentile (2004) cite Mazzini à propos de la mort de Mameli: "Mazzini a écrit qu'il ne fallait pas pleurer la mort de Mameli, car il est mort "d'une belle mort, en combattant au nom de Dieu et du peuple"" (163).
Dans la pensée mazzinienne de Gentile, la guerre est la stratégie de l'unification. Une stratégie qui ne semble pas avoir été abandonnée même en temps de paix, car elle semble être l'essence même de la vie. En ce sens, Gentile (2004) inclut Mameli (gravure, ci-contre) dans la liste des "prophètes" en écrivant qu'"il est le martyr par excellence: le martyr dont la vie et la mort éclairent les origines de cette Italie" (158). Plus loin, Gentile (2004) cite Mazzini à propos de la mort de Mameli: "Mazzini a écrit qu'il ne fallait pas pleurer la mort de Mameli, car il est mort "d'une belle mort, en combattant au nom de Dieu et du peuple"" (163).
Dans l'ouvrage Origines de 1928, évoquant l'importance de la guerre pour les fascistes, il écrit: "La guerre était considérée comme un moyen de cimenter la nation comme seule la guerre peut le faire, en créant une pensée unique pour tous les citoyens, un sentiment unique, une passion unique et une espérance commune, une angoisse vécue par tous, jour après jour - avec l'espoir que la vie de l'individu puisse être vue et ressentie par tous - mais qui transcende les intérêts particuliers de chacun" (Gentile, 2009, p. 2).
Après l'intervention très contestée dans la guerre, lorsque la foi dans la restauration de la paix et de l'ordre dans l'État italien semblait vaine, Gentile (2009) a écrit que les fascistes n'ont jamais perdu espoir: "malgré les déceptions et l'angoisse qui ont accompagné la paix - ils ont continué à avoir foi dans la guerre et dans ce que la victoire dans cette guerre signifiait. Ils ont cherché à restaurer l'Italie en elle-même, en rétablissant la discipline et en réorganisant les forces politiques et sociales au sein de l'État" (18).
Par conséquent, dans Origines, Gentile plaide en faveur de la participation de l'Italie à la guerre parce qu'il pense (comme les Fasci) que la guerre est le seul moyen de restaurer un sentiment d'"italianité". En combattant dans la même guerre, le peuple italien, fragmenté, développerait un sens de la fraternité et de l'amitié qui n'existait pas à l'époque, malgré l'expérience du Risorgimento. La guerre devient ainsi le phénomène distinctif de la vie politique. Bien que cela semble, à première vue, similaire à ce que Schmitt écrit dans La notion, nous trouvons dans l'œuvre de Gentile un appel perpétuel aux armes, au martyre et à la guerre. De plus, cette guerre même est la réponse morale à une vie morale, à une conception de la politique qui est nécessairement religieuse et éthique. Ainsi, dans l'acte même de mourir pour sa nation, l'homme devient un héros et un martyr.
La guerre est donc au centre de cette conception de la vie politique et de la politique vivante, où les lignes de séparation entre le sens personnel de la vie et la téléologie nationale sont presque inexistantes. En plaçant la guerre au centre de cette image politique, Gentile pose la question de l'accomplissement moral et de l'unité esthétique. Alors que chez Schmitt, la guerre est toujours à distance, envisagée comme une possibilité perpétuelle pour une myriade de questions politiques et juridiques, mais jamais invitée dans la vie politique. En ce sens, j'ai qualifié la position de Schmitt à l'égard de la guerre de politique de la distance, et celle de Gentile de politique de la proximité. Dans les œuvres politiques de Gentile, la guerre apparaît de deux manières: d'un point de vue théorique, comme le moment dialectique nécessaire dans le conflit d'intérêts, qui, une fois matérialisé, réinitialise l'ordre politique, et d'un point de vue politique, comme la réponse morale au problème politico-existentiel de l'Italie, à savoir l'absence d'une nation.


La rencontre entre Schmitt et Gentile révèle plusieurs caractéristiques intrigantes de la guerre, indétectables chez les penseurs libéraux et dans la tradition libérale. Parmi ces caractéristiques: la destruction créatrice de la guerre - la création d'un nouvel ordre par la destruction violente de l'ancien; le pouvoir unificateur du combat - l'horreur, la violence et le traumatisme peuvent unifier un peuple d'une manière bien plus profonde que n'importe quel autre événement ou phénomène. Le dialogue entre Gentile et Schmitt fait apparaître une spatialité intéressante par rapport à la guerre: une politique de la distance (Schmitt) contre une politique de la proximité (Gentile).
Notes
[1] - J'aimerais exprimer mes sincères remerciements à mes superviseurs pour ce projet, le Dr Gabriella Slomp et le Dr Vassilios Paipais, pour leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements.
[2] - Croce avait attaqué la tentative de Pasquale Villari de reléguer l'histoire à la science. En réponse à Villari, Croce publie "L'histoire placée sous le concept général de l'art" (1893), qui nie les similitudes entre l'histoire et la science, soulignant plutôt les caractéristiques communes entre l'art et l'histoire, tous deux préoccupés par la belle représentation des individus [3].
[3) La publication des œuvres complètes de Gentile a été tentée et interrompue par les maisons d'édition suivantes : Treves (Milan), Sansoni (Florence) en 1936 - dirigée par le fils de Gentile, Federico, qui, en 1946, a délégué la tâche à la Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici (Fondation Giovanni Gentile pour les études philosophiques), basée à Rome.) En 2001, Le Lettere (anciennement Sansoni) a réédité les œuvres complètes de Gentile en suivant la division conçue par Ugo Spirito et Vito Bellezza. La bibliographie complète des œuvres de Gentile a été compilée par Bellezza en 1950 et publiée dans le troisième volume de la série Giovanni Gentile. La Vita e Il Pensiero, sous la responsabilité de la Fondation Gentile.
[4] - Malheureusement, seuls trois de ces textes existent en anglais. Il s'agit de: Theory of Mind as Pure Act, traduit de la troisième édition par H. Wildon Carr. Genèse et structure de la société, traduit par H.S. Harris. Urbana, Ill. The Philosophy of Art, traduit par Giovanni Gullace, Ithaca, NY. Cornell University Press, 1972.
[5] - Contrairement à Croce
Bibliographie
Agamben, G. (2015) État d'exception. Trans. Attell, Kevin. Chicago. The University of Chicago Press.
Bedeschi, G. (2004) Gentile, l'attualismo e il totalitarismo. Dans Marcello Pera Editor, Giovanni Gentile Filosofo Italiano (71-76). Catanzaro : Rubettino.
Bendersky, J. W. (1983) Carl Schmitt : Theorist for the Reich. Princeton : Princeton University Press.
Caldwell, P. C. (2005) Controversies Over Carl Schmitt : A Review of Recent Literature. The Journal of Modern History, 77 (2), 357-87.
Gentile, G. (2009) Origines et doctrine du fascisme. Trans. Gregor, James. A. New Brunswick : Transaction Publishers.
Gentile, G. (2004) I Profeti del Risorgimento Italiano. Firenze : Le Lettere.
Gentile, G. (2003) I Fondamenti della Filosofia del Diritto. Giovanni Gentile Opere. Quinta edizione accresciuta ed. Vol. IV. Firenze : Le Lettere.
Gentile, G. (1922) La théorie de l'esprit comme acte pur. Trans. Carr, H. Wildon. Londres : MacMillian and Co. Limited.
Gentile, G. (1912) "Il Metodo dell'Immanenza" in La Riforma della Dialettica Hegeliana (1954). Terza Edizione Firenze : G.C. Sansoni. 196 - 232.
Lacoue-Labarthe, P. et Nancy, J. (1990). Le mythe nazi. Critical Inquiry 16 (2), 291-312.
Mehring, R. (2014) Carl Schmitt : A Biography. Cambridge : Polity Press.
Pan, D. (1987) Political Aesthetic : Carl Schmitt on Hamlet. Telos 72, 153-59.
Piccone, P. (1977) De Spaventa à Gramsci. Telos 31, 35-65.
Pye, C. (2009) Against Schmitt : Law, Aesthetics and Absolutism in Shakespeare's Winter's Tale. South Atlantic Quarterly 108 (1), 197-217.
Schmitt, C. (2006) Théologie politique : Quatre chapitres sur le concept de souveraineté. Trans. Schwab, George. Chicago : University of Chicago Press.
Schmitt, C. (1996) Le concept de politique. Trans. Schwab, George. Chicago : The University of Chicago Press.
Slomp, G. (2009) Thomas Hobbes, Carl Schmitt et l'événement de la conscription. Telos. 147 (été 2009), 149-65.
Turi, G. (1995) Giovanni Gentile : Una Biografia. Firenze : Giunti.
Wolin, R. (1990) Carl Schmitt, Political existentialism, and the total state. Theory and Society 19 (4), 389-416.
Wolin, R. (1992) Carl Schmitt : The Conservative Revolutionary Habitus and the Aesthetics of Horror. Political Theory 20 (3), 424-47.
12:37 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, giovanni gentile, guerre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie, fascisme, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 juin 2023
Multipolarité et multilatéralisme

Multipolarité et multilatéralisme
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/ru/article/mnogopolyarnost-i-mnogostoronnie-otnosheniya
Il existe plusieurs termes similaires dans les sciences politiques occidentales qui rendent confus le contexte de l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. Outre le terme de multipolarité, les mots "multipolarité" et "multilatéralisme" sont également utilisés. Cependant, si nous les déconstruisons, il sera évident qu'ils ont une signification différente. Avec la multipolarité, tout est plus ou moins clair, même si, encore une fois, en Occident, la polarité a d'abord été comprise comme une définition géographique, et comme il n'y a que deux pôles sur la Terre, le Nord et le Sud, elle a certaines connotations.
À l'époque de la guerre froide et de la bipolarité, elle soulignait même un certain caractère naturel des deux pôles. Cependant, si nous partons d'un point de vue différent, il pourrait y avoir beaucoup plus de pôles. En partant de l'explication de Martin Heidegger dans son Parménide, nous arrivons à la conclusion qu'il peut y avoir autant de pôles que de nations, et il y a ici un certain lien avec le concept de quatrième théorie politique d'Alexandre Douguine, où le Dasein est proposé comme base pour la projection et la fixation d'objectifs dans le temps et l'espace, qui se déploie dans les processus politiques.

En ce qui concerne le multipolarisme, il est immédiatement évident que nous parlons d'une sorte de construction idéologique. La terminaison -isme nous renvoie aux modèles politiques théoriques et pratiques les plus divers, du communisme et du marxisme au libéralisme et au fascisme. Par conséquent, le multipolarisme apparaît comme un concept parapluie, bien qu'il n'existe pas d'idéologie du "multipolarisme" ou du "multipolarisme" en tant que telle. Il existe des visions disparates de la formation d'un système politique mondial multipolaire. D'une part, les États constituent certes des pôles, d'autre part, les pôles peuvent aussi être des alliances et des pactes, et enfin, ils peuvent être des civilisations (qui coïncident parfois avec des États, comme dans le cas de la Russie, de l'Inde et de la Chine).
Néanmoins, le terme multipolarisme lui-même peut servir de point de référence, de phare pour stimuler le développement des aspects pratiques de la multipolarité.
Dans le cas du multilatéralisme, nous sommes confrontés à une approche totalement différente des affaires internationales. Il s'agit d'un modèle proposé par les États-Unis sous l'administration de Barack Obama pour renforcer l'hégémonie de Washington. Seulement, le leadership américain dans ce format n'est pas si évident. C'est un peu comme la méthode "nudge" du behaviorisme social que Cass Sunstein (qui a également travaillé dans l'administration de la Maison Blanche sous Obama) a proposée. Le titre de l'un de ses livres, The Illusion of Choice, illustre parfaitement le principe du multilatéralisme. Les autres pays ont l'illusion d'avoir des connexions diverses et variées, mais toutes (en politique, en économie, en logistique, etc.) sont incluses dans la toile d'un système mondial contrôlé par un seul acteur - les États-Unis.

Au sein des Nations unies, l'accent est souvent mis sur le multilatéralisme et un certain nombre d'agences spécialisées opèrent dans ce sens. Toutefois, comme dans le cas de la réglementation de l'internet, il y a des tentatives évidentes de la part d'une partie d'augmenter le nombre de voix au détriment des unités opérationnelles fictives, c'est-à-dire les entreprises privées, qui sont censées avoir le droit de participer à l'élaboration de nouvelles normes. Les États-Unis tentent ainsi d'utiliser cet outil pour maintenir leur domination.
Cependant, même parmi les partisans de la multipolarité et les critiques de l'hégémonie américaine, on entend parfois ce terme. Cela crée une certaine confusion. C'est pourquoi une révision adéquate et une utilisation réfléchie de la terminologie sont nécessaires. En développant une nouvelle approche des relations internationales (en particulier lorsqu'il s'agit d'une théorie non occidentale des relations internationales), les rudiments associés au mondialisme parasitaire doivent être éliminés.
20:08 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multipolarité, multilatéralisme, multipolarisme, définition, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 juin 2023
L'évolution du conservatisme américain

L'évolution du conservatisme américain
par le comité de rédaction de Katehon
Source: https://www.ideeazione.com/levoluzione-del-conservatorismo-americano/
Le conservatisme américain est l'une des deux principales idéologies de la philosophie politique américaine (avec le libéralisme), une idéologie qui a été formulée pour la première fois dans l'ouvrage de Russell Kirk, Conservative Mind (1953), qui est devenu la source de ce courant politique. Les origines du conservatisme moderne aux États-Unis renvoient à l'Amérique du début des 18ème et 19ème siècles, conçue comme un projet de société moderne aux fondements capitalistes et individualistes.

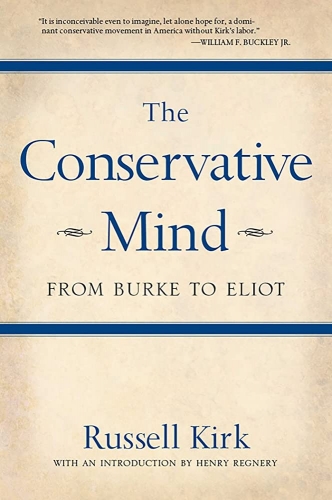
Le développement initial du conservatisme américain modéré-libéral traditionnel s'est transformé au fil du temps en politique libertaire (avec son individualisme radical) et néo-conservatrice (avec son hyper-mondialisme). Les conservateurs américains, qui représentent une variété de courants, s'appuient sur les idées exposées dans les œuvres d'Alexis de Tocqueville, d'Edmund Burke, d'Adam Smith, de Milton Friedman et de Friedrich von Hayek. [cf. Toropov E.A. The winding path of American conservatism : from Russell Kirk to the neoconservatives].
Dans le contexte politique, le conservatisme américain s'oppose aux "idéologies" [cf. Kirk R., The Conservative Mind, New York, 1953], est un mouvement qui défend les valeurs dites "américaines", qui s'expriment par une minimisation de l'influence de l'État sur l'économie et par les libertés individuelles des citoyens américains, ainsi que dans le soutien aux valeurs traditionnelles et chrétiennes.
Le conservatisme américain en tant que courant politique s'est formé en présence d'un large éventail de problèmes sociaux, notamment les problèmes liés à l'immigration, à la révolution industrielle et à la domination du mode de vie bourgeois.
À un moment donné de l'histoire américaine, les protestants d'orientation nativiste et anticatholique se sont qualifiés de conservateurs.


Le pays étant protestant à plus de 95 % en 1840, la plupart des protestants n'étaient pas particulièrement heureux à l'idée de partager leur pays avec les catholiques irlandais, qui s'installaient massivement aux États-Unis, fuyant les problèmes économiques qui frappaient l'Irlande. L'afflux de catholiques a donné naissance au parti nativiste "Know-Nothing Party" ou, selon l'appellation officielle, au "Native American Party". Les militants du parti exigeaient que les écoles publiques organisent des lectures quotidiennes de la Bible et interdisaient aux catholiques d'y enseigner. Les positions anti-catholiques sont si fortes qu'aux élections de 1856, le candidat du Native American Party, Millard Fillmore (photo, ci-dessus), obtient près de 25 % des voix, soit le deuxième meilleur résultat obtenu par un tiers parti dans l'histoire du pays.
En ce qui concerne les questions politiques, il convient de s'attarder sur la situation interne des États-Unis qui s'est développée après la victoire du "Nord" dirigé par Lincoln lors de la guerre civile (1861-1865). Le parti républicain, qui est devenu la force politique dominante, avait des positions progressistes et soutenait de vastes réformes sociales et une plus grande intervention de l'État dans l'économie. Il a soutenu la création du système de la Réserve fédérale (Fed), a investi dans une urbanisation massive, a soutenu la Prohibition, le droit de vote des femmes et a modernisé d'autres domaines de la vie publique américaine auxquels s'opposaient les conservateurs du Sud. Pour tenter de maintenir le statu quo et sa domination politique, l'idéologie républicaine s'est transformée au fil du temps en un conservatisme bourgeois. Un événement emblématique a été la manipulation des élections en faveur des républicains en échange de la fin de la réintégration des États du Sud enclins au séparatisme (le Texas en est un exemple). La "reconstruction" radicale, qui impliquait l'armée et les procureurs du Nord, a radicalement affecté la formation des identités régionales dans les États du Sud.
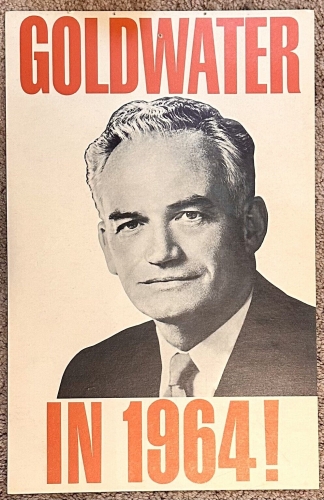
Le rythme de la croissance industrielle et l'émergence de grands propriétaires de capitaux ont minimisé les différences entre les républicains et les démocrates. Cependant, plus tard, dans les années 1960, le conservatisme a reçu un nouvel élan en raison des problèmes internes qui s'étaient accumulés aux États-Unis. Le taux de criminalité élevé, la révolution sexuelle, le problème de l'avortement, la crise énergétique, l'échec de la guerre du Viêt Nam, le scandale du Watergate : tous ces problèmes ont éveillé l'intérêt d'une partie de la société américaine pour la défense de ses valeurs traditionnelles à travers la formation de mouvements et d'organisations conservateurs.
Les organisations conservatrices aux États-Unis
Le mouvement conservateur aux États-Unis est constitué d'un vaste groupe d'organisations politiques et idéologiques unies par une position commune sur la préservation des valeurs traditionnelles dans le pays. Leurs origines remontent au milieu du 20ème siècle, lorsque des organisations bénévoles sont apparues dans tout le pays pour lutter pour la préservation des valeurs traditionnelles et résister aux réformes imposées par les "progressistes".
Dans les années 1960, le mouvement conservateur aux États-Unis est devenu si fort et si influent qu'il a conduit à la création de nombreuses institutions dont les activités visaient à défendre les valeurs traditionnelles des Américains.
Les organisations conservatrices ont différents types d'activités, depuis les groupes de réflexion, où les conservateurs effectuent un travail d'analyse, jusqu'aux activités publiques des organisations chrétiennes, qui visent à renforcer les valeurs familiales.
Les organisations conservatrices les plus connues aux États-Unis sont les suivantes :

- Tea Party - Créé en réponse à la crise économique de 2008, le mouvement politique conservateur-libertaire Tea Party prône la réduction de l'appareil gouvernemental, la baisse des impôts et des dépenses publiques, la réduction de la dette nationale et du déficit budgétaire, ainsi que le respect de la Constitution américaine.

- L'institut Heartland soutient les politiques d'économie de marché. L'orientation politique du Heartland Institute est décrite comme conservatrice et libertaire. L'institut promeut le déni du changement climatique, soutient les droits des fumeurs et la privatisation des ressources publiques, y compris la privatisation des écoles. Il soutient les réductions d'impôts et s'oppose aux subventions et aux allègements fiscaux pour les entreprises individuelles, ainsi qu'à un rôle plus important du gouvernement fédéral dans les soins de santé.

- La Heritage Foundation est un institut de recherche stratégique américain qui mène un large éventail de recherches en matière de politique internationale. Elle a une orientation néo-conservatrice. Elle s'est engagée à soutenir l'expansionnisme américain.

- Le Council for National Policy est une organisation faîtière et un groupe de réseautage pour les activistes conservateurs et républicains aux États-Unis. Le Conseil a été fondé en 1981, sous l'administration Reagan, par Tim Lahay et la droite chrétienne pour "donner plus d'importance et de force à la promotion du conservatisme".
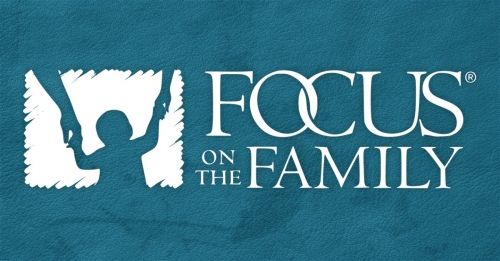
- Focus on the Family est une organisation sociale chrétienne évangélique américaine. Elle œuvre pour "nourrir et protéger l'institution de la famille telle qu'elle a été établie par Dieu et pour promouvoir la vérité biblique dans le monde entier". L'organisation produit des programmes radio, des magazines, des vidéos et des enregistrements audio sur des questions conservatrices.

- La John Birch Society (JBS) est un groupe politique américain de droite. La John Birch Society se considère comme un opposant au soi-disant "gouvernement mondial" et soutient l'idée de réduire l'immigration aux États-Unis et de limiter l'influence des institutions internationales telles que les Nations unies, l'ALENA et d'autres accords de libre-échange.
Les néoconservateurs, une mutation du conservatisme américain
Le néoconservatisme est un mouvement politique et intellectuel apparu aux États-Unis dans les années 1960. Il s'agit d'une combinaison d'idées conservatrices et libertaires associées à une politique étrangère active basée sur les idéaux de "démocratisation" et d'expansionnisme américains.

Les néoconservateurs se distinguent par leur volonté d'établir l'hégémonie américaine sur la scène internationale en promouvant les valeurs occidentales, qu'ils considèrent comme universelles.
Les grandes figures du mouvement néoconservateur, comme Norman Podhoretz et Irving Kristol, prônent un monde unipolaire en s'opposant à l'URSS et en éliminant les concurrents des États-Unis de la scène politique internationale. En politique intérieure, les néoconservateurs s'opposent aux programmes sociaux et gouvernementaux qui, selon eux, dévalorisent le "mode de vie américain" et menacent la sécurité nationale.
Parmi les exemples d'activités des néocons, on peut citer leur rôle dans le soutien aux opérations du Golfe en 1991, les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak, et leur soutien à l'usage de la force dans d'autres régions.
Parmi les figures les plus influentes du mouvement néoconservateur moderne figurent Irving et William Kristol, Dick Cheney et Paul Wolfowitz.
Les paléoconservateurs en opposition aux néoconservateurs
Parallèlement, un courant de "paléoconservatisme" a vu le jour. Contrairement aux néoconservateurs, les paléoconservateurs adhèrent à une interprétation directe du droit constitutionnel et rejettent toutes les expériences sociales imposées à la société. Ils s'opposent également au militarisme international américain et à la volonté de "démocratiser le monde", en soulignant l'importance de la liberté et de la souveraineté nationale.
Les paléoconservateurs s'opposent aux politiques néoconservatrices menées sous la présidence de George W. Bush, qu'ils considèrent comme orientées vers l'expansionnisme américain et la promotion de la "démocratie" dans d'autres pays par tous les moyens. En outre, les paléoconservateurs rejettent le concept de "guerre préventive" et défendent l'idée de souveraineté nationale.

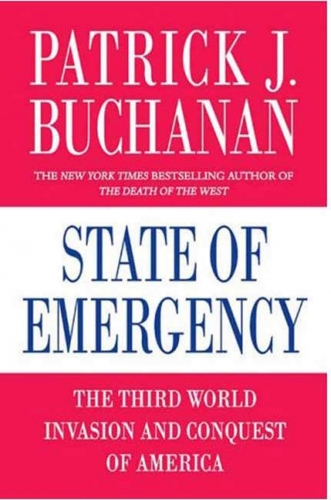
Les paléoconservateurs (par exemple Patrick Buchanan - photo) ont également critiqué les politiques fiscales du gouvernement fédéral, défendant l'idée d'une intervention minimale de l'État. Les paléoconservateurs prônent de sévères restrictions à l'immigration, la décentralisation, l'isolationnisme et un retour à l'éthique et à la morale conservatrices en matière de genre, de culture et de société.
Le libertarianisme en tant que pseudo-conservatisme
De nombreux conservateurs américains se qualifient eux-mêmes de libertariens. Le libertarianisme de droite implique l'absence d'influence du gouvernement sur la liberté individuelle et la vie économique de la société. Les idéaux économiques du libertarianisme consistent en des relations de libre marché et de libre concurrence. En outre, selon les idées libertaires, les fonctions de l'État devraient être transférées au marché et remplacées par des initiatives individuelles, ce qui, d'une certaine manière, est cohérent avec les idées du mondialisme, où la plus haute autorité institutionnelle sera le "marché" impersonnel. Les auteurs qui ont influencé la formation du libertarianisme sont A. Smith, J. S. Mill, les représentants de l'école autrichienne d'économie, en particulier L. von Mises et F. von Hayek, ainsi que l'économiste américain M. Friedman.


Les libertariens sont largement représentés sur la scène politique américaine. À l'initiative de l'activiste civil américain David Nolan, le Parti libertarien des États-Unis a été fondé en 1971. Selon la vision du monde du parti, "les libertariens s'opposent fermement à toute ingérence du gouvernement dans vos décisions personnelles, familiales et professionnelles". Ils estiment que "tous les Américains devraient être libres de vivre leur vie et de poursuivre leurs intérêts comme ils l'entendent, tant qu'ils ne nuisent pas à autrui". La position du parti s'est renforcée au fil des ans, indiquant une augmentation de l'individualisme et de l'égoïsme dans la société américaine.
Si l'on parle du libertarianisme comme d'un courant politique conservateur, il se concentre sur les questions économiques en ignorant l'identité collective américaine et ses aspects culturels inhérents. En revanche, pour d'autres mouvements conservateurs, le contexte culturel et historique des États-Unis revêt une grande importance. Pour les conservateurs traditionnels, le mouvement libertarien est associé à une vision commune des questions économiques et à un accent mis sur la liberté individuelle, qui ne doit toutefois pas être déformée par l'idéologie.
21:17 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, libertariens, états-unis, conservatisme, conservatisme américain, théorie politique, définition, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 juin 2023
Le césarisme : entre hégémonie et contre-hégémonie

Le césarisme : entre hégémonie et contre-hégémonie
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/cesarismo-entre-la-hegemonia-y-la-contrahegemonia
L'État que nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de décrire, qui est imprégné d'hégémonie, mais qui lui résiste en partie, est un État césariste. Il dit : "Je n'entrerai pas demain (dans le jeu), je resterai aujourd'hui (ce que je suis), que mon aujourd'hui soit éternel". Le césarisme est un État qui ne s'oppose pas à l'hégémonie, mais qui se fige simplement dans le temps, devenant un moyen de dissuasion pour l'hégémonie afin de réaliser sa prochaine étape, mais seulement en tant qu'obstacle (temporaire) sur le chemin de l'hégémonie.
Le césarisme est une tentative d'interagir avec l'hégémonie et de s'y opposer en même temps. Le désir d'interagir avec l'hégémonie de cette manière consiste à la laisser partiellement entrer et, simultanément, à l'éviter tout aussi partiellement. Par exemple, la Fédération de Russie contemporaine est un cas typique de césarisme selon les termes de Gramsci.
Formellement, l'État césariste peut proclamer : "Nous sommes pour la souveraineté ! Mais si l'hégémonie est à l'intérieur comme le moule qu'elle est - idéologiquement, technologiquement, économiquement - alors il importe peu que cet État soit pleinement intégré dans l'hégémonie ou non. Peu importe de quel côté vient l'hégémonie : le fait de prendre un iPhone vous inclut déjà dans l'hégémonie, parce qu'il y a déjà différents programmes qui suivent votre profil, qui vous examinent. Vous êtes inclus dans leur réseau. L'hégémonie est un réseau, un rhizome.
La ligne de démarcation entre hégémonie et césarisme, d'une part, et entre contre-hégémonie et césarisme, d'autre part, sont des aspects fondamentaux de la science politique de Gramsci.
17:14 Publié dans Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : césarisme, russie, alexandre douguine, théorie politique, définition, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 juin 2023
Un rebelle européen aux racines russes

Un rebelle européen aux racines russes
Yana Panina
L'anarchisme classique à travers les yeux du radical russe Mikhaïl Bakounine
L'histoire du véritable anarchisme avec un arrière-plan russe est étroitement liée à la personnalité de Mikhaïl Bakounine, dont la contribution au destin du monde entier s'est avérée colossale. Véritablement russe, éduqué à la philosophie européenne, son objectif principal était de créer un monde où tous les hommes seraient égaux et libres, et où la vie ne serait pas mesurée par l'épaisseur de la bourse ou la hauteur du piédestal social. Les idées utopiques de Bakounine allaient à l'encontre des pensées de Marx, pour qui le radical n'était soudain plus que "ce gros Russe". Qui était-il donc et sa philosophie est-elle encore vivante aujourd'hui ?
Conditions préalables à la formation de l'anarchisme de Bakounine
Mikhaïl Bakounine a "hérité" des idées de liberté et d'égalité de son éducation au sein d'une famille nombreuse et très conviviale. Une petite communauté de 11 enfants, égaux en termes de conditions et de relations, formait une sorte de commune, où chacun grandissait spirituellement et développait sa propre "personnalité" : "... je veux dire une liberté digne de ce nom, une liberté offrant une pleine possibilité de développer toutes les capacités, intellectuelles et morales, cachées en chaque homme...", décrira plus tard Bakounine.
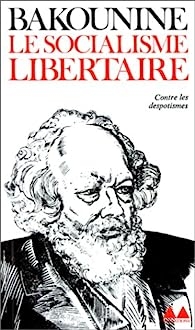 Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Les idées de Mikhaïl Bakounine ont également été fortement influencées par l'esprit révolutionnaire de la Russie dans laquelle il est né et a grandi. Le petit Misha a connu le soulèvement de décembre 1925 à l'âge de onze ans. La société a alors l'espoir d'un changement sérieux de l'État, une grande partie de l'aristocratie russe y voit le véritable salut du pays. Divers cercles se forment, auxquels adhèrent de nombreuses personnalités des arts et des sciences et des membres influents de la noblesse russe. En 1835, après avoir été renvoyé d'une école d'officiers et avoir effectué un service militaire insipide, Bakounine s'est retrouvé dans l'un de ces cercles. C'est le manque de liberté de pensée et d'action, ainsi que la discipline rigide et les règles strictes pendant le service militaire qui, selon certains chercheurs, l'ont amené à penser que l'anarchisme était l'avenir de la Russie et, plus tard, de toute l'Europe.
Installé à Moscou, le jeune penseur se fait de nombreuses connaissances : Stankevitch, Pouchkine, Tchaadaïev, Belinsky, Botkine, Katkov, Granovsky, Herzen, Ogarev, pour ne citer que quelques-uns des membres du cercle social de Bakounine. C'est sous l'influence de Stankevitch que Mikhail Aleksandrovitch approfondit l'étude de la philosophie allemande : il commence à s'intéresser aux idées de Kant et de Fichte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le futur anarchiste est à cette époque convaincu que l'amour de Dieu donne à l'homme la liberté, l'épanouissement personnel et l'indépendance.

À la fin des années 1830, Bakounine est fasciné par les écrits de Hegel qui, selon lui, lui insuffle "une vie complètement nouvelle". Sur la base des doctrines du philosophe allemand, Michael publie un certain nombre de ses travaux sur l'esprit, la connaissance absolue, la réalité et la volonté de Dieu, etc. Inspiré par les enseignements de Hegel, Bakounine s'installe à Berlin en 1840 pour y recevoir une bonne éducation à l'allemande, mais il se désintéresse rapidement de la philosophie théorique et devient un véritable praticien de l'anarchisme, rejoignant les cercles des réformateurs européens, déplaçant "vers la gauche" ses opinions politiques.
Dès 1942, il publie un article intitulé "De la réaction en Allemagne", qui commence à refléter explicitement les idées de l'anarchisme auxquelles il restera fidèle pendant très longtemps: l'égalité sociale et les principes de liberté ne peuvent être atteints que par la destruction complète du modèle d'État politique existant. L'année suivante, Bakounine s'imprègne des idées communistes et publie un article dans lequel il affirme que "le communisme n'est pas une ombre sans vie. Il est né du peuple, et du peuple, une ombre ne peut jamais naître". Les idées plutôt radicales et critiques du "réformateur" ne sont pas du goût des autorités russes et Mikhaïl Bakounine devient littéralement un ennemi public dans son pays, si bien qu'un retour en Russie ne semble plus possible.
Au milieu des années 1840, l'anarchiste rencontre des théoriciens communistes, dont Marx. Ils deviendront bientôt des ennemis jurés pour toujours, mais nous y reviendrons plus tard.
Le rebelle en liberté : le rôle de Mikhaïl Bakounine dans les révolutions européennes de 1848-1849
Mikhaïl Aleksandrovitch a également joué un rôle majeur dans les soulèvements de libération en Pologne. C'est là qu'ont émergé ses idées de panslavisme - l'unification de tous les peuples slaves en une seule fédération. Selon Bakounine, pour construire un monde nouveau et libre, pour une pleine justice politique et sociale, il est nécessaire de couper les systèmes existants avec les racines, de tout détruire jusqu'au sol. Il pensait que grâce aux efforts conjoints des Slaves de l'Ouest et du Sud, il était possible de réaliser un changement en Russie: se libérer du "joug allemand" en renversant les dirigeants qui étaient les principaux ennemis du peuple slave.
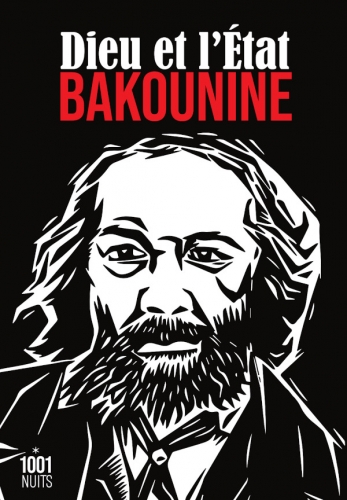
L'esprit de rébellion du maître russe des destinées de l'État a trouvé une application, non seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Bakounine attendait avec impatience la vague révolutionnaire en Europe, et il l'a finalement connue. En 1848, il participe activement à ce que l'on appelle le "printemps des nations", qui touche la France, l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays. Le radicalisme de Mikhaïl Alexandrovitch a eu l'occasion de se manifester à Dresde. Le destin a voulu que ce noble russe, qui avait l'expérience du service militaire, se retrouve dans une ville saisie par un gouvernement provisoire. La légende veut qu'on lui ait demandé d'aider à organiser la défense et à stimuler l'esprit révolutionnaire des citoyens. Lorsque les troupes royales ont commencé à avancer, Bakounine a proposé des mesures de protection radicales: tout d'abord, accrocher de grandes œuvres d'art, dont la Madone Sixtine, sur les murs de la ville afin que les militaires, élevés dans l'amour et le respect de l'art et de l'histoire, n'osent pas tirer. Et s'ils avaient osé, ils auraient été traités de barbares et de vandales. Un peu plus tard, Mikhaïl Bakounine fait d'autres propositions: brûler les maisons des aristocrates locaux, faire sauter l'hôtel de ville et couper les arbres anciens qui gêneraient les troupes royales. Le gouvernement provisoire, cependant, décide de ne pas recourir aux idées du révolutionnaire russe et se rend sans combattre.
De quoi témoigne cette affaire, décrite plus tard dans les écrits de Herzen ? Tout d'abord, Bakounine pensait que le peuple russe était prêt pour la révolution, car il était pauvre et possédait déjà "les habitudes et les instincts d'une société démocratique", mais que les Européens devaient d'abord se débarrasser des "échos matériels du passé", dont les symboles sont les œuvres de Raphaël, le vieil hôtel de ville et les arbres centenaires. Et cela doit se faire rapidement, pas lentement.
Après cette tentative de renversement du gouvernement à Dresde, Bakounine est envoyé en exil, revient dans son pays et, après 8 ans d'emprisonnement, est envoyé en Sibérie, où il se marie puis s'enfuit en Europe via le Japon en 1861. L'année 1861 marque un nouveau chapitre dans ses activités philosophiques et pratiques. Au cours des 20 années suivantes, le bakounisme va littéralement envahir toutes les rues, même les plus reculées, des villes européennes, et Mikhaïl lui-même va devenir un symbole du mouvement socialiste.
Idées fondamentales de l'anarchisme, du fédéralisme et de l'État sans État
C'est au cours de cette période que se forge définitivement sa vision athée et matérialiste. Pour Bakounine, l'idéalisme conduit inévitablement "à l'organisation d'un despotisme grossier et à une exploitation mesquine et injuste sous la forme de l'Église et de l'État". Il semble que les opinions d'un homme sur de simples questions philosophiques changent parfois radicalement: jeune et encore immature, Bakounine restait fidèle à Dieu, voyant en lui la véritable liberté de l'homme. Mais au bout d'un certain temps, sous l'influence des idées communistes d'égalité et de fraternité, il a renoncé à la religion, montrant que la foi était l'une des manifestations d'une société déjà rassise, dépassée, opprimée, qui ne se tournait vers Dieu que pour supporter les conditions insupportables de la vie. En même temps, le philosophe pensait que la religion est une partie historique inhérente à toute nation et qu'elle doit être traitée avec soin pour ne pas lui nuire. "Avec l'aide de la religion, l'homme est un animal qui, sortant de l'animalité, fait le premier pas vers l'humanité", écrivait-il.
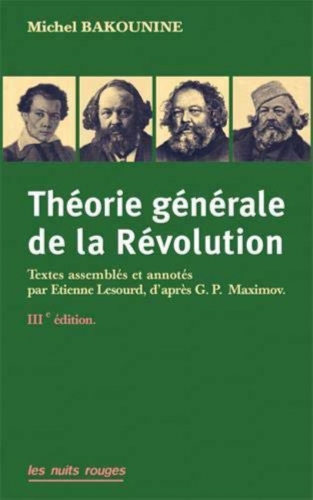
Il est également intéressant de noter qu'un farouche opposant aux lois et au contrôle de l'État n'a pas nié l'existence possible d'un gouvernement provincial (un parlement composé de deux chambres : des représentants de l'ensemble de la population et des communautés), d'une constitution et d'un tribunal. Les communautés réunies en fédérations devaient "coordonner leur propre organisation avec les principaux fondements de l'organisation provinciale et obtenir pour cela l'autorisation du parlement provincial". En même temps, "la loi communale conservait le droit de s'écarter sur des points mineurs de la loi provinciale, mais pas de ses fondements". Dans la construction de l'État, Bakounine a mis en avant le principe de la "pyramide inversée", où les principaux "pouvoirs décisifs sont concentrés localement". Dans le même temps, il ne nie pas l'existence possible d'une structure de pouvoir verticale et note que toutes les actions des communautés doivent servir les intérêts de l'État lui-même.
Les idées de Mikhaïl Alexandrovitch prévoyaient la création d'un gouvernement national qui rédigerait une constitution, tout comme les provinces, à condition que ces dernières puissent s'en écarter sur des points mineurs. Les pouvoirs du Parlement national auraient inclus le contrôle des activités de l'exécutif élu, la rédaction et l'adoption des lois, l'établissement de relations internationales avec d'autres pays, etc. Sur le même principe, une fédération internationale de pays a été envisagée.
Lutte pour l'Internationale : comment d'anciens amis et compagnons d'armes, Marx et Bakounine, sont devenus des ennemis jurés
L'histoire des relations difficiles entre Bakounine et Marx commence en 1864. Mikhaïl Alexandrovitch se rend en Italie pour diffuser les idées de l'Internationale, où il va à l'encontre de la philosophie du prolétariat et tente de créer sa propre "Société révolutionnaire internationale" secrète, où tous seraient frères. Elle repose sur l'idée de détruire tous les États européens, à l'exception de la Suisse, afin d'éliminer le modèle de pouvoir centralisé. Le plan consistait à créer des communautés qui s'uniraient en fédérations à différents niveaux. Parallèlement, l'anarchiste considérait nécessaire le pouvoir du peuple sous la forme d'une communauté autonome de tous les citoyens adultes, en élisant des représentants des différents fonctionnaires, mais avec la condition obligatoire de leur remplacement permanent, ce qui, selon Bakounine, ne donnerait pas un statut privilégié et garantirait les libertés démocratiques. Tous les aristocrates sont exclus, tous les partisans d'un quelconque privilège,...". Car le mot démocratie ne signifie rien d'autre que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la masse entière des citoyens - et à l'heure actuelle, nous devons ajouter les citoyens qui composent la nation", écrit Mikhaïl Aleksandrovitch.
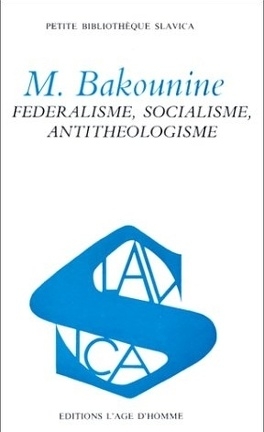 En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
La transition vers le nouveau système devait être le résultat d'une révolution. Ses principaux moteurs, selon Bakounine, sont la paysannerie et la classe ouvrière, qui vouent une haine instinctive aux couches privilégiées de la société. Et leurs principaux outils sont la rébellion et la lutte pour la liberté. Élevé dans la pauvreté et l'esclavage, le peuple russe a une aversion pour l'État, car son principal désir est la terre libre, le travail commun et l'absence de bureaucratie et de propriété foncière. En même temps, seule une jeune intelligentsia révolutionnaire peut rassembler la paysannerie et la classe ouvrière et canaliser leur puissance dans une cause commune.
Il en résultera une société sans aucune autorité, où les gens se soumettront à l'autorité de l'opinion publique, et où les paysans et les ouvriers deviendront les seules classes existant en harmonie - "les uns sont propriétaires du capital et des instruments de production, les autres - de la terre, qu'ils cultivent de leurs mains ; les uns et les autres s'organisent, motivés par leurs besoins et leurs intérêts mutuels, également et en même temps absolument libres, nécessaires et naturels, se contrebalançant réciproquement".
La polémique de Bakounine avec Marx consistait principalement en des perspectives différentes. Tout d'abord, Mikhaïl Bakounine a déclaré que la dictature du prolétariat aboutirait au même résultat que celui auquel les révolutionnaires s'opposaient. En d'autres termes, le gouvernement et le régime politique changeraient, mais leur essence resterait la même, sauf que le pouvoir serait désormais concentré entre les mains du prolétariat. L'État est le vrai mal : "Là où commence l'État, finit la liberté individuelle, et vice versa... S'il y a État, il y a nécessairement domination, donc esclavage ; un État sans esclavage, ouvert ou déguisé, est impensable - c'est pourquoi nous sommes ennemis de l'État.
L'affrontement entre Bakounine et Marx culmine dans la tentative du premier de tirer à lui la couverture d'influence de l'Internationale. En fin de compte, la bataille d'idées s'est transformée en une guerre personnelle entre deux personnalités puissantes de l'époque. Marx estimait que les activités des bakounistes sapaient les idées de la dictature du prolétariat et, en 1972, les partisans de Mikhaïl Alexandrovitch ont été expulsés de l'Internationale.
Les adeptes contemporains du bakounisme
De nos jours, les idées du grand rebelle appartiennent au passé, bien que les adeptes de l'anarchisme russe existent toujours. Aujourd'hui, cependant, il ne s'agit pas seulement d'une alliance contre l'État, mais aussi d'une lutte idéologique contre certains problèmes mondiaux de l'humanité, tels que l'écologie et la protection de l'environnement. Dans le même temps, on observe une certaine crise parmi les anarchistes : il y a de moins en moins d'adeptes en raison du manque d'unité et d'intégrité du mouvement.

En Russie, l'Union anarchiste russe a joué un rôle important à cet égard, car elle a fondé ses idées sur l'anarchisme national et ethnique. En d'autres termes, il s'agit d'une association de personnes de la même nationalité vivant sur le même territoire. Cela inclut le panslavisme de Bakounine et l'idée d'anti-ethnicité de Kropotkine. Oui, les gens croient encore à l'accomplissement de la révolution, et les protestations et les révoltes en sont le principal outil. Mais au début du XXIe siècle, le mouvement des adeptes de Bakounine, de Kropotkine et d'autres philosophes et figures révolutionnaires s'est transformé en une sorte de sous-culture et, dans l'esprit de la plupart des Russes, il est désormais associé à l'impuissance et à l'anarchie. Comme au 19ème siècle, les adeptes de l'anarchisme se positionnent comme un mouvement en dehors de toute force politique, mais en même temps, ils ne sont pas encore devenus une force motrice sérieuse capable d'influencer l'esprit des jeunes et de la société dans son ensemble.
Les idées de Mikhaïl Bakounine sont-elles pertinentes aujourd'hui ? Probablement pas. Dans le contexte actuel de lutte politique permanente, il est nécessaire de disposer d'une autorité centralisée claire, capable de maintenir l'unité du peuple. Même si l'on peut dire que des tentatives de liberté totale ont eu lieu dans les années 1990, il s'agissait d'un défi sérieux à la pérennité de l'État.
Malheureusement, les idées utopiques sur l'existence de fédérations composées de communautés de personnes sont impossibles. On peut être d'accord ou non, mais nous vivons une période de "guerre froide", où chaque pays se bat pour ses propres ressources et intérêts plus que pour des vies humaines. Pour survivre, il faut non seulement s'unir, mais aussi éviter que l'État ne soit détruit par l'absorption de ses petites "communautés", comme lors du schisme féodal. L'appartenance à une nation ne fera qu'engendrer davantage de disputes et de conflits. Certes, la liberté fait partie intégrante de la société démocratique à laquelle chacun aspire aujourd'hui. Mais en même temps, l'émergence d'une plus grande liberté dans certains domaines s'accompagne aussi de l'émergence de plus grands interdits dans d'autres. L'existence de l'anarchisme dans le contexte moderne est donc fortement remise en question. Et qu'elle reste ouverte...
12:46 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, mikhail bakounine, bakounine, 19ème siècle, anarchisme, révolution, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 mai 2023
Engels en tant que théoricien militaire
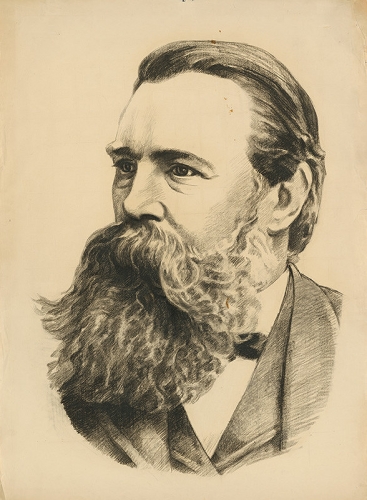
Engels en tant que théoricien militaire
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/04/30/engels-som-militarteoretiker/
À l'époque du socialisme réel, on parlait souvent de "Marx et Engels", mais aujourd'hui, ce dernier semble avoir été relégué à l'arrière-plan. Ce n'est pas tout à fait surprenant, car Marx avait souvent une profondeur d'analyse qui manquait à Engels, et c'est aussi quelque chose qu'Engels lui-même soulignait souvent. En même temps, le "marxisme" moderne est fortement marqué par Engels, qui était lui aussi un penseur de premier plan. Par ailleurs, bien que Marx et Engels aient tous deux été, selon la terminologie moderne, homophobes et racistes, il y avait chez Engels un nationalisme allemand qui a été repris par la social-démocratie allemande.
Un aspect intéressant d'Engels réside dans ses écrits sur la théorie militaire, un aspect qui a été transmis dans de nombreuses parties de la tradition politique qu'il a contribué à façonner. Engels a acquis une expérience dans ce domaine lors d'une rébellion ratée en 1849, au cours de laquelle il s'est forgé une réputation de chef militaire courageux et compétent. Il a étudié et écrit sur de nombreux conflits et soulèvements au cours de sa vie, depuis les soulèvements de 1848-1849 et les guerres coloniales jusqu'à la guerre de Crimée et la guerre de Sécession. En matière de théorie de la guerre, c'est Engels, et non Marx, qui a été le maître reconnu, ce qui est intéressant compte tenu des succès militaires des guérillas marxistes-léninistes au 20ème siècle. Engels était "le premier Clausewitz rouge" (il est cité 6 fois dans La théorie du partisan de Carl Schmitt, 47 fois dans Lénine et 40 fois dans Mao).
Le major Michael A Boden développe ce sujet dans son livre The First Red Clausewitz : Friedrich Engels And Early Socialist Military Theory (Le premier Clausewitz rouge : Friedrich Engels et la théorie militaire socialiste primitive). Il aborde, entre autres, le fait que l'accent a souvent été mis sur Engels en tant que théoricien stratégique et que ses connaissances au niveau tactique et opérationnel ont souvent été négligées. La guerre moderne, la science de la guerre, la nation et la guérilla sont quelques-uns des thèmes intéressants abordés dans l'ouvrage de Boden.
Engels s'intéressait sans surprise à la relation entre la société et la guerre, à la manière dont les changements dans les forces et les conditions de production conduisaient à des changements militaires. En ce qui concerne la guerre moderne, il a pu écrire que "la guerre moderne est le produit nécessaire de la Révolution française. Sa condition préalable est l'émancipation sociale et politique de la bourgeoisie et des petits paysans". Il constate que le soldat citoyen est un phénomène nouveau, qui a aussi des répercussions sur les rapports de force entre les classes. Pendant un temps, Engels a espéré qu'une grande guerre européenne pourrait déboucher sur une lutte des classes. En même temps, il était conscient que les guerres modernes avaient tendance à être plus inhumaines, compte tenu des éléments de haine de classe et de haine nationale. Il a également décrit la guerre comme une "force sociale ayant une dynamique propre".


Garibaldi. Chemises rouges formant les unités de combat garibaldistes.
Engels considérait la science de la guerre comme un phénomène nouveau, essayant activement et scientifiquement de développer une perspective et un ensemble de concepts pour ce phénomène. Ici aussi, il y avait un lien avec les relations de production ; il écrivait que "la nouvelle science de la guerre doit être tout autant un produit nécessaire des nouvelles relations sociales que la science de la guerre créée par la révolution et Napoléon était le résultat nécessaire des nouvelles relations engendrées par la révolution". Pour Engels, le caractère massif des armées est important, tout comme la mobilité et la rapidité. Garibaldi en est un exemple ; Engels écrit que "dans la guerre, et en particulier dans la guerre révolutionnaire, la rapidité d'action jusqu'à ce qu'un avantage décisif soit acquis est la première règle".
L'intérêt d'Engels pour les nations et le nationalisme est lié à l'approche scientifique de la guerre. Dans Les armées de l'Europe, il a compilé et analysé les conditions et les ressources des différentes armées. Il s'est penché sur des facteurs tels que les effectifs, la discipline, l'équipement et l'entraînement. Mais il a également abordé les caractéristiques nationales et raciales d'une manière qui serait totalement taboue aujourd'hui. Les Français sont décrits comme "une nation guerrière et pleine d'entrain, qui éprouve de la fierté pour ses défenseurs". L'armée autrichienne était, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, caractérisée par la diversité ; Engels écrivait que "c'est là que réside le point faible de cette armée". Il trouve la même faiblesse dans l'armée danoise, avec les éléments allemands de la région du Schleswig-Holstein, et dans l'armée turque. Il décrit les Allemands comme le peuple guerrier par excellence en Europe, "la constance délibérée des Allemands les rend particulièrement aptes au service de l'artillerie. Par ailleurs, ils comptent parmi les peuples les plus pugnaces du monde, appréciant la guerre pour elle-même et allant souvent la chercher à l'étranger lorsqu'ils ne peuvent pas l'avoir chez eux. Depuis les Landsknechte du moyen âge jusqu'aux légions étrangères actuelles de la France et de l'Angleterre, les Allemands ont toujours fourni la grande masse de ces mercenaires qui se battent pour le plaisir de se battre. Si les Français les dépassent en agilité et en vivacité d'attaque, si les Anglais sont leurs supérieurs en dureté et en capacité de résistance, les Allemands dépassent certainement toutes les autres nations européennes dans cette aptitude générale au devoir militaire qui fait d'eux de bons soldats en toutes circonstances". Il décrit les soldats russes comme étant à la fois courageux et maladroits, les Turcs comme étant paresseux, fatalistes et tellement racistes qu'ils refusent d'adopter les méthodes européennes. L'attitude d'Engels à l'égard des peuples slaves, à l'exception des Polonais, est probablement bien connue.
Il considérait le nationalisme comme une forte source de motivation, ainsi que comme un problème important pour les États multiculturels. Engels a écrit sur plusieurs soulèvements nationaux et guerres de libération, en lien avec son intérêt pour la guérilla. Boden écrit qu'Engels a été l'un des premiers à analyser ce phénomène. Il écrit dans La défaite des Piémontais que "le soulèvement de masse, la guerre révolutionnaire, les détachements de guérilla partout - c'est le seul moyen par lequel une petite nation peut vaincre une grande, par lequel une armée moins forte peut être mise en position de résister à une armée plus forte et mieux organisée. Les Espagnols l'ont prouvé en 1807-1802, les Hongrois le prouvent aujourd'hui également". Dès 1852, il écrit sur les défis du chef de partisan, soulignant à nouveau l'importance du mouvement et de l'initiative ("la défensive est la mort de tout soulèvement armé"). Parallèlement, il s'intéresse à la relation entre les classes et la guerre. Pendant la guerre de Sécession, il écrit que les Sudistes pauvres auraient pu s'engager dans une guérilla, mais qu'ils auraient alors eu les anciens propriétaires d'esclaves contre eux, "il ne fait guère de doute, il est vrai, que les éléments du white trash, comme les planteurs eux-mêmes appellent les "pauvres blancs", tenteront la guérilla et le brigandage. Une telle tentative, cependant, transformera très rapidement les planteurs possédants en unionistes. Ils appelleront eux-mêmes les troupes des Yankees à leur secours".


John S. Mosby, chef des pauvres sudistes qui auraient voulu entamer une guerre de guerilla.
Dans l'ensemble, Boden offre un aperçu lisible d'Engels en tant que théoricien militaire doué, avec des références à plusieurs articles théoriquement féconds, tous disponibles sur l'internet. Le théoricien de la guerre qu'est Engels n'apparaît pas non plus ici comme un déterministe ; la relation entre les conditions de production et la guerre est complexe, et de mauvais dirigeants peuvent détruire des conditions objectivement bonnes, du moins à court terme. Pour rappeler les contrastes entre "Marx et Engels" d'une part et la "gauche" d'aujourd'hui d'autre part, il est également utile de lire le théoricien militaire Engels. En ce qui concerne les caractéristiques nationales et raciales en tant que facteurs matériels, par exemple, il était plus proche de la droite alternative d'aujourd'hui que de la "gauche" contemporaine. Son analyse des relations sociales dans le Sud est également difficile à concilier avec la "critique blanche" (du "White nationalism") d'aujourd'hui. Mais il s'agit là d'une curiosité ; l'avantage durable réside dans la méthode d'Engels, qui intègre des facteurs tels que la nation, la classe, la motivation, la mobilité, le leadership et la technologie. L'importance relative de ces facteurs a peut-être quelque peu changé depuis le 19ème siècle, mais la valeur de l'approche demeure.
18:48 Publié dans Militaria, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich engels, théorie militaire, théorie politique, 19ème siècle, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 mai 2023
Le néolibéralisme ne meurt jamais

Le néolibéralisme ne meurt jamais
Aucune catastrophe, financière ou sanitaire, ne semble pouvoir ébranler la capacité du système économique à surmonter les crises, à changer et à s'adapter aux circonstances.
Claudio Freschi
Source: https://www.dissipatio.it/il-neoliberismo-non-muore-mai/?...
Le terme "néolibéralisme" a été utilisé de manière si large et si diverse, parfois même de manière inappropriée, qu'il a été difficile d'en définir précisément la signification.
Comme nous le savons, le libéralisme est un système économique fondé sur la liberté absolue de production et d'échange, dans lequel l'intervention de l'État est autorisée dans de rares cas, essentiellement lorsque l'initiative privée ne répond pas aux besoins de la communauté. Bien que ses racines soient lointaines, cette école de pensée s'est développée grâce à ce que l'on appelle l'école autrichienne, avec des économistes comme Friedrich Hayek et Ludwig von Mises, et a connu une grande popularité au début du siècle dernier.

Avec la grande crise de 1929 et la dépression qui s'ensuivit, le retour des politiques keynésiennes visant à atteindre le plein emploi (avec un recours important aux dépenses publiques), a éclipsé pendant quelques décennies l'idée d'un libéralisme absolu, qui a dû attendre les années 1970 pour revenir à la mode. Mais à cette époque, les choses ont changé : l'avancée politique des sociaux-démocrates en Europe a définitivement discrédité l'idée classique d'un libéralisme prêt à tolérer une pauvreté généralisée au nom d'une richesse croissante concentrée dans les mains d'un petit nombre.
C'est là que le terme néolibéralisme a commencé à faire son chemin, pour désigner ce courant de pensée qui acceptait volontiers la nécessité d'une intervention de l'État pour amener la plupart des gens au-dessus d'un certain seuil de revenu minimum. Mais une fois ce seuil atteint, il n'y aurait plus lieu de s'inquiéter des inégalités sociales, politiques ou économiques. La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, les États-Unis de Ronald Reagan et, dans une plus large mesure encore, le Chili de Pinochet, soutenus par de prestigieux économistes de l'école de Chicago, étaient des exemples d'un système combinant des degrés divers d'autoritarisme avec des politiques de libre-échange plutôt radicales. Rien à voir avec le souci légitime de la liberté d'expression qui animait les grands penseurs libéraux depuis John Stuart Mill, mais tout à fait dans la ligne de la pensée de Hayek pour qui l'enjeu fondamental était de préserver la liberté d'action de l'individu tout en minimisant l'ingérence des différents gouvernements.

Malgré la fin de ces expériences plutôt "extrêmes", la conception néolibérale a dominé le monde occidental au cours des quarante dernières années. Une idée de l'économie de marché, avec le moins de régulation possible, sous des gouvernements déterminés à maîtriser les dépenses publiques et à assainir les budgets. En temps de crise, le dogme du petit État a été largement, voire temporairement, mis de côté au nom d'un pragmatisme politique souvent issu de calculs électoraux, mais l'idéologie de base est toujours restée.
La crise financière de 2009 a ébranlé les fondements du néolibéralisme. L'incapacité totale des économistes du courant dominant à prédire une catastrophe d'une telle ampleur a semblé mettre fin, sinon aux idées, du moins à la crédibilité de la plupart de ces universitaires, mais une fois que les marchés ont retrouvé un semblant de normalité, il est apparu clairement que l'idéologie néolibérale était loin d'être défunte.
Même la pandémie de Covid 19, récemment déclarée, a semblé mettre un terme à l'idée d'un marché tout-puissant qui, avec le temps, résout tous les problèmes en rétablissant l'équilibre sans aucune intervention extérieure. Des millions d'emplois ont disparu, des secteurs productifs entiers se sont effondrés, la bourse s'est effondrée, des milliards de crédits sont devenus progressivement irrécouvrables, créant une telle urgence que la nécessité d'agir dépassait largement le cadre des idéologies.
Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et même dans l'Union européenne austère, les politiques prudentielles ont été abandonnées avec de gigantesques injections de liquidités sur le marché et un recours massif aux dépenses publiques. Mais même dans ce cas, les annonces d'un renoncement définitif au néolibéralisme, suite aux événements déclenchés par la pandémie, ne se sont pas concrétisées. Au contraire, le retour de l'inflation a donné plus de force à tous ceux qui espéraient un retour à des politiques budgétaires strictes et, en général, à une réduction du rôle de l'État.
Certains pensent que le coup de grâce au néolibéralisme pourrait venir du pays même qui a fait du marché sa raison de vivre, les États-Unis d'Amérique. De nombreux analystes soulignent que le président Biden a passé les deux premières années de son mandat à promettre, comme l'ont souvent fait ses prédécesseurs, une expansion massive de la "protection sociale" et, en général, de puissants investissements publics. On se souvient que, dans l'un de ses premiers discours au Congrès, le président avait tenu à rappeler la centralité de l'intervention de l'État dans la construction des infrastructures qui ont permis à l'Amérique de devenir une grande puissance mondiale.
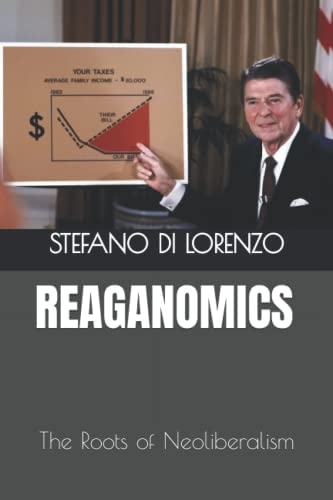
Mais malgré ces déclarations d'intention, et l'antipathie naturelle des démocrates pour le reaganisme, aucune véritable stratégie économique alternative n'avait jamais été formulée. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a ouvertement parlé d'un nouveau "consensus de Washington", c'est-à-dire d'un principe directeur de la politique économique de la Maison Blanche qui tend à encourager l'intervention de l'État plutôt qu'à s'y opposer, à renforcer les protections des travailleurs plutôt qu'à déréglementer, et à réduire l'interdépendance économique entre les nations plutôt qu'à l'encourager. M. Sullivan a ensuite défini le nouveau modèle économique américain comme une critique ouverte du néolibéralisme, estimant que ce dernier repose sur trois hypothèses manifestement erronées. La première est que "les marchés alloueront toujours les ressources de manière productive et efficace", la deuxième est que "toute croissance est une bonne croissance" et la troisième que "l'intégration économique et la mondialisation rendront les nations plus responsables et favoriseront un processus de paix mondial".
Mais ce projet, qui, selon la plupart des enthousiastes, mettra fin à l'engouement des Américains pour le néolibéralisme, se heurte à un obstacle potentiellement insurmontable, à savoir que le "consensus de Washington" tant vanté pourrait manquer de... consensus. Ce n'est pas un mystère que l'idée d'augmenter les impôts et les dépenses publiques ne fait pas vraiment partie de l'agenda politique des Républicains. Et sans la coopération du parti de l'éléphant, il est fort probable que l'espoir de voir se concrétiser un nouveau paradigme économique allant au-delà du néolibéralisme reste lettre morte.
La vérité est que l'attrait du néolibéralisme, même s'il a été affaibli par diverses crises, reste fort parce qu'il est inhérent à la logique du capitalisme mondial. Sa nature est changeante, il évolue et s'adapte en fonction des situations. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il continue à vivre comme il l'a toujours fait, en se transformant en fonction des différentes conditions, en surmontant les obstacles, en s'adaptant à la pensée commune, mais sans jamais changer ses paramètres de base. Pour paraphraser Mark Twain : "Désolé de vous décevoir, mais la nouvelle de la mort du néolibéralisme est largement exagérée".
A propos de l'auteur Claudio Freschi
Après des études d'économie, il est entré dans le monde des marchés financiers où il travaille depuis 30 ans. Passionné de voyages, d'échecs et de John Maynard Keynes, il collabore avec diverses publications imprimées et en ligne, écrivant sur la politique et l'économie.
20:23 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, néolibéralisme, définition, théorie économique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 mai 2023
Capitalisme sénile et démolition contrôlée

Capitalisme sénile et démolition contrôlée
par Fabio Vighi
Source: https://sinistrainrete.info/neoliberismo/25140-fabio-vighi-capitalismo-senile-e-demolizione-controllata.html
Sur quels principes repose le capitalisme sénile ? Je résumerai cinq d'entre eux et discuterai ensuite de leur imbrication :
1) La dette. Le seul chemin vers l'avenir du capitalisme continue d'être pavé de programmes de création d'argent. Créer de l'argent à partir de rien, pour le mettre en mouvement sous forme de crédit, est la seule stratégie monétaire qui nous permette d'ignorer l'abîme qui s'ouvre déjà sous nos pieds - comme le personnage de dessin animé qui, après avoir couru dans le précipice, continue à courir dans les airs en défiant la gravité. Or, comme le montre la violente vague inflationniste actuelle - toujours à deux chiffres en Europe - la force de gravité est désormais irrésistible.
2) Les bulles. Les bulles spéculatives, alimentées par le mouvement perpétuel du crédit, constituent le seul mécanisme significatif de production de richesse. C'est pourquoi l'unique préoccupation des gestionnaires du "capitalisme de crise" est d'empêcher les méga-bulles de se dégonfler. Mais comme l'ultra-finance détruit la "société du travail", la vie humaine devient un surplus inutilisable, un énorme surplus improductif à administrer de manière créative.
3) Démolition contrôlée. Le dumping salarial et la concurrence vers le bas pour les emplois dévastés par l'automatisation technologique sont l'autre facette du paradigme de la bulle. Pour que les marchés spéculatifs puissent continuer à léviter, la société du travail (article 1 de la Constitution italienne) doit être progressivement mais radicalement réduite, car l'hypertrophie financière actuelle exige la démolition de la demande réelle. En d'autres termes, le "capitalisme de consommation" est recyclé en "capitalisme de gestion de la misère collective", ce qui entraîne un changement de récit idéologique.
4) Les urgences. La phase terminale de la civilisation capitaliste est caractérisée par l'idéologie intrinsèquement terroriste de la permacrise ou - pour paraphraser Guy Debord - de "l'urgence intégrée permanente", qui doit occuper chaque seconde de notre vie. En ce sens, la récente pseudo-pandémie n'a servi que de précurseur. Ne nous leurrons pas : un monde qui défend avec autant de fanatisme sa propre implosion nous réserve encore bien des surprises.
5) La manipulation. La propagande médiatique à l'ère de l'hyper-connexion numérique est naturelle, il est donc normal que le capitalisme terminal en profite. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une confluence obstinée de stupidité et de calcul. Comme l'avait prédit George Orwell bien avant la télévision et Internet, la frontière entre le mensonge et la réalité est floue : "Le processus [de contrôle de l'opinion publique] doit être conscient, sinon il ne pourrait être exécuté avec suffisamment de précision, mais il doit aussi être inconscient, car sinon il ne pourrait être dissocié d'un vague sentiment de mensonge et donc de culpabilité"[1]. Plus précisément, la manipulation exige "la dislocation permanente du sens de la réalité, par laquelle il manque un point de référence objectif dans le monde extérieur pour juger de la vérité et de la réalité des choses"[2]. Jean Baudrillard a appelé le résultat de ce processus l'hyperréalité : puisque la distance entre le réel et sa représentation médiatique est perdue, la seule réalité à laquelle nous pouvons nous référer est celle qui est "informée" par les médias.
Le délire du mouvement perpétuel
Après avoir épuisé les astuces monétaires, les élites financières se sont acculées. Le système spéculatif basé sur l'endettement, gonflé pendant des décennies par l'impression monétaire et la suppression des taux d'intérêt, ne peut plus être maintenu sans d'importants "dommages collatéraux". C'est ainsi que tombe le masque de la "science lugubre" de l'économie bourgeoise (selon la célèbre définition de Thomas Carlyle), et son illusion que l'argent peut se reproduire de manière autonome, comme par le biais d'un mécanisme de mouvement perpétuel. L'inflation structurelle actuelle est le premier symptôme évident d'une métastase qui se propage rapidement dans le corps social, obligeant une grande partie de la population - y compris les classes moyennes de plus en plus insolvables - à choisir entre mettre de la nourriture sur la table et payer les factures. Il devrait être clair maintenant que toute politique monétaire expansive - nécessaire pour soutenir le secteur financier - provoquera une nouvelle érosion du pouvoir d'achat, rendant ainsi indispensables de nouvelles mesures coercitives pour contrôler les masses appauvries. L'alternative capitaliste à ce scénario est que les banques centrales continuent à augmenter les taux jusqu'à ce que les bulles éclatent - de la poêle à frire au feu.

Dans le système financier actuel, l'illusion du mouvement perpétuel fonctionne de la manière suivante : l'expansion du crédit attire l'argent vers les actifs d'investissement, dont la valorisation augmente à mesure que la demande s'accroît. Une partie des actifs dopés sert de garantie pour d'autres prêts, ce qui déclenche un cercle vicieux dans lequel le crédit alimente la valorisation des actifs qui alimente la garantie qui alimente le crédit. Comme notre existence est désormais entièrement accaparée par l'expansion de la liquidité, la seule chose qui compte réellement est de continuer à utiliser l'effet de levier du capital de crédit. Et tant que l'illusion du mouvement perpétuel perdure - ainsi que l'affabulation idéologique correspondante - les obligations de financement de la dette peuvent être reportées. Mais si les taux d'intérêt augmentent et que les garanties perdent de la valeur, la panique s'installe et les gens commencent à vendre - en mode grégaire. À mesure que les garanties se détériorent, les actifs risquent de devenir inférieurs à l'encours de la dette, ce qui finit par épuiser les liquidités jusqu'à l'éclatement de la bulle. Il est bon de savoir que nous approchons de cette dernière phase, dans laquelle la création de richesse spéculative sans substance se transforme en une spirale mortelle pour la bulle de la dette : les valorisations s'effondrent, les garanties se réduisent, le crédit s'effondre. Le paradoxe de notre époque est que l'argent spéculatif qui gonfle les bulles financières n'a aucune substance de valeur ; mais si les bulles éclatent, c'est l'enfer.
L'Occident mondialisé a déjà hypothéqué une grande partie de ce qu'il possède (et ne possède pas). En d'autres termes, les États, les entreprises et les ménages ne possèdent plus rien d'autre que leur dette. Et comme le casino mondial continue de menacer de faire faillite - comme l'a annoncé, tout récemment, la faillite de la Silicon Valley Bank - les détenteurs du pouvoir financier savent qu'ils doivent agir vite s'ils veulent garder intacts leurs privilèges systémiques. En effet, ils ont compris que pour continuer à inonder les marchés de liquidités artificielles, il faut conduire l'économie réelle, déjà en chute libre, vers la stagflation. L'instrument pour y parvenir est sous nos yeux : un autoritarisme sournois et rampant légitimé par l'urgentisme à jet continu ; un nouveau fascisme dans une version néo-féodale, hyper-numérisée et faussement solidaire (de " gauche ") - comme pour se servir d'un antifascisme archéologique et maniériste, purement prétexte, comme Pasolini l'avait parfaitement compris dans les années 1970[3]. [Inaugurée en grande pompe par la pseudo-pandémie, la dynamique implosive est aujourd'hui reprise par les banques centrales qui, en augmentant les taux, ne font que titiller l'inflation, mais dépriment en revanche la demande réelle.
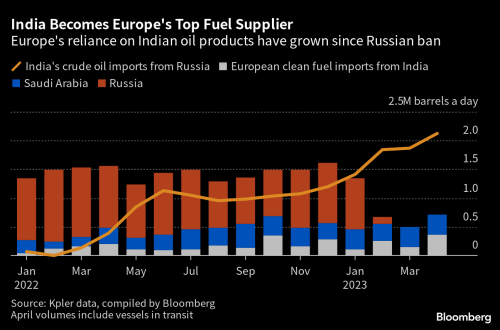
À cet égard, la récente hausse des coûts de l'énergie doit être considérée dans son contexte comme faisant partie de la tentative plus large de décompression d'un système hautement inflammable - l'équivalent du désamorçage d'une bombe atomique. Les sanctions contre la Russie ont été dès le départ une farce misérable et, pour l'Europe, un exercice masochiste peu raffiné. Il suffit de considérer que, compte tenu de la dynamique du commerce mondial, la Russie sanctionnée vend du pétrole et du gaz à l'Inde et à la Chine au rabais, qui les exportent ensuite vers l'Europe (et les États-Unis) au prix fort. De même, le véritable objectif de la "lutte contre le changement climatique" prônée par les multinationales à travers le dogme des investissements ESG - officiellement inauguré en 2020 par la lettre "net zero" de Larry Fink (PDG de BlackRock) - est d'imposer des niveaux de vie inférieurs aux classes populaires qui, il y a quelques années encore, étaient exhortées à poursuivre l'utopie d'une consommation débridée. L'Ukraine peut être considérée comme un symbole tragique de cette démolition contrôlée : grâce à une guerre par procuration qui se prolonge indéfiniment, l'infrastructure industrielle du pays est cyniquement détruite. Ce n'est pas une coïncidence si, le 28 décembre, Larry Fink lui-même et Volodymir Zelensky, aujourd'hui déifié, se sont mis d'accord sur un programme d'investissement pour reconstruire l'Ukraine, confirmant le schéma désormais familier selon lequel la dévastation d'une société entière devient une opportunité d'expansion financière. C'est pourquoi l'Occident envoie des centaines de milliards de dollars à l'Ukraine, au lieu de négociateurs de paix.
Le point que nous ne pouvons ignorer est le suivant : la démolition contrôlée de la demande réelle est l'autre face du capitalisme ultra-financiarisé. Cela signifie que le capital ne peut continuer à s'autoreproduire qu'en creusant le fossé entre une poignée de nababs qui contrôlent l'argent et l'information, et la plèbe appauvrie qui, pour cela, doit 1. ne rien posséder et en être heureuse (selon le fameux slogan du WEF) ; 2. sacrifier ses libertés individuelles (selon le fameux slogan du WEF). sacrifier leurs libertés individuelles (y compris la liberté d'expression, de plus en plus étouffée par un "discours culturel" grotesquement surréglementé) ; 3. abandonner leur droit à l'existence à l'État, dont le rôle biopolitique est d'administrer ce droit au nom du capital transnational. Cette dérive perverse du "capitalisme de crise" a été largement sous-estimée - et c'est un euphémisme - par notre intelligentsia de gauche, même "radicale" (de Noam Chomsky à Slavoj Žižek) qui, comme les chiens de Pavlov, salivait à la perspective du "retour de l'État" comme un signe certain d'émancipation.
La déprimante myopie de la gauche a été particulièrement agressive lors de la récente "pandémie", qu'il faut comprendre non pas comme la peste bubonique du nouveau millénaire, mais comme un coup d'État financier rendu possible par la plus grande et la plus spectaculaire opération de lavage de cerveau que l'humanité ait jamais connue. L'urgence a servi à masquer un fait en soi assez banal : c'est (c'est) le système qui est atteint d'une maladie mortelle, et non la population mondiale. Paradoxalement, la gauche continue de se précipiter au chevet du capitalisme en soins intensifs, si malade qu'elle ne peut que feindre un dynamisme qu'elle ne possède pas à travers la mobilisation globale de la violence, de la peur, de la distraction, et des récits faussement éthiques ou salvateurs correspondants. COVID-19 a été avant tout une pandémie de peur, dont les conséquences restent à voir. Lorsqu'un "vaccin" expérimental est présenté comme une potion magique (le fameux 95 % d'efficacité !) contre une maladie dont le taux de survie est de 99,8 %, même dans l'esprit de nos intellectuels publics, notoirement allergiques à l'exercice de la pensée critique, le doute devrait au moins s'installer. De même, personne n'a ressenti de honte lorsque Pfizer a admis n'avoir jamais eu la moindre idée de la capacité de ses sérums à interrompre la transmission du virus - alors que cette même histoire a été vendue au public comme une vérité scientifique incontestable à l'origine de l'imposition de la vaccination de masse et de la discrimination qui en découle. Question (rhétorique) : jusqu'où la gauche est-elle allée à droite si elle ne reconnaît même pas le tour de passe-passe criminel du capitalisme d'urgence ? En soutenant l'implosion mondiale sous de faux prétextes éthiques, la majeure partie de la gauche actuelle fait le travail de la droite plus efficacement que la droite elle-même.
Peu importe à quel point la perception de l'escroquerie pandémique commence à s'imposer, la plupart d'entre nous préfèrent encore la solution de l'autruche : mieux vaut (prétendre) ne pas savoir que de s'interroger sur son propre niveau de naïveté (ou de collusion). Mais il ne sert à rien de récriminer. Il me semble plutôt important de revenir au point clé de toute l'affaire : Virus a été le bouclier invisible utilisé pour retarder un effondrement bancaire et financier face auquel la crise de 2008 aurait semblé une aventure bucolique ; en même temps, il a inauguré une stratégie pan-urgence visant à la gestion top-down de l'avilissement de masse - non seulement dans les périphéries du monde capitaliste, mais maintenant aussi en son centre. Nous sommes ainsi persuadés d'accepter l'effondrement lent mais inexorable de la civilisation capitaliste comme une fatalité : une stagflation un peu féerique, provenant de facteurs extérieurs largement incontrôlables (la pandémie, la guerre en Ukraine, le changement climatique, des politiciens ou des banquiers corrompus) plutôt que de la décomposition en cours de notre mode de production. Outre les dégâts, bref, la dérision.

Le grand bal des bulles
De nombreux problèmes critiques ont menacé le casino financier mondial au cours de l'année 2022. Au total, les actions et les obligations ont perdu plus de 30 000 milliards de dollars, malgré les rachats records des entreprises (qui gonflent artificiellement le prix des actions). L'indice Nasdaq a clôturé l'année à - 33 %, la pire performance depuis 2008. Le volume mondial de la dette à rendement négatif s'est contracté, passant de 18 400 milliards de dollars en décembre 2020 à 686 milliards de dollars en décembre 2022 (ce qui, malgré l'euphorie trompeuse des médias, est une mauvaise nouvelle pour la bulle de la dette, car cela signifie que les obligations sont en train de s'effondrer). Bien sûr, les hausses de taux sont principalement responsables de la perte de valeur du marché. Cependant, l'extraordinaire rebond des principales bourses mondiales au début de l'année 2023 suggère que les marchés continuent de bénéficier du soutien inconditionnel des banques centrales. Il est difficile de douter que ces dernières ne soient pas prêtes à revenir sur le terrain avec des injections monétaires explicites dès qu'elles le jugeront nécessaire - certainement derrière le bouclier de la prochaine urgence inévitable.
En outre, alors que l'indice mondial de liquidité se détériore rapidement (après plus d'une décennie de croissance artificielle), le dernier jour de l'année 2022 a été marqué par un record historique de dépôts en reverse repo à la Fed de New York : 2,5 trillions de dollars provenant de 113 contreparties. Cela signifie que pendant que les gens ordinaires se démènent pour payer leurs hypothèques et leurs factures, les investisseurs garent d'énormes quantités de liquidités à la Fed, car le mécanisme de prise en pension garantit des rendements plus élevés et plus sûrs que d'autres investissements (le taux de prise en pension actuel est de 4,57 %). L'utilisation massive de ces contrats signifie que d'importants volumes de liquidités insignifiantes avec un énorme potentiel inflationniste sont absorbés par la Fed, qui tente alors de geler la base monétaire en l'empêchant d'apparaître directement comme une demande réelle. En outre, c'est au moins depuis les années 1990 que, pour exorciser l'inflation des bulles, les banques centrales font tout leur possible pour que d'énormes masses d'argent restent emprisonnées dans le système financier. Mais cette stratégie est désormais obsolète, car la masse de capital fictif a été gonflée à un point tel qu'elle ne peut plus être supprimée. Au contraire, elle a depuis longtemps commencé à cannibaliser l'économie réelle.

Depuis le début du millénaire, notre monde est l'otage du clonage des bulles financières - technologiques, immobilières, souveraines, etc. - qui dépendent toutes de la création effrénée de liquidités et de la suppression des taux par les banques centrales. Mais surtout, ce clonage soutient la production réelle, c'est-à-dire la reproduction de nos sociétés. L'ancienne logique capitaliste s'est donc inversée : les bulles spéculatives sont désormais des moteurs systémiques, alors qu'elles étaient auparavant des phénomènes isolés dans le temps et dans l'espace. Leur caractère ontologique actuel les rend incomparables à la bulle des tulipes hollandaises de 1630 ou à la bulle de la South Sea Company de 1720 (construite sur les profits de la traite des esclaves). Lorsque ces bulles ont éclaté, elles ont laissé place à de nouveaux cycles d'accumulation réelle, c'est-à-dire fondés sur l'exploitation intensive de la force de travail. Aujourd'hui, cependant, une bulle qui éclate ne peut aspirer qu'à se transformer en une autre bulle. Cela signifie qu'une grande partie de la production réelle a déjà été accaparée par le processus spéculatif. Dans le même temps, la chaîne financière a atteint une déconnexion presque totale de la chaîne de valeur du travail, comme le certifie aujourd'hui même Morgan Stanley. Nous sommes donc étranglés par un mécanisme invisible et auto-alimenté, dont l'extraordinaire abstraction empêche la plupart de le comprendre.
Récapitulons le point central. L'expansion d'une bulle nécessite de l'"air chaud" sous la forme de liquidité de la dette. Le poumon du système est le marché obligataire, le lieu virtuel où s'échangent les titres de créance. Si des capitaux sont nécessaires pour investir ou pour financer les dépenses publiques (y compris les guerres), des obligations sont émises, qui obligent l'émetteur à rembourser le coût à une date d'échéance et à un taux d'intérêt déterminés. Les entreprises émettent des obligations, tout comme les gouvernements. S'endetter pour investir, c'est la stratégie de l'effet de levier qui fait gonfler la "bulle du tout" du capitalisme actuel, comparable à un château de papier construit sur une mare d'essence. En 2019, cette chaîne de Ponzi a de nouveau frôlé la crise de nerfs en raison du comportement hystérique des produits dérivés toxiques, et en particulier de la hausse soudaine des taux d'intérêt sur le marché américain (crise du repo de septembre 2019). La "pandémie", comme j'ai tenté de le reconstituer dans un article de 2021, était la réponse mondiale au risque d'un Armageddon financier qui avait atteint le point de déclenchement. Selon des données récemment rendues publiques par la Réserve fédérale de New York, rien qu'en 2019-2020, un total de 48 000 milliards de dollars sous forme de prêts à taux préférentiels a été versé par la Fed aux mégabanques de référence sujettes aux défaillances - un chiffre inimaginable, même pour les comploteurs les plus fous. Cette injection monétaire extraordinaire n'aurait pas été possible sans les blocages et autres restrictions sociales, qui ont contribué à "isoler l'économie réelle de la détérioration des conditions financières" - pour citer le document de juin 2019 de la Banque des règlements internationaux.
Nous approchons maintenant de l'heure des comptes pour le capitalisme ultra-financier. La mèche de la prochaine bombe spéculative est, comme prévu, le marché de la dette - et elle a déjà été allumée. Les obligations ne suivent plus la loi désormais mythologique de l'offre et de la demande. Selon cette loi, lorsqu'une obligation est très demandée, son prix augmente, tandis que son rendement (et donc son taux d'intérêt) diminue ; inversement, lorsque la demande d'obligations diminue, le prix diminue également, tandis que le rendement (et le taux d'intérêt) augmente. Des taux obligataires élevés devraient donc servir de soupape de sécurité pour toute bulle spéculative, puisqu'ils dénotent théoriquement une fuite de liquidités. En d'autres termes, à mesure que le coût de la dette augmente, le marché obligataire devrait se dégonfler, empêchant ainsi la surchauffe de l'économie elle-même. Cependant, l'ensemble du métavers financier est depuis longtemps systématiquement faussé par les banques centrales qui, par des injections massives de liquidités au cours des dernières décennies, ont créé un Frankenstein aujourd'hui incontrôlable. Les fortes turbulences actuelles sur les principaux marchés obligataires suggèrent que les banques centrales n'ont plus de lapin à sortir de leur chapeau. Si, en théorie, il n'y a pas de limite à la création de liquidités pour les achats d'obligations, les conséquences ne sont plus gérables par la seule politique monétaire. Comme les deux années de pantomime pandémique auraient dû nous l'apprendre, les élites se préparent à une guerre sociale totale, qui passe d'abord par l'asphyxie progressive de l'économie réelle.

Le potentiel destructeur de l'avalanche de dettes est si effrayant qu'il doit être caché. En décembre dernier, la BRI a souligné que la dette mondiale hors bilan détenue par les institutions financières et les fonds s'élevait à plus de 80 000 milliards de dollars, soit un montant supérieur à la masse totale des obligations en dollars, des opérations de pension et des billets de trésorerie en circulation. Il s'agit de dettes dérivées hors bilan, principalement des instruments spéculatifs complexes tels que les swaps de devises. Selon la BRI, cette dette invisible est passée de 55 à 80 000 milliards de dollars en dix ans, avec des opérations de change quotidiennes de 5 000 milliards de dollars. Les institutions financières et les fonds de pension américains détiennent deux fois plus d'obligations de swap que le montant de la dette en dollars dans leurs bilans. Les banques étrangères détiennent 39 000 milliards de dollars de dette dérivée cachée, soit "plus de 10 fois leur capital". Ce fardeau de la dette est une bombe à retardement au cœur de l'économie mondiale.
Alors qu'au lendemain de la crise financière mondiale de 2008, la Fed a déclaré son intention d'imposer un régime rigoureux de tests de résistance aux banques d'importance systémique mondiale, la révélation par la BRI d'une dette dérivée non déclarée nous ramène aux années fastes de la présidence de la Fed par Alan Greenspan (1987-2006), lorsque Wall Street a été autorisée à construire la montagne de produits dérivés toxiques qui a ensuite explosé en 2008. Que rien n'ait changé est aujourd'hui un secret de polichinelle, car la frénésie du crédit est le modus operandi du système depuis maintenant quatre décennies. Cependant, un environnement de plus en plus interconnecté présente un risque spontané de contagion. La dette libellée en dollars devenant plus onéreuse en raison de la hausse des taux d'intérêt, la défaillance d'une banque mondiale ou la vente d'actifs financiers accompagnée d'un krach sont des possibilités réelles, comme l'a montré la récente faillite de la Silicon Valley Bank (16ème banque américaine). Par conséquent, le système doit trouver des raisons de rester liquide à tout prix.
En effet, la seule option sur la table semble être la grande dévaluation. Certains analystes financiers prédisent depuis longtemps que la masse d'obligations la plus lourde de l'histoire sera tôt ou tard balayée par un tsunami de liquidités électroniques, créées à l'aide d'un clavier d'ordinateur. Bien qu'actuellement déguisés en faucons, les banquiers centraux pourraient bientôt - peut-être grâce à l'échec de la banque start-up de la Silicon Valley - redevenir des colombes, faisant définitivement couler les monnaies pour sauver les marchés obligataires. Une bulle de la dette se transformant en bulle de la monnaie ouvrirait ainsi la voie à un système basé sur une monnaie numérique centralisée (CBDC, Central Bank Digital Currency) - expérimentée depuis des années et actuellement envisagée par pas moins de 114 pays. Les entités transnationales telles que la BRI, le WEF, le FMI et la Banque mondiale sont confrontées au dilemme suivant : comment sauver les bulles en nous faisant croire que la contraction économique (une sorte d'effondrement au ralenti) est le résultat d'une série malheureuse d'événements d'urgence auxquels nous devrons nous adapter non seulement par la force, mais aussi spontanément, avec un esprit de sacrifice. C'est pourquoi les marionnettistes du capitalisme de crise sont si prompts à s'approprier une rhétorique traditionnellement de gauche : ils savent bien que ce n'est qu'au nom d'un prétendu idéal de "solidarité collective" que les masses appauvries seront capables d'accepter de nouvelles formes de domination déguisées en sacrifices nécessaires. Ainsi, la préservation tyrannique d'un mode de production aujourd'hui révolu nous est vendue pour deux bouts de fausse monnaie humanitaire.
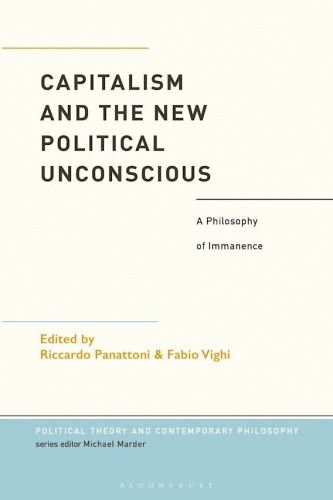
Les voies de la valeur sont révolues
Le véritable changement de paradigme au sein du capitalisme a eu lieu il y a quelques décennies, avec l'émergence d'un nouveau type de capital financier, qualitativement différent du précédent[4] Depuis au moins les années 1980, l'abstraction financière n'est plus l'appendice d'une "abstraction économique réelle" en plein essor - le lien social fondé sur la correspondance entre un temps de travail donné et une somme d'argent donnée (le salaire). La pseudo-industrie financière représente aujourd'hui la dernière version grotesque d'un modèle de société misanthropique né il y a environ cinq siècles, lorsque la force de travail "libérée" de la contrainte féodale est apparue pour la première fois sur le marché en tant que marchandise. Cependant, un gouffre s'est aujourd'hui creusé entre la chaîne de crédit artificiellement élargie et la masse totale de valeur extraite du travail. L'embarras de la science économique officielle face à ce gouffre correspond à son incapacité à comprendre que l'argent et la valeur ne coïncident pas, qu'ils ne représentent pas la même entité. Depuis le tournant du millénaire, nous avons assisté à un énorme transfert de liquidités vers les marchés obligataires et immobiliers, qui ont généré des bulles sans précédent d'argent sans valeur, c'est-à-dire de liquidités non soumises à la médiation du travail productif, non seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en Chine et en Europe. Cela a créé un mélange qualitativement nouveau de finance spéculative et d'économie basée sur la production et la consommation de biens réels.
Pendant un certain temps, la "fuite en avant" du crédit sans substance n'a pas généré d'inflation. Aujourd'hui, cependant, il est absurde de continuer à croire que la masse de capital fictif et spéculatif reste emprisonnée dans le secteur financier. Au contraire, il a déjà colonisé le monde réel, érodant à la fois notre pouvoir d'achat et le modèle de capitalisme dans lequel nous nous berçons encore d'illusions. Dans ce contexte, la limitation interne de la valeur de l'accumulation réelle agit comme un moteur externe, poussant le capital dans l'espace virtuel de la circulation transnationale des actifs financiers, qui est alimentée par des masses croissantes de dettes auto-cannibalisantes. Il ne s'agit pas simplement de la corruption pathologique du modèle original du capitalisme, mais de la conséquence logique de sa crise historique et structurelle.
À partir de la troisième révolution industrielle, dans les années 1970, l'utilisation de l'automatisation technologique (microélectronique) pour réduire les coûts de production et accroître la compétitivité a rendu le travail salarié producteur de valeur de plus en plus superflu, inhibant ainsi la création de nouvelle plus-value et déclenchant la spirale implosive. Depuis lors, la pyramide s'est inversée : l'appendice financier de la société de travail est devenu sa base. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui tous otages de la grande illusion qui fait du capital financier un dispositif en mouvement perpétuel, censé être sans répercussion sur le monde réel. Cependant, le travail improductif mondial ayant dépassé le point de non-retour, le choc de la dévaluation est inévitable : un choc économique destiné à se transformer en traumatisme violent pour la conscience sociale dans son ensemble.
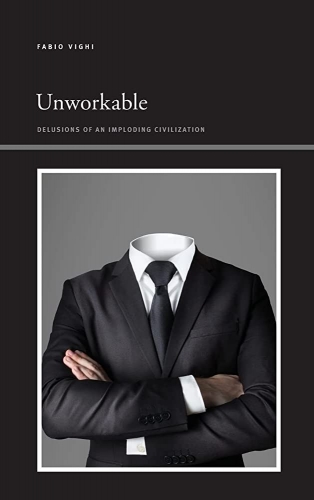
Un système de bulles de l'ordre de grandeur actuel ne peut coexister avec une croissance réelle basée sur la production et la consommation de masse. Si le volume actuel de capital fictif circulait librement, il déclencherait l'hyperinflation qui a été exportée jusqu'à présent dans les périphéries négligées du monde globalisé[5]. Le scénario de fin de civilisation dans lequel nous sommes entrés est le résultat de l'extraordinaire croissance de la dépendance au crédit au cours du 20ème siècle ; ce qui signifie avant tout que la monnaie n'a pas pu conserver sa forme antérieure, c'est-à-dire la convertibilité en or. La Première Guerre mondiale a déjà montré qu'il n'était plus possible de financer un conflit avec une monnaie liée à l'or. L'augmentation de la dette provoquée par la Seconde Guerre mondiale et le boom fordiste qui s'en est suivi ont conduit à la décision, en 1971, d'abandonner l'étalon-or. Dès lors, l'argent s'est accéléré dans le vide, ce que la théorie économique bourgeoise (ou néoclassique) n'a jamais compris dans ses implications les plus profondes. Le keynésianisme n'était qu'une tentative de sauver le capitalisme de lui-même, notamment par le biais du fétichisme des dépenses déficitaires : plus de dette publique censée ranimer la flamme de l'économie du travail. Les mouvements syndicaux d'inspiration marxiste n'ont jamais pleinement assimilé la critique de la valeur de Marx. Ils se sont plutôt concentrés sur des luttes de redistribution plus que légitimes, mais presque toujours dans l'horizon ontologique du capital lui-même. Après 1971, l'argent compris comme "réserve de valeur" est devenu une simple convention sans fondement objectif dans le lien social. La conséquence logique de cette perte de substance-valeur - qui, avec le néolibéralisme, a conduit à l'idéologie de la "croissance sans emploi" - est la dévaluation structurelle : soit par l'inflation, soit sous la forme d'une violente vague déflationniste déclenchée par un krach boursier.
Cette tendance est désormais irréversible. Aucun secteur de l'économie ne peut réactiver un cycle d'accumulation réelle et nous ramener à quelque chose de vaguement similaire au boom fordiste, également alimenté par des injections extraordinaires de crédit public. Lorsque le fordisme a implosé, il n'était plus possible de mobiliser une nouvelle main-d'œuvre de masse. C'est pourquoi le capital spéculatif fictif est aujourd'hui le deus ex machina qui compense la perte permanente de la plus-value totale. Le rêve d'une croissance infinie soutenue par la consommation de masse tourne au cauchemar. La phase dystopique dans laquelle nous sommes entrés se caractérise par une productivité sans travail productif, ce qui signifie tout simplement que la "société du travail" est en train de disparaître. Certes, de nombreuses entreprises continueront à tirer d'énormes profits de technologies de plus en plus sophistiquées et de l'exploitation de la main-d'œuvre précaire, mais le lien social organisé autour du travail salarié ne peut que continuer à se déliter.
L'acquisition d'un sens de la perspective critique sur l'implosion en cours du capitalisme sénile nécessite, comme condition préalable, de résister à l'agression de la propagande provenant de l'infosphère. Les grands médias ne nous informeront jamais sur les causes d'une économie structurellement insolvable, pour la simple raison qu'ils sont une émanation de ce système. Au lieu de cela, ils tentent de nous convaincre de chercher ailleurs : pandémies, guerres, préjugés culturels, scandales politiques, catastrophes naturelles, ovnis, extraterrestres, cyberattaques, etc. Alors que les médias s'efforcent aujourd'hui de cacher un effondrement que les gens vivent à fleur de peau, ils ont appris à rejeter la faute sur des événements exogènes. Le mal est toujours projeté ailleurs. En vérité, la crise actuelle se présente comme la deuxième vague de la même crise de 2008, s'inscrivant dans un effondrement systémique si aigu que sa cause est aujourd'hui scientifiquement occultée par des manipulations d'urgence.
Comprendre notre condition exige l'effort de penser contre soi-même, car, en règle générale, un sujet qui "appartient organiquement à une civilisation ne peut identifier la nature du mal qui la mine"[6] Le conformisme et l'"ignorance béate" sont infiniment plus contagieux que la force nécessaire pour affronter les contradictions systémiques. La plupart d'entre nous ne veulent pas se réveiller du tout, préférant croire que cette crise n'est due qu'à des erreurs, à la corruption ou à des problèmes techniques. La raison défensive, cependant, rabaisse la vitalité de la pensée, colonise la conscience et favorise notre adhésion inconsciente aux catégories obsolètes d'une civilisation épuisée.
Toute civilisation s'immunise en traçant une ligne de démarcation entre son ordre constitutif et le Mal. Ce dernier doit être projeté à l'extérieur du corps social pour donner au discours dominant l'illusion de la cohérence. Or, une civilisation mondiale au bord de la défaillance par rapport à sa propre valeur (l'auto-valorisation de la valeur appelée capital) ne peut plus se contenter d'ennemis partiels et localisés : elle doit agiter le spectre d'un Mal global et omniprésent. C'est pourquoi, après avoir remplacé la "pandémie", la guerre en Ukraine a été présentée dès le départ comme une sorte de synecdoque de la Troisième Guerre mondiale. La peur du virus a été remplacée par l'horloge de l'Apocalypse. La guerre devient ainsi le prolongement idéal de la Covid : un écran idéologique qui sert avant tout à masquer la douloureuse réalité quotidienne, de la récession à l'inflation structurelle en passant par les licenciements massifs. De plus, en traçant une frontière entre nous (moralement et culturellement supérieurs) et eux (les barbares), la guerre permet à la fois l'expansion monétaire (en finançant le complexe militaro-industriel, comme la "pandémie" avait financé Big Pharma) et l'expansion idéologique. À cet égard, la tension géopolitique entre le modèle occidental mondialisé dirigé par les États-Unis et le monde multipolaire en devenir (BRICS+) doit être comprise comme un effet de l'effondrement économique en cours, plutôt que comme son dépassement potentiel. La "nouvelle guerre froide" est déjà un fait, si personne d'autre que Morgan Stanley ne nous informe que la préparation du nouvel ordre multipolaire est désormais une priorité.

Quelle que soit la position de chacun sur l'échiquier géopolitique, le problème commun à tous les États capitalistes (et à l'aristocratie transnationale qui les chapeaute) sera de contrôler les vagues violentes de protestation dues à l'augmentation de l'appauvrissement des masses. Il suffit de jeter un coup d'œil à la récente déclaration du G20 à Bali, ou au dernier programme du WEF à Davos, pour se rendre compte que la principale préoccupation des élites est de s'assurer que les niveaux croissants de pauvreté sont gérés par des "solutions globales", allant de l'identité numérique à l'introduction de monnaies numériques contrôlées par le haut (CBDC). La coopération mondiale est le slogan idéologique des ultra-riches qui, voyageant en jet privé pour se mettre d'accord sur des mesures de lutte contre le changement climatique telles que les traqueurs d'empreinte carbone, savent qu'ils doivent tenir en laisse les populations et les sociétés stagnantes. À cet égard, l'esprit de seigneuriage néo-féodal de notre époque est bien représenté par le "modèle d'enfermement" : d'une part, nous avons tendance à oublier que des millions d'êtres humains socialement exclus vivaient déjà dans des conditions d'enfermement effectives bien avant la pandémie, confinés dans des bidonvilles de banlieue ou dans les périphéries rurales du monde, sans accès à l'emploi ou aux produits de première nécessité ; d'autre part, nous savons que les enfermements vécus dans la "pandémie" serviront de prototype pour nous "protéger" contre les traumatismes d'urgence à venir.
Il est donc essentiel de comprendre que nous sommes confrontés à un effondrement socio-économique généralisé, qui prend désormais la forme d'une dissolution du contrat social - comme en témoigne l'effondrement de la participation des citoyens à la pantomime du vote. Les véritables détenteurs du pouvoir (l'aristocratie transnationale dont la politique est la servante) continueront à favoriser les conflits et les divisions de toutes sortes pour masquer l'implosion du système et promouvoir le changement de paradigme autoritaire. Aujourd'hui, toute hostilité, géopolitique ou autre, commence et finit dans l'enfer du capitalisme de crise, soutenu par la machine de propagande. La fin du socialisme dans les années 1980 a levé le voile de Maya. Depuis, comme le dirait un bouddhiste, "le dualisme est une illusion" : il n'y a qu'un seul dogme socio-économique, et il ne fonctionne plus. Maintenir le capitalisme de consommation en vie en étendant la dette à l'infini est désormais impossible, ou ouvertement autodestructeur. La montagne de reconnaissances de dettes a dépassé ce que nous possédons comme garantie (nos actifs, notre force de travail, notre "vie nue"), tandis que l'argent se transforme en papier usagé. La Grande Réinitialisation est une tentative de répondre à cette crise terminale en augmentant l'emprise sur nos vies - tandis qu'autour de nous grandit l'anxiété silencieuse d'une fin du monde imminente, peut-être la seule émotion qui puisse encore nous sauver.
Notes:
[1] George Orwell, 1984 (Milan : Mondadori, 1950), p. 239.
[2] Ibid, p. 201.
[3] Cf. Pier Paolo Pasolini, Il fascismo degli antifascisti (Milan : Garzanti), 2018.
[4] Cf. Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft (Francfort : Eichborn Verlag), et The Capital World. Globalization and Internal Limits of the Modern Commodity-Producing System (Milan : Meltemi, 2022).
[5) Des cycles d'hyperinflation dans le monde globalisé ont eu lieu en Bolivie (1985), en Argentine (1989), au Pérou (1990), au Nicaragua (1991), en Bosnie (1992), en Ukraine (1992), en Russie (1992), en Moldavie (1992), en Arménie (1993), au Congo (1993), en Yougoslavie (1994), en Géorgie (1994), en Bulgarie (1997), au Venezuela (2016), au Zimbabwe (2007/09 et 2017), au Liban (2020-aujourd'hui), etc.
[6] Emile Cioran, La tentation d'exister (Milan : Adelphi, 1984), p. 27.
16:37 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, dettes, bulles spéculatives, économie, définition, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 mai 2023
La multipolarité et la montée des États civilisationnels

La multipolarité et la montée des États civilisationnels
Zhang Weiwei
Transcription du discours de Zhang Weiwei lors de la conférence mondiale sur la multipolarité du 29 avril 2023.
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/multipolarity-and-rise-civilizational-states
À la veille de la visite du président chinois Xi Jinping en Russie, le 19 mars, j'ai été interviewé par Russia Today, qui m'a demandé comment je percevais les lourdes sanctions occidentales imposées à la Russie, et j'ai répondu que la Russie avait été isolée par l'Occident et que l'Occident avait été isolé par les autres. La raison en est simple: si l'opération militaire russe en Ukraine est controversée, l'un des objectifs avoués de la Russie est de transformer l'ordre mondial multipolaire dirigé par les États-Unis en un ordre mondial multipolaire, et cet objectif est largement soutenu ou du moins compris par le monde non occidental.
Leur soutien ou leur compréhension de cet objectif est renforcé par le fait que les grandes puissances non occidentales comme la Chine, la Russie, l'Inde et l'Iran, et d'autres encore, se qualifient ouvertement d'États civilisationnels. Ils peuvent diverger sur la définition exacte du terme "État civilisationnel", mais ils semblent s'accorder sur au moins trois thèmes : premièrement, ils constituent tous respectivement une civilisation unique, deuxièmement, ils en ont assez que l'Occident leur impose ses valeurs au nom de "valeurs universelles" et, troisièmement, ils résistent à l'ingérence de l'Occident dans leurs affaires intérieures.
Ces États civilisationnels en plein essor remettent en effet en question l'ordre mondial unipolaire dit libéral, et le monde assiste ainsi à un changement de l'ordre mondial, qui passe d'un ordre vertical, dans lequel l'Occident est au-dessus des autres, à un ordre horizontal, dans lequel l'Occident et les autres sont sur un pied d'égalité en termes de richesses, de pouvoir et d'idées. Sans parler des autres puissances non occidentales, la Chine à elle seule a contribué davantage à la croissance économique mondiale que les pays du G7 réunis (38 % contre 25 %) au cours des dix dernières années. L'utilisation du dollar par les États-Unis dans le cadre de leurs sanctions contre la Russie n'a fait qu'inciter de plus en plus de pays non occidentaux à abandonner l'utilisation du dollar dans leurs échanges internationaux, ce qui porte un coup terrible à l'ordre économique unipolaire existant. L'année dernière, 70 % des échanges sino-russes ont été réalisés dans les monnaies locales, et l'Inde, le Brésil, l'Iran, la Turquie, l'Indonésie et d'autres grands pays non occidentaux encouragent tous les échanges dans leurs monnaies locales.
Il est également vrai que dans les relations internationales, les puissances occidentales ont longtemps poursuivi une stratégie de "diviser pour régner" depuis l'époque coloniale. En revanche, les grandes puissances non occidentales, notamment la Chine, suivant sa tradition d'État civilisationnel, poursuivent exactement le contraire, c'est-à-dire "unir et prospérer", comme le montre sa vaste initiative "la Ceinture et la Route" (BRI), qui s'avère populaire auprès de la plupart des pays, et la Chine estime également que cet idéal d'union et de prospérité représente les meilleurs intérêts des Chinois ainsi que de la plupart des autres peuples.

Le pouvoir politique et l'autorité morale de Washington s'affaiblissant rapidement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, il est tout à fait naturel que les pays non occidentaux s'inspirent de leurs propres cultures et civilisations pour se démarquer du modèle libéral américain discrédité et de son hégémonie unipolaire.
Il est intéressant de noter que l'idée d'un État-civilisation est également attrayante pour de nombreuses personnes dans le monde occidental. Par exemple, face aux défis redoutables de la "renationalisation" de l'Europe, le président français Macron a presque ouvertement admiré l'idéal de l'État civilisationnel en citant la Chine, la Russie et l'Inde comme exemples et en déclarant que le destin historique de la France était de guider l'Europe vers un renouveau civilisationnel.
Pour la droite occidentale, le modèle de l'État civilisationnel est un moyen de défendre les valeurs traditionnelles et de résister à l'excès de l'ultralibéralisme et à la dégénérescence culturelle largement perçue, tandis que pour la gauche, ce modèle témoigne du respect dû aux cultures et aux traditions indigènes et constitue un moyen de rejeter l'impérialisme occidental et l'excès du néolibéralisme.
En effet, les États civilisationnels émergents d'Eurasie se définissent principalement contre l'Occident libéral, tandis que l'Occident s'efforce aujourd'hui de définir sa propre identité, ce qui semble plus difficile que pour la Chine ou la Russie. D'une part, les libéraux ont longtemps prêché des valeurs universelles au-delà des frontières nationales ou civilisationnelles et pensent que leurs valeurs sont universelles, ni occidentales, ni européennes, ni judéo-chrétiennes. Pourtant, le politologue européen Bruno Maçães affirme que l'"Occident" libéral est aujourd'hui mort, reflétant sa sympathie pour "une révolte contre le déracinement mondial".

Cependant, l'Occident peut-il exister en tant qu'entité civilisationnelle indépendante ? L'universitaire britannique Christoph Coker note que "ni les Grecs ni les Européens du XVIe siècle... ne se considéraient comme "occidentaux", un terme qui ne remonte qu'à la fin du XVIIIe siècle".

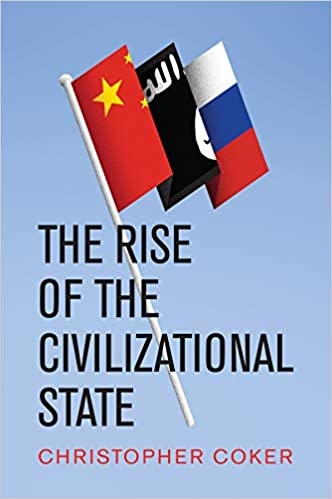
Certains libéraux occidentaux prônent un retour aux Lumières en Europe, mais il est évident que le libéralisme des Lumières, avec ses tendances universelles, a conduit l'Occident à son dilemme actuel, qui a coupé l'Occident, et l'Europe en particulier, de ses propres racines culturelles, comme le note Macaes : "Les sociétés occidentales ont sacrifié leurs cultures spécifiques au nom d'un projet universel." En effet, un Occident divisé culturellement, socialement et politiquement, comme c'est le cas aujourd'hui, a encore une bataille difficile à mener avant de façonner une identité civilisationnelle commune, si tant est qu'il y en ait une.
Dans une perspective à moyen et long terme, comme l'ordre mondial devient de plus en plus horizontal plutôt que vertical, et que l'Occident et les autres pays sont davantage sur un pied d'égalité en termes de richesse, de pouvoir et d'idées, il est probable que nous assistions à l'émergence d'un plus grand nombre de communautés ou d'États civilisationnels, autoproclamés ou authentiques, parmi lesquels il pourrait bien y avoir une communauté civilisationnelle occidentale sur un pied d'égalité avec d'autres. Il faut espérer que les "valeurs universelles" définies unilatéralement par l'Occident seront progressivement remplacées par certaines valeurs communes approuvées par l'ensemble de la communauté internationale, telles que la paix, l'humanité, la solidarité internationale et une seule communauté humaine, et que toutes les communautés civilisationnelles apporteront leur contribution à cette noble entreprise dans l'intérêt de l'humanité tout entière.
18:15 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multipolarité, chine, actualité, zhang weiwei, occident, état-civilisation, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 avril 2023
Diego Fusaro: Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?

Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/por-que-el-capital-aspira-a-destruir-la-escuela/
La pédagogie néolibérale dégrade l'école en tant qu'entreprise destinée à produire des compétences adéquates pour le fonctionnement du système. Elle célèbre donc le stockage des compétences et la primauté de l'action: elle dissout toute figure de la connaissance non liée au pragmatisme de l'efficacité.
C'est ainsi que triomphe sur tout l'horizon ce que l'on pourrait définir comme une "culture barbare", pour reprendre l'image de Veblen dans la Théorie de la classe oisive : une culture qui non seulement ne favorise pas l'émancipation de la société, mais qui la pousse dans la direction opposée, en réprimant tout désir possible d'échapper à la cage d'acier du monde réduit à la marchandise. Les anciens régimes brûlaient les livres : l'actuel, sous forme de marchandise, rend structurellement impossible la figure du lecteur.
Dans le triomphe de l'esprit de quantité sur l'esprit de finesse, le capital ne peut accepter l'existence d'esprits pensants autonomes, de sujets éduqués, dotés d'une identité culturelle et d'une profondeur critique, conscients de leurs racines et de la fausseté du présent. En d'autres termes, il ne peut accepter le profil bourgeois antérieur de l'homme éduqué, enraciné dans sa culture historique et ouvert à l'avenir dans la planification.
Elle aspire au contraire à voir partout les mêmes, c'est-à-dire des atomes consommateurs sans identité et sans culture, de pures têtes calculatrices et irréfléchies, capables de ne parler que l'anglais des marchés et de la finance et incapables de remettre en cause l'appareil technico-économique dans sa totalité expressive.

C'est dans ce même cadre cognitif qu'il faut insérer le phénomène des soi-disant "universités numériques", qui offrent à leurs étudiants des cours à distance et des diplômes obtenus sans jamais avoir mis les pieds dans les espaces concrets de l'université comme lieu de discussion et de comparaison, de dialogue et d'exercice de la critique.
La nouvelle figure numérique, de ce point de vue, favorise les processus d'individualisation de masse, en neutralisant l'élément de confrontation humaine et de concentration des étudiants dans les mêmes lieux et, dans l'ensemble, en réduisant de plus en plus la connaissance à des modules pré-packagés administrés à distance, sans aucune relation humaine avec l'enseignant.
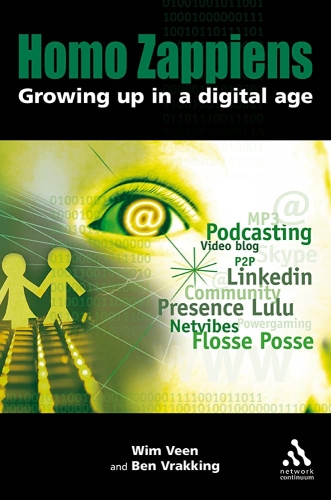
C'est ce qu'ont théorisé, entre autres, Veen et Vrakking dans leur étude Homo zappiens : leur proposition théorique se concentre sur l'idée de rompre avec les formes pédagogiques traditionnelles et, selon eux, obsolètes, et d'adapter les lieux d'enseignement aux besoins de la génération du net. Internet et son modèle doivent donc remplacer les leçons frontales classiques avec lesquelles l'Occident a transmis le savoir doré de l'époque grecque au Moyen-Âge, de la Renaissance au 20ème siècle.
Au cours des vingt dernières années, l'école en Europe a été soumise à une dynamique radicale de corporatisation, qui l'a rapidement reconfigurée dans ses fondements mêmes.
D'un institut de formation d'êtres humains au sens plein, conscients de leur monde historique et de leur histoire, elle s'est transformée en une entreprise fournissant des aptitudes et des compétences inextricablement liées au dogme utilitaire du "servir à quelque chose".
Le phénomène de la "dette étudiante" qui caractérise les campus universitaires libéraux américains et la privatisation totale de la culture sont significatifs à cet égard. Les universités publiques et privées ne cessent d'augmenter les frais de scolarité, obligeant de fait les étudiants à s'endetter pour y accéder : ainsi, non seulement les universités sont transformées en avant-postes de la valorisation de la valeur et en usines à profit, animées par le désir d'avoir plus, désir célébré par le Second traité de gouvernement de Locke, mais les étudiants eux-mêmes se retrouvent prisonniers des mécanismes de captation de la dette. Ils deviennent, dès leur plus jeune âge, les esclaves d'une dette qu'ils tenteront (le plus souvent sans succès) de rembourser tout au long de leur existence.

Dans le passage de l'Académie platonicienne et du Lycée aristotélicien aux écoles de commerce, on pourrait en effet diagnostiquer la parabole de l'Occident, à la merci du pathologique "pan-économisme utilitariste" théorisé par Latouche.
De l'éducation comprise au sens classique comme le développement complet et multiforme de la personnalité humaine, nous sommes passés sans effort à la formation comme accumulation intensive de compétences techniques et pratiques, fonctionnelles pour l'insertion dans le marché du travail instable, flexible et précaire.
Il en résulte une perversion du concept classique de l'école en tant que lieu où le temps est soustrait à l'emprise du profit et consacré à l'apprentissage en vue de la formation de soi.
À cet égard, il est utile de rappeler que les langues européennes appellent "école" (Schule, school, escuela) l'institution de formation primaire des jeunes, en référence directe au σχολή des Grecs, c'est-à-dire au temps libre, que les Romains définiront comme otium, et l'otium est, par essence, le contraire du negotium, qui est le temps occupé par l'entreprise au nom du profit. Le paradoxe de l'école à l'ère du capitalisme post-bourgeois est qu'elle se convertit de plus en plus ouvertement au principe du negotium, devenant une institution de préparation aux pratiques de travail et niant ainsi sa propre essence d'otium.
Même dans le cas de l'enseignement scolaire et universitaire, la règle générale du système chrématistique flexible et précaire s'applique : la corporatisation du monde de la vie se déroule en même temps que la dés-éthicisation du monde de la vie. La marchandisation intégrale repose sur la destruction des contraintes éthiques antérieures de la phase bourgeoise et sur l'apogée de l'individualisme consumériste.
L'introduction de la rationalité libérale dans la structure la plus profonde de la personnalité détermine l'occupation intégrale du matériel et de l'immatériel par la forme marchandise et son modèle calculateur et économiste corrélatif : ce paradigme imprègne intégralement le moi, mais aussi l'ego, la sphère magmatique et insaisissable des instincts et des pulsions ; il n'épargne pas non plus le surmoi, envahissant même le champ des questions morales et religieuses. C'est là que se situe ce que l'on a appelé la "néolibéralisation des sujets".
La pulvérisation de l'éthique et de ses racines va de pair avec la réoccupation de ses espaces par le système des besoins et la forme marchande. Cela se voit non seulement dans la redéfinition corporative des écoles publiques dans le cadre de l'ordre néolibéral, mais aussi dans la privatisation d'autres instituts éthiques fondamentaux tels que les systèmes pénitentiaire et hospitalier.
En ce qui concerne le premier, la monarchie du dollar est, dans ce cas également, à l'avant-garde du processus de post-modernisation : la privatisation du système pénitentiaire dans ce pays expose les prisonniers à un contrôle vexatoire, souvent clairement éloigné de la réglementation juridique et politique.

Les coups brutaux et la malnutrition visible sont la règle et, dans l'ensemble, la mise en œuvre nécessaire du principe "business is business" : selon ce principe, le prisonnier cesse d'être considéré comme une personne à rééduquer et à réhabiliter, en vue de sa réinsertion dans la société civile, et commence à être considéré comme une ressource dont on peut extraire la plus-value.
Cela se traduit par la recherche spasmodique de nouvelles "ressources" à interner (pour qu'il n'y ait plus de places vides) et, par conséquent, par de nouvelles politiques répressives, y compris en ce qui concerne les soi-disant "délits mineurs".
En ce qui concerne le secteur de la santé, le régime libéral promeut, à son image, une "marchandisation" de plus en plus accentuée de la santé et de la vie. Cela permet d'affirmer que les soins de santé sont profondément malades : le soin, dans son acception spécifiquement scientifique (l'éradication de la maladie) et humaniste ("Sorge" comme modalité existentielle fondamentale, comme le suggère l'Être et le Temps), est remplacé par la figure corporative du profit comme finalité ultime de l'action.
La redéfinition libérale du paradigme médical produit des effets désastreux et hautement contradictoires, qui dépendent en fin de compte de la reconfiguration (toujours dans le sillage du modèle américain) de la santé, qui passe d'un droit du citoyen à un bien de consommation. Parmi les effets les plus regrettables, on peut citer la réduction drastique du personnel médical et infirmier, avec pour corollaire un ralentissement des délais d'intervention et un risque accru de mortalité pour les patients, devenus entre-temps des "consommateurs". Il ne faut pas non plus oublier que les crédits alloués à des maladies telles que le cancer et la réduction considérable des soins aux personnes handicapées et aux malades mentaux sont de plus en plus réduits.
Dans le second contexte, il est soutenu par l'émergence de la nouvelle figure de l'"entreprise de santé", qui remplace les anciens "hôpitaux" publics : plus généralement, le droit aux soins universellement reconnu pour chaque citoyen devient une marchandise disponible en fonction de la valeur d'échange, avec pour conséquence une croissance exponentielle à la fois dans le secteur de la santé de luxe de la chirurgie esthétique pour quelques-uns, et dans l'impossibilité, pour beaucoup, d'accéder à des traitements de base.
Diego Fusaro
Diego Fusaro (Turin, 1983) est professeur d'histoire de la philosophie à l'IASSP de Milan (Institute for Advanced Strategic and Political Studies) où il est également directeur scientifique. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l'histoire à l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Fusaro est un disciple du penseur marxiste italien Costanzo Preve et du célèbre Gianni Vattimo. Il est spécialiste de la philosophie de l'histoire, notamment de la pensée de Fichte, Hegel et Marx. Il s'intéresse à l'idéalisme allemand, à ses précurseurs (Spinoza) et à ses successeurs (Marx), avec un accent particulier sur la pensée italienne (Gramsci ou Gentile, entre autres). Il est éditorialiste pour La Stampa et Il Fatto Quotidiano. Il se définit comme un "disciple indépendant de Hegel et de Marx".
16:41 Publié dans Actualité, Ecole/Education, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, école, éducation, philosophie, économisme, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 mars 2023
Marx et/ou Piketty: Apocalypse ou rédemption?

Marx et/ou Piketty: Apocalypse ou rédemption?
Constantin von Hoffmeister
Source: https://eurosiberia.substack.com/p/marx-vs-piketty-apocalypse-or-redemption?utm_source=post-email-title&publication_id=1305515&post_id=108450465&isFreemail=true&utm_medium=email
Dans les recoins obscurs de l'intellect humain, Karl Marx, géniteur du credo moderne du communisme, et Thomas Piketty, érudit de l'époque actuelle originaire du pays des Gaulois, sont accaparés par les mystères insondables de l'inégalité économique et par le spectre insaisissable de la justice sociale. Les esprits de Marx et de Piketty, enchevêtrés dans les profondeurs labyrinthiques de la pensée, sont déchirés par un profond schisme concernant les origines du gouffre béant de la disparité économique et les moyens les plus efficaces de l'expurger.
Marx considérait le capitalisme comme un système fondamentalement injuste qui, par nature, perpétue l'inégalité et l'oppression. Il a identifié la bourgeoisie riche comme la classe dominante qui contrôle les moyens de production, utilisant son pouvoir pour exploiter la classe ouvrière, ou prolétariat, en lui versant de maigres salaires pour son travail. Cette exploitation est le résultat de la logique de profit du système capitaliste, qui privilégie l'accumulation des richesses au détriment du bien-être des travailleurs. Selon Marx, la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat est à l'origine de la perpétuation des inégalités sociales et économiques. En outre, il a reconnu que la classe dirigeante emploie des tactiques pour diviser la classe ouvrière, par exemple en jouant sur les différences raciales et ethniques, afin de l'empêcher de s'unir et de renverser ses oppresseurs. La compréhension de l'artifice du divida et impera n'échappait pas à la perspicacité de Marx, qui voyait dans ce stratagème nocif une arme redoutable dans l'arsenal de l'ordre dominant, utilisée pour subjuguer les multitudes infortunées en instillant en leur sein une culture pernicieuse de désunion et de discorde. Pour Marx, la seule solution à ce système d'exploitation est une révolution au cours de laquelle le prolétariat s'empare des moyens de production et établit une société sans classe fondée sur l'égalité et la coopération.
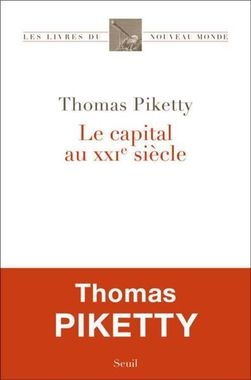 En revanche, Piketty affirme que l'inégalité économique est souvent liée à des systèmes sociaux et politiques qui privilégient certains groupes par rapport à d'autres sur la base de la race, de l'appartenance ethnique et d'autres facteurs. Selon lui, la question de l'inégalité économique n'est pas simplement une question de malchance ou de responsabilité individuelle, mais plutôt un problème systémique qui nécessite une solution systémique. Il estime que l'accumulation de richesses par une petite minorité d'individus est non seulement injuste, mais qu'elle constitue également une menace pour la stabilité sociale et la démocratie. Piketty considère la fiscalité progressive comme un outil essentiel pour résoudre ce problème, car elle contribuerait à redistribuer la richesse des plus hauts revenus vers le reste de la société. Cela permettrait de réduire l'écart entre les riches et les pauvres et de créer une répartition plus équitable des ressources. Cependant, Piketty reconnaît également que l'impôt progressif ne suffirait pas à lui seul à créer une société véritablement équitable. D'autres politiques, telles qu'un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé, seraient également nécessaires pour garantir que chacun ait les mêmes chances de réussir, quels que soient ses antécédents ou son statut social. En fin de compte, Piketty considère la redistribution des richesses comme une étape cruciale vers la création d'une société où chacun aura les mêmes chances de prospérer et de réussir.
En revanche, Piketty affirme que l'inégalité économique est souvent liée à des systèmes sociaux et politiques qui privilégient certains groupes par rapport à d'autres sur la base de la race, de l'appartenance ethnique et d'autres facteurs. Selon lui, la question de l'inégalité économique n'est pas simplement une question de malchance ou de responsabilité individuelle, mais plutôt un problème systémique qui nécessite une solution systémique. Il estime que l'accumulation de richesses par une petite minorité d'individus est non seulement injuste, mais qu'elle constitue également une menace pour la stabilité sociale et la démocratie. Piketty considère la fiscalité progressive comme un outil essentiel pour résoudre ce problème, car elle contribuerait à redistribuer la richesse des plus hauts revenus vers le reste de la société. Cela permettrait de réduire l'écart entre les riches et les pauvres et de créer une répartition plus équitable des ressources. Cependant, Piketty reconnaît également que l'impôt progressif ne suffirait pas à lui seul à créer une société véritablement équitable. D'autres politiques, telles qu'un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé, seraient également nécessaires pour garantir que chacun ait les mêmes chances de réussir, quels que soient ses antécédents ou son statut social. En fin de compte, Piketty considère la redistribution des richesses comme une étape cruciale vers la création d'une société où chacun aura les mêmes chances de prospérer et de réussir.
Piketty appelle à la mise en place d'un organisme de contrôle qui collecterait des données sur la discrimination, y compris le racisme anti-blanc, qui, selon lui, sera probablement minime. En réalité, les profondeurs de la discrimination anti-caucasienne sont à la fois insondables et, très probablement, plus répandues que celles qui visent les individus d'origine non blanche. L'hypothèse erronée de Piketty n'est qu'une indication de sa compréhension et de sa perspicacité limitées en la matière. Son erreur de jugement met en lumière les complexités labyrinthiques du monde moderne interconnecté et les subtiles complexités de l'esprit humain, qui peuvent souvent obscurcir les vérités les plus flagrantes.
Piketty recommande l'utilisation de données tirées des recensements et des registres de salaires pour faire la lumière sur la discrimination. Il met toutefois en garde contre l'adoption de catégories rigides telles que celles utilisées aux États-Unis et au Royaume-Uni, car elles ont déjà causé des ravages et des dévastations. Dans les annales labyrinthiques du Rwanda, une division énigmatique et inéluctable est apparue entre deux tribus énigmatiques : les Hutus et les Tutsis. Les origines de cette division ont été enveloppées dans un voile impénétrable de bureaucratie et de politiques identitaires alambiquées, mises en œuvre par d'obscures figures d'autorité qui exerçaient leur pouvoir avec une insondable impunité - les colonisateurs belges. Cet obscur système de classification assignait les mortels du Rwanda à deux castes distinctes et immuables, chacune apparemment dotée de ses propres traits et attributs impénétrables. Les Hutus, un groupe opprimé et privé de ses droits, ont observé avec un ressentiment croissant leurs homologues tutsis jouir d'un statut privilégié et de l'insaisissable promesse d'un avenir meilleur. En fin de compte, ce système de division incompréhensible et kafkaïen a culminé dans un cataclysme cauchemardesque de violence, de mort et de destruction, laissant une marque obsédante et indélébile sur le pays et ses habitants.
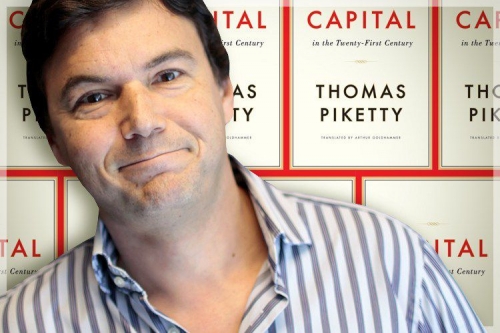
Au lieu de cela, Piketty propose de s'interroger sur l'ascendance globale d'un peuple plutôt que de l'assigner à des catégories raciales ou ethniques strictes. Piketty critique les quotas, qui ont été utilisés par les élites pour éviter d'investir dans l'éducation, les soins de santé ou les infrastructures, et qui ont également exacerbé les tensions entre les groupes, comme on le voit dans les coins sombres des États-Unis, où les murmures de cette question litigieuse résonnent dans les couloirs du pouvoir, en parlant des politiques de discrimination positive qui cherchent à accroître la représentation de ceux qui ont été longtemps marginalisés. Hélas, à chaque pas en avant, il y a une résistance, un retour de bâton de la part de ceux qui pensent que c'est injuste et que c'est une menace pour la majorité blanche. Leurs craintes se manifestent dans de vils débats qui pénètrent même les murs les plus solides du progrès, laissant la nation trembler dans l'incertitude. Cependant, Piketty invoque le nom de l'Inde, un pays entouré de mystères anciens et de légendes interdites, comme une lueur d'espoir, où la mise en œuvre des quotas a apporté une grande amélioration pour les sans-castes opprimés et, dans son sillage, a adopté une approche plus pragmatique et holistique de l'élévation socio-économique.
Dans ses grandes idéologies, Marx a affirmé qu'à travers les âges, la classe dirigeante a utilisé une pléthore de catégories pour justifier et perpétuer l'inégalité économique et sociale. L'aristocratie et la bourgeoisie ont toujours exercé leur pouvoir sur les classes inférieures, tandis que les colonisateurs et les maîtres d'esclaves ont catégorisé et assujetti les gens sur la base de leur race et de leur appartenance ethnique. Ces catégories sont des outils d'oppression qui permettent à la classe dirigeante de consolider son pouvoir et de maintenir son emprise sur la société. Ainsi, l'inégalité n'est pas un résultat inhérent ou prédestiné des systèmes économiques, mais plutôt le produit insidieux des machinations calculées par les puissants pour maintenir leur domination sociale et économique sur la classe ouvrière. Marx pensait que la lutte entre la majorité opprimée et la minorité privilégiée était inévitable et qu'elle culminerait finalement dans une confrontation apocalyptique. Dans sa vision inquiétante, les masses opprimées se soulèveraient contre leurs oppresseurs et la conflagration qui en résulterait consumerait l'ordre existant, laissant dans son sillage un monde nouveau marqué par le symbole de la bête, emblème du triomphe final du mal sur le bien.
Merci d'avoir lu Eurosiberia ! Abonnez-vous gratuitement pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail.
Constantin est sur Twitter, Telegram et Substack. Songez à le suivre et à vous abonner !
Twitter: @constantinvonh
Telegram: https://t.me/eurosiberia1
Substack: https://eurosiberia.substack.com
Eurosiberia
19:35 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, thomas piketty, capitalisme, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 15 mars 2023
Choc des civilisations ?
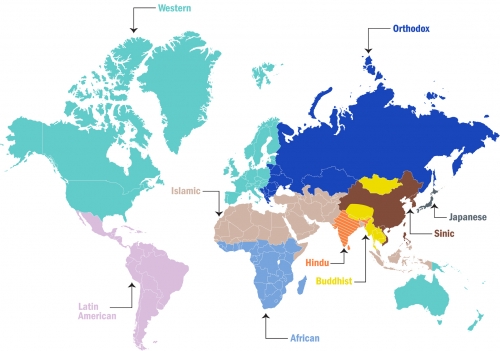
Compte rendu de Oriente contra occidente, par Denis Collin. Letras inquietas. Cenicero, 2022, 57 p.
Choc des civilisations ?
Par Genís Plana
Sources : El Viejo Topo & https://rebelion.org/choque-de-civilizaciones/
Denis Collin est l'un de ces penseurs inconfortables du spectre politique homologué : c'est-à-dire de cette actualisation de l'axe gauche-droite selon laquelle la gauche se ferait la championne du multiculturalisme cosmopolite, tandis que la droite revendiquerait la défense folklorique de la tradition nationale ; mais dans les deux cas, les intérêts économiques des classes populaires seraient absents. Ce n'est pas le système de coordonnées politiques sur lequel évolue Collin. Maître de conférences à l'université de Rouen jusqu'à sa retraite en 2018, ce philosophe français "s'efforce de réconcilier socialisme et républicanisme" tout en "défendant l'État-nation contre les tendances dissolvantes, mondialistes et globalisantes de notre temps". Et cette audace, aujourd'hui stigmatisée par le stigmate du "rouge-brunisme", caractérise plusieurs de ses écrits, dans lesquels il se penche sur ce que certains ont considéré comme l'angle mort du marxisme : la nation.

Selon lui, le marxisme standardisé commettrait une erreur d'analyse s'il considérait que les conflits nationaux ne sont que l'expression de conflits entre groupes capitalistes. Collin considère que les nations ont une densité culturelle et religieuse propre, et que celle-ci n'est pas un simple épiphénomène de la sphère économique. Certes, dans le mode de production capitaliste, l'économie prend une dimension prépondérante dans la vie sociale, mais elle le fait sur la base idéologique de chaque pays ou région, qui doit aussi être prise en compte comme un facteur actif dans les processus historiques. Sur la base de ces hypothèses, quelle est l'approche centrale du livre ? L'approche est la suivante :
Face à l'unipolarité qui a émergé après la disparition de l'Union soviétique, on pourrait supposer que la lutte des classes s'exprimerait à travers une lutte des peuples opprimés par l'impérialisme américain. C'est pourquoi de nombreux gauchistes verraient dans l'islamisme une sorte de mouvement anti-impérialiste capable d'exprimer la voix des opprimés. Cependant, c'est une thèse que Collin nie : ces autres peuples ou nations non occidentaux ne constituent pas, dans l'ensemble, une alternative au capitalisme, car dans leur propre réalité, la logique du capital a déjà pénétré. En effet, le développement du capitalisme dans le monde implique l'absorption de la culture et de la religion de chaque pays ou région, ce qui rend viable la pleine compatibilité du capitalisme avec les différentes formes d'État, des théocraties comme celles des pays arabes aux systèmes parlementaires des républiques consolidées. Ainsi, "les contradictions et les conflits entre les différentes parties du système capitaliste mondial" ne doivent pas être compris comme une prétendue lutte entre le capitalisme impérialiste américain d'une part et l'anti-impérialisme des peuples opprimés d'autre part. Il faut plutôt examiner "l'articulation entre le mode de production capitaliste et l'héritage historique propre à chaque pays".

En fait, l'auteur nie l'existence d'un conflit entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman, thèse avancée par des auteurs tels que Samuel P. Huntington qui cherchent à légitimer le nouvel ordre mondial américain face à la menace que représente le fondamentalisme islamique. Collin affirme que l'Est et l'Ouest sont des catégories qui fonctionnent idéologiquement pour dissimuler l'influence du pouvoir américain sur le wahhabisme, qui a été instrumentalisé à de multiples reprises par l'impérialisme américain. Et bien que le fondamentalisme islamique ait été présenté comme l'ennemi juré du monde anglo-saxon à la suite de l'attaque des tours jumelles, tous deux sont dans la même tranchée contre un ennemi commun : le communisme. L'auteur ne mâche pas ses mots : "Le fondamentalisme islamique est un ennemi mortel de la démocratie, du mouvement ouvrier et de l'émancipation de l'humanité. Et il doit être traité comme tel par tous les défenseurs du socialisme, du communisme ou même du simple idéal républicain".
La lecture de ce très court essai permet de montrer que l'opposition simpliste entre l'Occident et l'Orient masque les aspects réellement à l'œuvre dans les conflits actuels, où s'entremêlent logiques culturelles et, bien sûr, intérêts économiques. Letras Inquietas a raison d'oser publier en espagnol un auteur qui, bien que méconnu, est largement intéressant.
Rebelión a publié cet article avec l'autorisation de l'auteur sous une licence Creative Commons, en respectant sa liberté de le publier dans d'autres sources.
19:58 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : denis collin, choc des civilisations, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 février 2023
Hybris, le mot clé de la politique américaine

Hybris, le mot clé de la politique américaine
Alexander Bovdunov
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/hybris-la-parola-chiave-della-politica-americana
Mot du jour : ὕβρις (Hybris) est une catégorie négative de la culture grecque classique. Ce mot signifie manque de mesure, arrogance, ivresse du pouvoir, confiance excessive en soi.
Dans le réalisme classique de Hans Morgenthau, basé en grande partie sur l'Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, la catégorie ὕβρις a une signification particulière. Les réalistes, qui proposent un retour aux origines (c'est-à-dire aux Grecs) par opposition aux néo-réalistes, chez qui les concepts d'"équilibre des forces", de "puissance" et d'"anarchie internationale" acquièrent des traits mécaniques, y prêtent une attention fondamentale.

Hans Morgenthau.
Dans cette interprétation, c'est l'ὕβρις qui est la cause du déclin et des défaites d'Athènes. L'absence de la vertu de maîtrise de soi conduit au déclin du pouvoir hégémonique. Seule la maîtrise de soi, une mesure, permet de gouverner efficacement. Sinon, c'est le désastre.
"L'arrogance de la tragédie grecque et shakespearienne, le manque de retenue d'Alexandre, de Napoléon et d'Hitler sont des exemples de situations extrêmes et exceptionnelles", a noté Morgenthau.
Le succès et le pouvoir provoquent l' "ὕβρις", amènent les dirigeants des États, et donc les États eux-mêmes, à surestimer leur capacité à contrôler les événements, ce qui, comme dans les tragédies grecques, conduit au désastre. Les Grecs considéraient l' "ὕβρις" comme la propriété principale du début de l'ère titanique, qui se manifeste dans l'homme, conduisant à la peripeteia - la disparition de la fortune, suivie de la nemesis - le châtiment divin.
Ce n'est pas seulement l'équilibre des forces, mais aussi l'ordre, la loi, le "nomos" qui assurent la stabilité des relations entre les États. Le Nomos exige la mesure. Le manque de mesure et l'arrogance conduisent à l'anomie, qui ne peut être surmontée que par la création d'un nouvel ordre. La tragédie grecque devient un paradigme pour comprendre les relations internationales.
Dans notre histoire, l'"arrogance" de l'unique superpuissance, la violation des normes écrites et non écrites du droit international (nomos) l'ont de facto aboli, le manque de retenue dans la revendication du contrôle de territoires de plus en plus nombreux et l'imposition de ses propres attitudes civilisatrices a conduit à un retour de bâton de la part de la Russie et peut-être à l'avenir de la Chine. Le conflit ukrainien est une conséquence du déclin du pouvoir débridé des États-Unis, causé par le pouvoir lui-même. Mais la dimension tragique ouvre la perspective d'une purification si le nouveau pouvoir est fondé sur la loi sacrée, apportant avec elle l'ordre et la justice. Comme dans l'Antigone de Sophocle, le nouvel ordre naît dans la tragédie, lorsque la tentative de faire respecter la supposée "légalité" relève du titanique et du tyrannique, de l'ὕβρις .
Cependant, on peut continuer à raisonner dans ce sens. Le début d'une période titanique de l'histoire se caractérise non seulement par l'excès, mais aussi par la déficience, par le fait de ne pas aller jusqu'au bout, par l'abandon des limites finales. L'important n'est pas d'être des titans en pensée et en action. L'incertitude des limites, le flou de l'image est une caractéristique de ces pouvoirs. L'ordre exige la clarté, la compréhension, la clarté de l'objectif et la clarté de la vision, littéralement la "théorie".
katehon.com
12:23 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie politique, hybris, démesure, états-unis, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 février 2023
Carl Schmitt sur Hegel et Marx
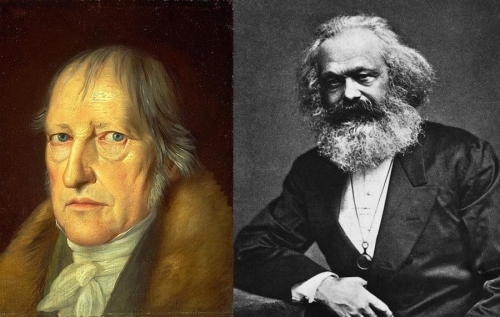
Carl Schmitt sur Hegel et Marx
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/01/15/lastips-carl-schmitt-om-hegel-och-marx/
Carl Schmitt a été une connaissance fréquente et précieuse pour notre site Motpol, en partie en tant parce qu'il est un analyste sobre de la politique. Ses arguments sur la distinction ami-ennemi, le souverain, le nomos, le partisan et l'état d'exception ont influencé les penseurs de droite comme de gauche. Le révolutionnaire conservateur Schmitt était également un critique, toutefois sous-estimé, de la civilisation, identifiant des aspects de la crise de l'Occident dans des œuvres telles que Hamlet ou Hécube. Il est intéressant de noter qu'il a cité Bruno Bauer, Nietzsche, Cortés et Baudelaire comme des voix importantes de la crise du 19ème siècle.
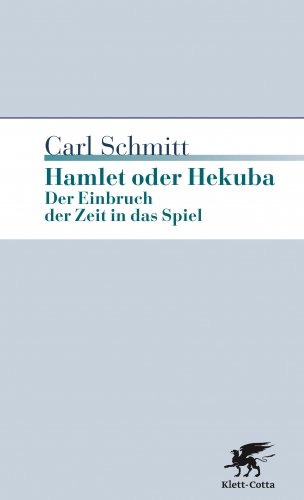
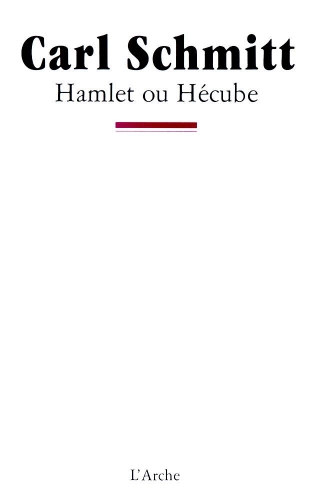
Une ressource féconde pour le schmittien se trouve dans le compte youtube Der Schattige Wald (https://www.youtube.com/@derschattigewald3912/videos), lié à ce trésor de traductions d'Ernst et Friedrich Georg Jünger connu sous le nom de Jünger Translation Project (https://jungertranslationproject.wordpress.com/). Sur Der Schattige Wald, nous trouvons, entre autres, une traduction du texte de Schmitt de 1931 sur Hegel et Marx. Le point de départ de Schmitt est ce qui unit Hegel et Marx, la méthode dialectique; il note également qu'il faut appliquer la méthode de ces deux penseurs à soi-même.
Cette approche s'avère fructueuse. Schmitt note que lorsque le jeune Marx s'est opposé à la défense du statu quo par son aîné Hegel, c'est avec la méthode de ce dernier qu'il l'a fait. Marx savait que "la philosophie et la méthode dialectique de Hegel ne permettaient aucun sur-place ni aucun repos, et, à cet égard, elle était et restait le morceau de philosophie le plus révolutionnaire que l'humanité ait alors produit". Il est intéressant de noter que Schmitt identifie une logique qui mène de cela à l'intérêt de Marx pour l'économie politique. L'État, que Hegel considérait comme "le domaine de l'esprit objectif et présent", se trouvait pour Marx dans une phase de transition ("en partie une relique d'époques historiquement obsolètes, et en partie un instrument d'une société bourgeoise essentiellement économique et industrielle"). Le jeune hégélien a donc dû essayer de comprendre ce dernier phénomène, ce qui a finalement conduit à Das Kapital.
En même temps, Schmitt avait accès à des matériaux et des textes qui manquaient à Marx en ce qui concerne le jeune Hegel. Ceux-ci préfigurent en partie le radicalisme de Marx. "Aujourd'hui, nous sommes familiers avec le Hegel qui était un ami de Hölderlin" écrit Schmitt. Cela devient vraiment intéressant lorsque Schmitt note que "c'est le jeune Hegel qui a défini le premier le concept de bourgeois comme celui d'un homme essentiellement apolitique et ayant besoin de sécurité. La définition se trouve dans un article de 1802 sur la constitution allemande qui n'a pas été publié avant la fin du siècle". Nous trouvons des définitions similaires du bourgeois chez d'autres penseurs allemands, de Jünger à Schmitt lui-même. L'attitude anti-bourgeoise semble être un phénomène germanique qui ne mène qu'exceptionnellement aux conclusions tirées par Marx. L'attitude anti-bourgeoise germanique conduit normalement à d'autres idéaux sociaux et humains.
Le raisonnement de Schmitt sur les conditions préalables du socialisme moderne, tant en termes de critique sociale que de méthode dialectique, est également intéressant ("le socialisme n'est pas simplement un type possible de critique des maux communs à toutes les époques"). Les Gracques n'étaient pas socialistes, pas plus que l'anabaptiste du 16ème siècle Müntzer. La relation du socialisme à la raison dialectique présente à la fois des forces et des faiblesses. Schmitt présente un aspect du projet comme relativement sympathique, le désir de "construire l'histoire de l'humanité elle-même, de saisir l'époque actuelle et le moment présent, et de faire ainsi de l'humanité le maître de son propre destin" (comparez le discours de Marx qui parle de mettre fin à la préhistoire de l'humanité et de commencer son histoire consciente). Dans le même temps, le rapport à la dialectique implique une conviction de réussite qui n'est pas nécessairement ancrée dans la réalité mais qui constitue néanmoins une puissante force motrice. Schmitt décrit ici la conviction que si l'on peut expliquer un phénomène, un ordre ou une classe, sa fin est garantie. Pour le profane, cela peut sembler difficile à saisir, mais c'est un point de départ de la pensée de Marx. Schmitt écrit ici que "tant que la situation historique de cette classe ennemie n'est pas encore mûre, tant que la bourgeoisie n'est pas seulement du passé, mais a encore un avenir, il reste impossible de découvrir sa formule finale dans le cadre de l'histoire mondiale". Il y a une certaine logique à cela, tout comme la chouette de Minerve vole dans le crépuscule, il est difficile de comprendre une classe qui n'a pas encore épuisé ses possibilités.
Dans l'ensemble, il s'agit d'un texte passionnant qui démontre à la fois la justesse de Schmitt en tant qu'analyste de l'idéologie et offre des perspectives partiellement nouvelles sur Hegel et Marx. De plus, si la dialectique est aussi le mode de pensée germanique, ce qui est le cas, le texte devient particulièrement enrichissant.
A propos de l'auteur : Joakim Andersen
Joakim Andersen dirige le blog Oskorei depuis 2005. Il a une formation universitaire en sciences sociales et une formation idéologique en tant que marxiste. Ce bagage s'exprime aujourd'hui par un intérêt pour l'histoire des idées et une focalisation sur les structures plutôt que sur les personnes et les groupes (l'adversaire est, en somme, le Nouvel Ordre Mondial, pas les musulmans, les juifs ou d'autres groupes). Au fil des ans, l'influence de Marx a été complétée, entre autres, par Julius Evola, Alain de Benoist et Georges Dumezil, car le marxisme manque à la fois d'une théorie durable du politique et d'une anthropologie. Aujourd'hui, Joakim ne s'identifie pas totalement à une quelconque étiquette, mais considère que la fixation sur, entre autres, le conflit imaginaire entre "droite" et "gauche" est quelque chose qui obscurcit les véritables problèmes de notre époque. Son blog continue également à se concentrer sur l'histoire des idées, et il est heureux de présenter des courants étrangers à un public suédois.
Qu'est-ce que Motpol ?
Motpol est un groupe de réflexion identitaire et conservateur qui poursuit deux objectifs principaux : 1) mettre en lumière un spectre de la culture qui est essentiellement laissé de côté dans un espace public suédois de plus en plus encombré et monotone, et 2) servir de forum pour la présentation et le débat sur l'idéologie, sur la théorie et la pratique politiques. Les écrivains de Motpol viennent d'horizons divers et écrivent à partir de perspectives différentes.
Nous contacter:
Motpol
Boîte 7129
402 33 Göteborg
Courriel : info@motpol.nu
Editeur responsable : Daniel Friberg
Soutenir Motpol
Si vous appréciez le think tank Motpol et les activités que nous menons sous la forme de conférences, de séminaires et surtout de ce site web, et que vous souhaitez nous aider à nous développer, vous pouvez montrer votre soutien en apportant une contribution financière.
Les dons sont déposés à notre adresse Bitcoin : 02e98b712363542b5dd918c0590256332dd22bb12b735dee207ee3d5991b717b2d
21:44 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, karl marx, hegel, philosophie, philosophie politique, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 février 2023
Quand un État est-il vraiment souverain?

Quand un État est-il vraiment souverain?
par Daniele Dell'Orco
Source : Daniele Dell'Orco & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/quand-e-che-uno-stato-e-davvero-sovrano
Le récent débat sur l'envoi de chars Leopard à l'armée ukrainienne a une fois de plus mis en évidence l'extraordinaire faiblesse de la (l'ancienne ?) locomotive de l'Europe : l'Allemagne.
Ce pays qui était considéré il y a encore quelques mois comme une puissance hégémonique sur le Vieux Continent s'est retrouvé littéralement mis à nu en l'espace de quelques mois et ce, dans plusieurs domaines: le domaine politique (l'instabilité persistante de l'ère post-Merkel), le domaine économique (la dépendance énergétique, la crise industrielle due aux sanctions) et le domaine militaire (l'armée réduite au niveau zéro).
Prise en tenaille, l'Allemagne a été contrainte de prendre des décisions contraires à son intérêt national en démantelant des années de planification politique en un temps très court.
C'est une bonne occasion d'utiliser l'exemple allemand comme étude de cas pour comprendre en quoi consiste réellement la "souveraineté" d'un pays.
Les macro-domaines qui donnent à une nation la possibilité d'être le maître de son propre destin (pour le meilleur ou pour le pire) sont au nombre de trois :
- la stabilité politique ;
- la puissance militaire ;
- la stabilité financière.
D'un point de vue politique, quelle que soit la forme de gouvernement que l'on puisse trouver dans les différents pays du monde, un leadership fort dans le cas des autocraties, une confiance massive dans le parti/leader dans les démocraties illibérales, ou un large consensus électoral dans les démocraties libérales (ou un système bipolaire derrière lequel se meut un État profond cohésif, rendant les élections non pertinentes sur de nombreuses questions) sont indispensables pour permettre à un gouvernement de prendre des décisions politiques, économiques (approvisionnement en énergie, État-providence, fiscalité, etc.) et militaires.
Cette dernière instance, l'instance militaire, est un outil indispensable pour affirmer sa souveraineté, a contrario des options prises pendant plusieurs décennies successives, où, dans de nombreux pays européens (en premier lieu ceux qui sont sortis perdants de la guerre mondiale comme l'Italie ou, précisément, l'Allemagne) régnait l'axiome selon lequel il serait plus sage d'externaliser la défense et de réduire les dépenses militaires au minimum parce que "vous pouvez construire des jardins d'enfants avec cet argent". Et c'est ce que nous constatons avec la guerre actuelle: ceux qui disposent d'une armée puissante (Turquie, Israël, Chine, France, en plus des grands acteurs directement impliqués dans le conflit) prennent les décisions, les autres rentrent dans le rang, tête basse.
Une armée "puissante" se mesure évidemment en termes de nombre, mais aussi en termes de préparation, de polyvalence (par exemple, avoir une force aérienne forte et une marine faible ne rend une armée puissante que dans certains scénarios) et surtout de suprématie industrielle et technologique.
Ce point est fondamental: si l'on achète ses propres armements, ou si on les fabrique dans le cadre de ce que l'on appelle officiellement un "partenariat" mais qui est pratiquement un contrat de sous-traitance, on n'est pas souverain, car on n'aurait pas la possibilité de disposer librement de ses propres armes en cas de besoin. Le programme F-35 en est un bon exemple.
Il est développé par Lockheed Martin, BAE et Leonardo, avec de bons emplois (proportionnellement) pour tous.
Mais les technologies, le soutien, le contrôle de leur utilisation sont la prérogative d'une seule puissance (à de très rares exceptions près).
Le potentiel industriel va de pair. Si l'on dispose de ses propres technologies, qu'elles soient obsolètes ou extraordinairement avancées, il faut aussi avoir la capacité pratique de les traduire en armements (donc aussi en potentiel industriel, en matières premières, en personnel, etc.) ou de les contracter à l'étranger avec de "vraies" formes de partenariat.
La stabilité financière est en quelque sorte le ciment de tout cela, car dans le monde globalisé, elle est à toutes fins utiles une arme.
Une dette publique trop importante dans des mains étrangères rend vulnérable.
Un déficit trop important lie les mains des gouvernements et ne permet pas la réalisation du PIB.
Un PIB trop faible crée du mécontentement et de l'instabilité.
Une trop grande instabilité fait des économies la proie d'attaques financières et fait tomber les gouvernements.
Etc.

Aucune de ces sphères n'a la priorité sur l'autre, mais toutes sont autonomes et leur équilibre substantiel aboutit à la plus haute expression possible de la souveraineté.
Cependant, même en cas de déséquilibre, le fait de mettre l'accent sur deux d'entre eux, capable de minimiser les impacts de l'autre (l'exemple de la Turquie, en crise économique perpétuelle, est emblématique) pourrait être acceptable pour autant que l'on travaille sans cesse à les rééquilibrer.
Un déséquilibre dans deux, voire trois, de ces sphères ne peut en aucun cas rendre un pays réellement souverain, mais seulement en véhiculer le sentiment. C'est ce qui est arrivé à l'Allemagne: en temps de paix, elle semblait indestructible, avec le changement de décor, elle se découvre défaillante.
En utilisant ce simple miroir, il est possible de dresser une sorte de "bulletin" pour chaque étude de cas.
De mon point de vue, ces concepts montrent qu'en Europe (y compris au Royaume-Uni), aucun pays ne peut prétendre être véritablement souverain, à l'exception de la France. Laquelle a toutefois connu un déclin progressif au cours des dernières décennies, tant dans le domaine politique (elle est de plus en plus instable malgré une loi électorale qui la met autant que possible à l'abri des renversements antisystème) que dans le domaine financier.
En bref, son équilibre est précaire.
Mais au moins, elle est là.
D'où la raison pour laquelle, à ce jour, les destins de l'Europe ne se décident pas en Europe.
22:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, souveraineté, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 janvier 2023
Si la "droite" a raison - à l'avenir, la pensée globaliste devra se combiner avec l'affirmation de soi localiste

Neue Züricher Zeitung (NZZ)
Commentaire d'un lecteur
Si la "droite" a raison - à l'avenir, la pensée globaliste devra se combiner avec l'affirmation de soi localiste
L'Occident a longtemps réussi à exercer une domination politique, idéologique et technologique sur le monde. Aujourd'hui, il est confronté à de puissants rivaux extérieurs et au relativisme culturel qui sévit en son sein. Le réalisme et l'autolimitation sont de mise.
Heinz Theisen
Après l'échec de l'utopie visant l'égalité matérielle, les aspirations de la gauche se sont déplacées vers l'égalité culturelle et biologique. Sous le signe de l'arc-en-ciel, la diversité et l'égalité sont censées se compléter au sein de "l'humanité unique" - comme autrefois la liberté et l'égalité au sein des sociétés nationales.
La puissance de cette nouvelle idéologie provient de sa coalition avec le capitalisme mondial. L'appel à l'ouverture des frontières unit les acteurs économiques mondiaux et les moralistes à la pensée globaliste. La libre immigration est pour les uns ce que l'externalisation est pour les autres.
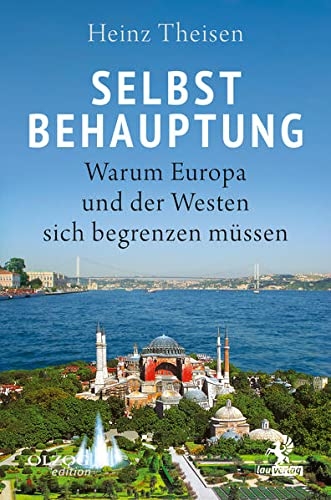
Déconstruction du propre
Tous deux sacrifient pour cela l'affirmation de soi des communautés circonscrites, de la famille, de l'État-nation et de la culture. D'où la déconstruction, qui les caractérise, de toute identité originale, et leur haine de la culture occidentale, qui est la plus réussie et donc la plus inégalitaire. L'ordre du "monde unique" est attribué dans le grand reset à un centralisme numérisé d'instances mondiales.
La critique du manque de rationalité des intérêts ne s'adresse pas à un zèle religieux de substitution qui satisferait des aspirations profondes au bien. Non, ce manque de rationalité est critiquable parce qu'il s'agit d'un christianisme frelaté tant que son idéal d'universalité n'est pas associé au réalisme de la subsidiarité. L'amour du lointain risque de prendre le pas sur l'amour du prochain.
Lorsque les sociaux-démocrates danois veulent garantir l'État social en durcissant le droit d'asile, est-ce de gauche ou de droite ?
Le relativisme culturel de l'Occident était la condition préalable à son universalisme politique, jusqu'à justifier l'intervention dans des milieux culturels étrangers. Au sein de la société, les luttes culturelles étaient également programmées. Les valeurs et les structures occidentales étaient considérées comme transférables à satiété à d'autres cultures et, inversement, aux immigrés issus de cultures étrangères.
La coalition tricolore en Allemagne n'est pas le fruit du hasard. Un libéralisme galvaudé occupe une place centrale dans cette coalition arc-en-ciel. Il exige, jusque dans les rôles sexuels, la dissolution de toutes les formes d'identité communautaire au profit des identités individuelles. L'absence de limites est revendiquée même par rapport face aux contraintes naturelles.
Le moralisme de l'ouverture universelle revendique à son tour l'absoluité. Les positions opposées à ce Bien, posé comme tel, sont considérées comme mauvaises et ne méritent que d'être combattues. Toute forme d'affirmation de soi est considérée comme "de droite", la polarisation des sociétés suit son cours.
Les attaques venant du lointain sur tout ce qui est prochain et du futur sur le présent expliquent aisément les contre-mouvements furieux, observables de Trump au Brexit en passant par Le Pen et l'AfD. Mais ceux-ci ne constituent que des contre-pensées tant qu'ils ne proposent pas leur propre récit réaliste. Sans une compréhension plus profonde de la culture propre d'un terreau local/national, la volonté de le protéger ne peut être justifiée que par des peurs et des ressentiments. Et sans une reconstruction des éléments les meilleurs et les plus unificateurs de notre culture - comme en particulier l'histoire chrétienne bimillénaire de l'Europe - un sentiment de colère génère un rejet massif et renforce la polarisation.
Le mondialisme utopique délocalisé/délocalisant menace de générer des contre-extrémismes nationalistes et régressifs. L'État-nation n'est pas une fin en soi, comme le pensent certains romantiques identitaires. Il peut lui-même devenir l'agent d'un centralisme bureaucratique et détruire les petites communautés. Mais il n'y a aucune raison de le diaboliser tant qu'il agit de manière défensive et qu'il reste principalement axé sur l'affirmation de ses propres valeurs.
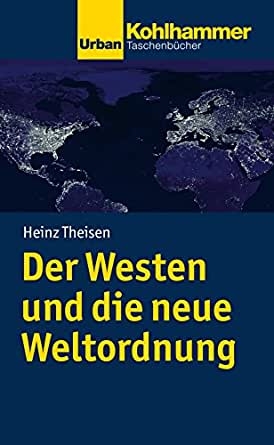
Démondialisation et nouvelle multipolarité
Dans un monde multipolaire composé de grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine et la Russie, les nations européennes sont trop petites pour pouvoir assurer seules leur sécurité et leur prospérité. La voie médiane et praticable entre le mondialisme et le nationalisme résiderait dans un aménagement de l'espace entre les acteurs, dont la structure et la taille résulteraient de leur capacité à résoudre les problèmes.
En Europe, cela pourrait se faire dans le cadre d'une Union qui connaitrait ses limites à l'extérieur et à l'intérieur. Plus de diversité à l'intérieur permettrait plus d'unité et de force à l'extérieur, face aux adversaires que sont la Russie, la Chine et ceux du monde islamique. Il ne s'agit pas de sortir de cette Union, mais de la transformer en une "Europe qui protège" (Macron) - jusqu'à un marché unique européen qui sache exiger la réciprocité dans les échanges avec la Chine.
La guerre d'agression de Poutine a mis fin à tous les rêves mondialistes et multilatéraux. La déconnexion de la Chine, opérée dans le cadre de la pandémie, qui a placé le pays hors des contextes internationaux, et les sanctions décrétées contre la Russie ont renforcé les tendances à la déglobalisation qui étaient déjà en germe dans la pandémie. La rivalité, qui s'est déchaînée dans l'économie mondiale, exige une plus grande protection de la classe moyenne contre les tendances oligopolistiques. Les pertes de prospérité sont inévitables, mais une meilleure délimitation de ce ressac permettrait de garder et de consolider l'ordre.
D'autant plus que les valeurs woke de l'Occident, qui glissent de plus en plus vers un extrémisme débridé, suscitent plutôt le dégoût dans les cultures traditionnelles ailleurs dans le monde. Alors que les démocraties libérales font preuve d'une très grande tolérance à l'égard de l'islam, l'islamisme, de son côté, se montre intransigeant. Dans leur propre culture, les conservateurs culturels affirment que leur culture doit demeurer dominante, et dans l'espace de la culture étrangère, ils respectent sa primauté. De cette manière, même des cultures incompatibles pourraient coexister pacifiquement.

La droite et la gauche se confondent
La préoccupation centrale de la "droite", des traditionalistes aux nationalistes, est l'auto-affirmation de ce qui lui est propre. Ce récit permettrait également au conservatisme de sortir de son dilemme consistant à toujours s'opposer aux nouveautés des autres.
La "lutte contre la droite" déclarée par beaucoup semble être menée avec d'autant plus d'acharnement qu'elle passe à côté du sujet. Lorsque les sociaux-démocrates danois veulent garantir l'État social en durcissant le droit d'asile, est-ce là une position de gauche ou de droite? Un libéral qui défend l'égalité des sexes contre la charia est-il libéral ou conservateur? De même, une protection accrue du commerce de détail par une taxation minimale d'Amazon à l'échelle européenne serait à la fois de gauche, libérale et de droite.
Face à tout ce qui doit être affirmé et préservé en termes de progrès social et d'émancipation, l'affirmation de soi est également une préoccupation incontournable pour la gauche et les libéraux. Le conservatisme ne signifie donc pas l'exaltation du passé, mais la reconnaissance des nécessités pour faire face à la réalité. On peut aussi appeler cela du "protectionnisme".
Avec la guerre d'agression menée par la Russie, le nationalisme connaît une renaissance, si ce n'est au profit de sa propre nation, il le connaît via le soutien à l'Ukraine. Les pacifistes verts sont devenus du jour au lendemain les plus fervents partisans de la livraison d'armes. Si les anciens objecteurs de conscience du gouvernement allemand, comme le chancelier et le vice-chancelier, défendent l'autodétermination nationale des Ukrainiens, ils peuvent difficilement la refuser à leur propre pays. Les mondialistes seront confrontés à un Canossa similaire lorsque les flux migratoires toucheront les quartiers aisés et commenceront à submerger les éthiciens de la pensée qui y vivent.
Mais en fin de compte, les contradictions entre les mondialistes et les protectionnistes devront être transformées en réciprocité, comme dans le cas du conflit entre le capital et le travail dans l'économie sociale de marché. Les sociétés vieillissantes ont besoin à la fois d'immigration et d'État social. Une migration maîtrisée nécessite des formes contrôlées d'ouverture et des formes différenciées de protection.
Les avantages comparatifs en termes de coûts du libre-échange sont indispensables au développement de la prospérité. Des compromis peuvent être trouvés sur les limites de la concurrence mondiale en faveur des qualités locales. Leur recherche commence dès lors que des discours ouverts sont tenus sur les limites de l'ouverture.
Heinz Theisen est professeur émérite de sciences politiques à l'Université catholique de Rhénanie du Nord-Westphalie à Cologne.
18:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heinz theisen, allemagne actualité, globalisation, mondialisation, nationalisme, droite, gauche, actualité, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 janvier 2023
Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international

Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international
Age planétaire et nouvel ordre mondial
par Irnerio Seminatore
INSTITUT ROYAL D'ETUDES STRATEGIQUES de RABAT
8 Décembre 2022
TABLE DES MATIERES
Une vue d'ensemble
Alliance Anti-Hegemonique et nouveau Rimland
Crise de l'atlantisme et transition du système
Les issues du conflit ukrainien
L'hégémonie et le remodelage du système
Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
***
Une vue d'ensemble
L'ambition de ces deux publications sur la multipolarité, le tome 1 au titre La Multipolarité au XXIème siècle et le tome 2: L'Europe, la Multipolarité et le Système international. Age planétaire et nouvel ordre mondial, a été d'avoir essayé de dresser une vue d'ensemble sur la politique mondiale à l'époque où nous vivons.
Et cela, sous l'angle d'une pluralité de structures de souverainetés et donc d'équilibre des forces, mais également et surtout de l'antagonisme historique entre puissances hégémoniques et puissances montantes et donc d'un certain ordre politique et moral. On y repère ainsi les deux aspects principaux de tout narratif historique, l'acteur et le système, qui se projettent sur la toile de fond de l'action historique.

L'acteur, ou la figure de l'Hégémon, y apparaît comme le signifiant universel d'une époque et le système, comme englobant général de tous les antagonismes et de toutes les rivalités, en est le décor.
Ces deux ouvrages couvrent la transition qui va de la fin du système bipolaire à l'unipolarisme américain qui lui a succédé, puis au multipolarisme actuel, en voie de reconfiguration.
Parmi les changements des structures de pouvoir et des ordres internationaux, trois thèmes constituent le fil conducteur de l'antagonisme qui secoue le système, des débats qui animent ses rivalités et ses conflits et, comme tels, l'axe directeur de mes deux ouvrages
- la triade des puissances établies, qui se disputent l'hégémonie de la scène planétaire (Etats-Unis, Russie et Chine), scène devenue durablement instable;
- l'environnement stratégique mondial, comme cadre historique, cumulant les trois dimensions de l’action, d’influence, de subversion ou de contrainte;
- l'Europe, comme acteur géopolitique inachevé et à autonomie incomplète.
Dans ce contexte, l’interprétation des stratégies de politique étrangère prises en considération, obéit aux critères, jadis dominants de la Realpolitik, remis à l’ordre du jour par le World Politics anglo-saxon.
L'option réaliste en politique internationale est adoptée non pas pour garantir l'idéal de la puissance ou de l'Etat-puissance, comme au XIXème siècle, ou encore pour justifier la matrice classique de la discipline, l'anarchie internationale, à la manière de R. Niebuhr, mais pour comprendre les mutations des idées et des rapports de forces, intervenues dans la politique mondiale depuis 1945.
C'est uniquement par l'approche systémique et par conséquent par une vue générale et exhaustive, que l'on peut saisir les conditions idéologiques et structurelles de la remise en cause de la souveraineté des Etats et des Nations et l'apparition d'un univers d'unités politiques interdépendantes et toutefois subalternes à une hégémonie impériale dominante.
Ainsi l'ensemble des essais ici réunis, prétend conférer à ces deux tomes un statut d'éclairage conceptuel pour la compréhension de l'évolution globale de notre conjoncture et pour l'analyse du "Grand Jeu" entre pôles de puissances établies, défiant la stabilité antérieure.
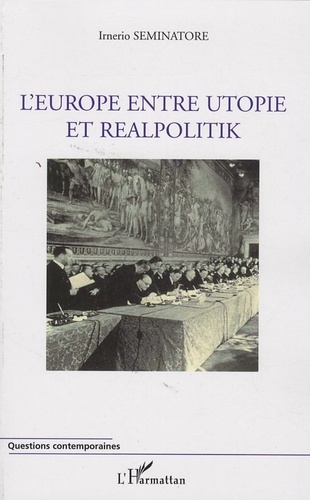
Alliance Anti-Hégémonique et nouveau Rimland
Sont mises en exergue, dès lors :
- l'alliance anti-hégémonique du pivot géographique de l'histoire, le Heartland, par la Russie, l'Iran et la Chine et, en position d'arbitrage la Turquie,
- la chaîne politico-diplomatique du "containement" de la masse eurasienne, par la ceinture péninsulaire extérieure du "Rimland"mondial, constituée par la Grande Ile de l'Amérique, le Japon, l'Australie, l'Inde, les pays du Golfe et l'Europe, ou, pour simplifier, l'alliance nouvelle des puissances de la terre contre les puissances de la mer.
Dans cet antagonisme entre acteurs étatiques, l'enjeu est historique, le pari existentiel et l'affrontement est planétaire.
En soulignant le déplacement de l'axe de gravité du monde vers
l'Asie-Pacifique, provoqué par l'émergence surprenante de l'Empire du Milieu, ce livre s'interroge sur le rôle de l'Amérique et de la Russie, ennemies ou partenaires stratégiques de l'Europe de l'Ouest, justifiant par là le deuil définitif de "l'ère atlantiste" qui s'était imposée depuis 1945.
Crise de l'atlantisme et transition du système
La crise de l'atlantisme, ou du principe de vassalité est aujourd'hui aggravée par deux phénomènes:
- la démission stratégique du continent européen, en voie de régression vers un sous-système dépendant;
- les tentatives de resserrement des alliances militaires permanentes en Europe et en Asie-Pacifique (Otan, Aukus) prélude d'un conflit de grandes dimensions.
Ouvrages didactiques, ces deux tomes prétendent se situer dans la postérité des auteurs classiques du système international, R. Aron, Kaplan, Rosenau, H. Kissinger, K. Waltz, Allison, Brzezinski, Strausz-Hupé, et plus loin, Machiavel et Hobbes, tout aussi bien dans la lecture des changements des équilibres globaux et dans la transition d'un système international à l'autre, que dans la lecture philosophique sur la nature de l'homme, la morphologie du pouvoir et les caractéristiques intellectuelles de la période post-moderne. Ce qui est en cause dans toute transition est le concept de hiérarchie.
Sous ce regard de changement et de mouvement, le retour de la guerre en Europe représente le premier moment d'un remodelage géopolitique de l'ensemble planétaire et une rupture des relations globales entre deux sous-systèmes, euro-atlantique et euro-asiatique.
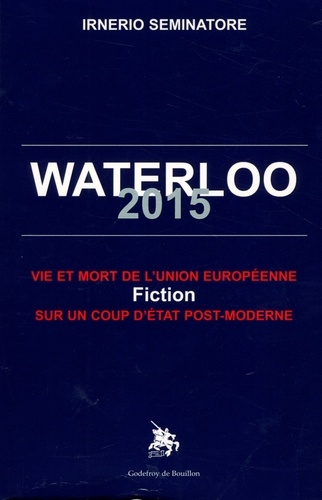
Au sein de ce retournement, l'Europe y perd son rôle d'équilibre entre l'Amérique et la Russie et le grand vide de puissance, qui s'instaure dans la partie occidentale du continent, est aggravé par l'absence de perspective stratégique, par le particularisme des options diplomatiques des Etats-Membres de l'Union Européenne, par le flottement des relations franco-allemandes jadis structurantes et, in fine, par la difficile recherche d'un Leadership commun.
Les issues du conflit ukrainien
L'issue du conflit ukrainien, comme guerre par procuration mené par l'Amérique contre la Russie, a été présenté au Forum sur la sécurité internationale de Halifax, au Canada, par Lloyd Austin, Secrétaire américain à la défense, comme déterminant de la sécurité et de l'ordre mondial du XXIème siècle fondé, sur des règles. Ce conflit prouve la difficulté de l'Union européenne à assurer une architecture européenne de sécurité "égale et indivisible" car il intervient comme modèle de rupture dans les relations de coopération internationales et préfigure en Asie-Pacifique une relation d'interdépendance stratégique et d'alliances militaires opposées, entre puissances du "Rimland" et puissances du "Heartland", face à l'ouverture prévisible, d'une crise, concernant le "statut" de Taiwan.

Dans la perspective d'une invasion de celle-ci par la Chine s'ouvriraient les portes de la géopolitique planétaire vers le Pacifique et l'Australie et changerait immédiatement le sens du conflit entre Moscou et l'Occident. Seraient particulièrement brouillés les calculs de Washington sur le rôle de la Russie en Europe, en Asie-centrale et en Asie-Pacifique, d'où le jeu ambigu de la Turquie et la recherche d'une profondeur stratégique pour l'emporter, qui demeure sans précédent.
Aujourd'hui, l'affrontement Orient et Occident est tout autant géopolitique et stratégique, qu'idéologique et systémique et concerne tous les domaines, bien qu'il soit interprété, dans la plupart des cas, sous le profil de la relation entre économie et politique.
Sous cet angle, en particulier, l'unipolarisme de l'Occident fait jouer à la finance, disjointe de l'économie, un rôle autonome pour contrôler, à travers les institutions multilatérales, le FMI et la Banque Mondiale, l'industrie, la production d'énergie, l'alimentation, les ressources minières et les infrastructures vitales de plusieurs pays.
Dans ce cadre les Etats qui soutiennent la multipolarité sont aussi des Etats à gouvernement autocratique, qui résistent au modèle culturel de l'Occident et affirment le respect de vies autonomes de développement, une opposition visant la financiarisation et la privatisation des économies , subordonnant la finance à la production de biens publics.

L'hégémonie et le remodelage du système
Or le remodelage du système international pose le problème de l'hégémonie comme nœud capital de notre époque et inscrit ce problème comme la principale question du pouvoir dans le monde. En effet nous allons vers une extension sans limites des conflits régionaux, une politique de resserrement des alliances militaires, occidentales, euro-asiatiques et orientales, qui donnent plausibilité à l'hypothèse d'une réorganisation planétaire de l'ordre global, par le biais d'un conflit mondial de haute intensité.
La plausibilité d'un conflit majeur entre pôles insulaires et pôles continentaux crée une incertitude complémentaire sur les scénarios de belligérance multipolaire dans un contexte de bipolarisme sous-jacent (Chine-Etats-Unis)
C'est l'une des préoccupations, d'ordre historique, évoquées dans ces deux tomes sur la multipolarité.
A ce propos, le théâtre européen élargi (en y incluant les crises en chaîne qui vont des zones contestées des pays baltes au Bélarus et à l'Ukraine, jusqu'au Golfe et à l'Iran, en passant par la Syrie et le conflit israélo-palestinien), peut devenir soudainement l'activateur d'un conflit général, à l'épicentre initial dans l'Est du continent.
Ce scénario, qui apparaît comme une crise du politique dans la dimension de l'ordre inter-étatique, peut être appelé transition hégémonique dans l'ordre de l'histoire en devenir.
Bon nombre d'analystes expriment la conviction que le système international actuel vit une alternance et peut être même une alternative hégémonique et ils identifient les facteurs de ce changement, porteurs de guerres, dans une série de besoins insatisfaits , principalement dans l'exigence de sécurité et dans la transgression déclamatoire du tabou nucléaire, sur le terrain tactique et dans les zones d'influence disputées (en Ukraine, dans les pays baltes, en Biélorussie, ainsi que dans d'autres points de crises parsemées).
L'énumération de ces besoins va de l'instabilité politique interne, sujette à l'intervention de puissances extérieures, à l'usure des systèmes démocratiques, gangrenés en Eurasie par l'inefficacité et par la corruption et en Afrique, par le sous-développement, l'absence d'infrastructures modernes, la santé publique et une démographie sans contrôle.
En effet, sans la capacité d'imposer la stabilité ou la défendre, Hégémon ne peut exercer la suprématie du pouvoir international par la seule diplomatie, l'économie, le multilatéralisme, ou l'appel aux valeurs.
Il lui faut préserver un aspect essentiel du pouvoir international (supériorité militaire, organisation efficace, avancées technologiques, innovation permanente, etc).
Hégémon doit tenir compte de l'échiquier mondial, de la Balance of Power, de la cohésion et homogénéité des alliances, mais aussi de l'intensité et de la durée de l'effort de guerre. C'est pourquoi les guerres majeures relèvent essentiellement de décisions systémiques (R. Gilpin).

Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
La question qui émerge du débat actuel sur le rôle des Etats-Unis dans la conjoncture actuelle est de savoir si la "Stabilité stratégique" assurée pendant 60 par l'Amérique (R. Gilpin) est en train de disparaître, entrainant le déclin d'Hégémon et de la civilisation occidentale, ou bien, si nous sommes confrontés à une alternative hégémonique et à un monde post-impérial.
L'interrogation qui s'accompagne au déclin supposé des Etats-Unis et à la transition vers un monde multipolaire articulée, est également centrale et peut être formulée ainsi; "quelle forme prendra cette transition ?".
La forme déjà connue, d'une série de conflits en chaîne, selon le modèle de R. Aron, calqué sur le XXème siècle, ou la forme plus profonde d'un changement de la civilisation, de l'idée de société et de la figure de l'homme selon le modèle des "révolutions systémiques" de Strausz-Hupé, couvrant l'univers des relations socio-politiques du monde occidental et les grandes aires de civilisations connues?
Du point de vue des interrogations connexes, les tensions entretenues entre les Occidentaux et la Russie en Ukraine, sont susceptibles de provoquer une escalade aux incertitudes multiples, y compris nucléaires et des clivages d'instabilités, de crises ouvertes et de conflits gelés, allant des Pays baltes à la mer Noire et du Caucase à la Turquie. Ces tensions remettent à l'ordre du jour l'hypothèse d'un affrontement général, comme issue difficilement évitable de formes permanentes d'instabilité régionales, aux foyers multiples, internes et internationaux.
Cette hypothèse alimente une culture de défense hégémonique des Etats-Unis, dont la projection de puissance manifeste sa dangerosité et sa provocation en Europe, au Moyen Orient et en Asie.

Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
En ce sens le conflit avec la Russie, par Ukraine interposée, peut être interprété comme une tentative de désarticulation de la continuité géopolitique de l'Europe vers l'Asie (Brzezinski) et de la Chine vers la région de l'Indopacifique. C'est sous l'angle de fracturation et de la vassalité, que s'aggravent les facteurs d'incertitudes et les motifs de préoccupation sur les tendances stratégiques des Etats-Unis.
En effet la différenciation vis à vis du Leader de bloc distingue en Europe les pays d'obédience et d'influence atlantique stricte (GB, pays nordiques, Hollande, Belgique, Pays baltes et Pologne) des pays du doute et de la résistance (France, Italie et Allemagne).
Au niveau planétaire font partie des zones à hégémonie disputée et demeurent sujettes à l'influence grandissante de la Realpolitik chinoise la région des Balkans, de la mer Noire, de la Caspienne, du plateau turc, du Golfe, de l'Inde, d'Indonésie, du Japon et d'Australie.
Pariant, sans vraiment y croire sur la "victoire" de Kiev", face à Moscou, l'Amérique entend clairement faire saigner la Russie, en éloignant le plus possible la perspective d'un compromis et d'une sortie de crise.
Par ailleurs la vassalité de l'Europe centrale vis à vis de l'Amérique deviendra une nécessité politique et militaire, afin de décourager l'Allemagne, réarmée, de vouloir réunifier demain le continent. Une vassalité semblable pourrait opposer les pays asiatiques à la Chine dans la volonté de restituer de manière unilatérale, l'Asie aux Asiatiques.
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
Du point de vue des leçons à tirer et de ses répercussions, la crise ukrainienne a mis à l'ordre du jour la réflexion sur la morphologie des systèmes internationaux, stables, instables ou révolutionnaires, et, en particulier la politique des alliances, qui ont fait grands les empires et inéluctables les guerres.
Comme l'Empire allemand avant 1914, la Fédération de Russie a pu se sentir encerclée par l'Otan et a choisi, en pleine conscience du danger, de passer d'un mode défensif à un mode préventif et offensif, au nom de ses intérêts de sécurité et de la conception commune et incontestable de la "sécurité égale et indivisible" pour tous les membres de la communauté internationale. Une sécurité égale qui était justifiée, avant la première guerre mondiale, par une équivalence morale entre les ennemis, comme l'a bien montré Carl Schmitt, contre la diabolisation de l'Allemagne.
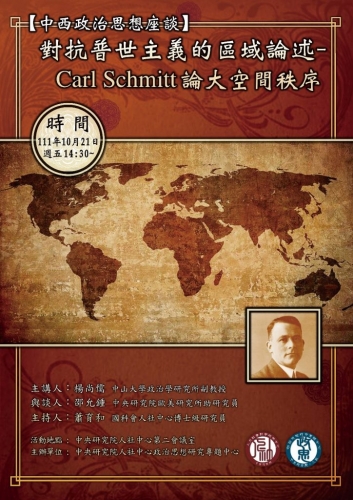
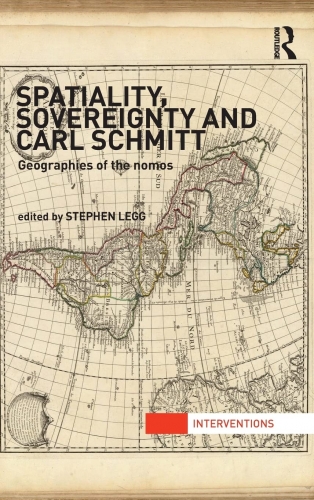
Telle est, à mes yeux, la vue d'ensemble de la conjoncture que nous vivons, si profonde et si grave, que j'ai essayé d'en décrire les formes et les enjeux et de la soumettre au jugement de nos contemporains, pour qu'en témoigne l'Histoire et pour qu'en tire profit la décision politique. Et cela dans le but de décrypter les dilemmes de la paix et de la guerre et de percevoir dans la détérioration des systèmes internationaux, un espoir de compatibilité civilisationnelle et stratégique entre acteurs principaux, portant sur la stabilité ou le retour à la stabilité
Pour rendre moins aléatoire cette recherche j'ai adoptée tour à tour cinq niveaux de compréhension :
- théorique (attributs systémiques, système et sous-systèmes, homogénéité- hétérogénéité, stabilité et sécurité);
- historique (la scène planétaire et sa morphologie ,les acteurs et les constellations diplomatiques);
- géopolitique (enjeux globaux, géopolitique continentale et géopolitique mondiale océanique);
- stratégique (la triade, le condominium USA-Chine ou le duel du siècle, hégémonie et compétition hégémonique);
- institutionnel (la crise de l’unipolarisme et de l’atlantisme, l’Europe et la multipolarité);
et j'en ai conclu à et opté pour un indéterminisme probabiliste, qui gouverne le sort de l'homme et des sociétés, dans le sens de la liberté ou de celui de la tyrannie, de la vie ou de la mort.
Ce travail, qui m'a demandé quarante ans, ne m'a consenti aucune certitude et aucune sentence définitive et m'a toujours rappelé que l'histoire reste ouverte au choix du bien ou du mal et à celui de la volonté la plus déterminée, soit-elle terrifiante.
Ce qui se prépare aujourd'hui et qui est conforme à la théorie des grands cycles et à la situation du monde actuel, demeure le duel du siècle entre les Etats-Unis et la Chine. Mais "quid" alors de la Russie et avec autant d'inquiétude de l’Europe ?
Les interrogations proposent à l'action les grandes options de demain, mais ne donnent que l'image approximative du possible et jamais la solution accomplie. Celle-ci appartient à l'imprévu, qui est l'enfant naturel du risque et l'appétit le plus cruel de l'aventure humaine.
Bruxelles le 8 Décembre 2022
19:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, hégémonisme, géopolitique, politique internationale, relations internationales, livre, irnerio seminatore, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 janvier 2023
Karl Marx et les crimes malthusiens des élites humanitaires
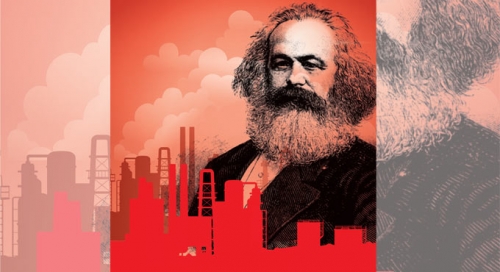
Karl Marx et les crimes malthusiens des élites humanitaires
Nicolas Bonnal
Jamais la volonté exterminatrice des élites de Davos ne s’est montrée plus enragée et avérée que cette année; jamais la volonté d’en finir avec les pauvres de l’Europe n’a été aussi étalée au grand jour. Et en même temps on n’a jamais été si humanitaire et si écologiste et si désireux de préserver sans rire le climat ou la planète fût-ce au détriment de sept milliards de personnes choisies pour leur étique compte en banque.
Dans une page essentielle du capital (chapitre sur l’accumulation primitive), Marx montre que l’élite féodale britannique – qui dirige toujours ce monde d’une manière ou d’une autre – a toujours été humanitaire et écologiste. Elle est humanitaire à distance c’est-à-dire qu’elle aime le lointain (enfin, certains lointains) et qu’elle hait son prochain.
Le socialiste Hobson parlera de l’inconséquence (inconsistency) des impérialistes occidentaux. En fait ils savent ce qu’ils font; mais comme Tartufe ils tablent sur l’hypocrisie humanitaire qui sert en général à éliminer quelques millions – bientôt quelques milliards de personnes – avec l’aide des journaux qui n’ont jamais été que la voix officielle (voyez ce qu’écrit Marx sur The Economist par exemple) des maîtres. Mais comme nous parlions des victimes sans valeur, nous pouvons parler des missions à valeur humanitaire ajoutée. Armer l’Ukraine jusqu’à la disparition (déjà presque réalisée) de ce pays, de la Russie et de l’Europe abrutie par la sous-culture industrielle de la féodalité anglo-saxonne (cf. mes textes sur Céline, Zweig, Hesse…) sera ainsi le résultat de cette mission à forte valeur ajoutée humanitaire.
 J’en reviens à Karl Marx qui parle de l’effarante duchesse de Sutherland qui est anti-esclavagiste :
J’en reviens à Karl Marx qui parle de l’effarante duchesse de Sutherland qui est anti-esclavagiste :
« Lorsque Mme Beecher Stowe, l'auteur de la Case de l'oncle Tom, fut reçue à Londres avec une véritable magnificence par l'actuelle duchesse de Sutherland, heureuse de cette occasion d'exhaler sa haine contre la République américaine et d'étaler son amour pour les esclaves noirs, - amour qu'elle savait prudemment suspendre plus tard, au temps de la guerre du Sud, quand tout cœur de noble battait en Angleterre pour les esclavagistes, je pris la liberté de raconter dans la New-York Tribune [Edition du 9 février 1853. Article intitulé : The Duchess of Sutherland and Slavery. (N. R.)] l'histoire des esclaves sutherlandais. »
Comme on l’a dit l’aristocratie féodale britannique aime bien dépeupler (car le dépeuplement est décoratif). Marx explique encore :
« George Ensor dit dans un livre publié en 1818 : les grands d'Écosse ont exproprié des familles comme ils feraient sarcler de mauvaises herbes; ils ont traité des villages et leurs habitants comme les Indiens ivres de vengeance traitent les bêtes féroces et leurs tanières. Un homme est vendu pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton et pour moins encore... Lors de l'invasion de la Chine septentrionale, le grand conseil des Mongols discuta s'il ne fallait pas extirper du pays tous les habitants et le convertir en un vaste pâturage. Nombre de landlords écossais ont mis ce dessein à exécution dans leur propre pays, contre leurs propres compatriotes. »
Et il revient à sa duchesse (pensez à Greta, Ursula, Angela, Jacinda, etc.) qui veut du pâturage :
« Mais à tout seigneur tout honneur. L'initiative la plus mongolique revient à la duchesse de Sutherland. Cette femme, dressée de bonne main, avait à peine pris les rênes de l'administration qu'elle résolut d'avoir recours aux grands moyens et de convertir en pâturage tout le comté, dont la population… »
On aime tous l’Ecosse des Highlands, beau désert pour touristes. Problème : on en a fait un désert (pensez aux incendies géo-ingéniérés d’Australie qui ont facilité la concentration d’esclaves urbains) :
« De 1814 à 1820, ces quinze mille individus, formant environ trois mille familles, furent systématiquement expulsés. Leurs villages furent détruits et brûlés, leurs champs convertis en pâturages. Des soldats anglais, commandés pour prêter main-forte, en vinrent aux prises avec les indigènes. Une vieille femme qui refusait d'abandonner sa hutte périt dans les flammes. C'est ainsi que la noble dame accapara 794.000 acres de terres qui appartenaient au clan de temps immémorial. »
 On envoie ensuite les survivants des Highlands au bord de la mer (pensez au légendaire film écossais Local Hero) :
On envoie ensuite les survivants des Highlands au bord de la mer (pensez au légendaire film écossais Local Hero) :
« Une partie des dépossédés fut absolument chassée; à l'autre on assigna environ 6.000 acres sur le bord de la mer, terres jusque-là incultes et n'ayant jamais rapporté un denier. Madame la duchesse poussa la grandeur d'âme jusqu'à les affermer, à une rente moyenne de 2 sh. 6 d. par acre, aux membres du clan qui avait depuis des siècles versé son sang au service des Sutherland. Le terrain ainsi conquis, elle le partagea en vingt-neuf grosses fermes à moutons, établissant sur chacune une seule famille composée presque toujours de valets de ferme anglais. En 1825, les quinze mille proscrits avaient déjà fait place à 131.000 moutons. Ceux qu'on avait jetés sur le rivage de la mer s'adonnèrent à la pêche et devinrent, d'après l'expression d'un écrivain anglais, de vrais amphibies, vivant à demi sur terre, à demi sur eau, mais avec tout cela, ne vivant qu'à moitié. »
Dans Local Hero la jolie fille a comme des oreilles de poisson…
En réalité la chasse a toujours servi à dépeupler et à martyriser non seulement les animaux mais surtout les humains (Taine en parle dans son Tome I des Origines: le paysan a moins de droits que le gibier du noble); et l’activité de Nemrod sert à développer l’éternel programme malthusien.
Marx :
« L'amateur à la recherche d'une chasse ne met, en général, d'autre limite à ses offres que la longueur de sa bourse... Les Highlands ont subi des souffrances tout aussi cruelles que celles dont la politique des rois normands a frappé l'Angleterre. Les bêtes fauves ont eu le champ de plus en plus libre, tandis que les hommes ont été refoulés dans un cercle de plus en plus étroit... Le peuple s'est vu ravir toutes ses libertés l'une après l'autre... Aux yeux des landlords, c'est un principe fixe, une nécessité agronomique que de purger le sol de ses indigènes, comme l'on extirpe arbres et broussailles dans les contrées sauvages de l'Amérique ou de l'Australie, et l'opération va son train tout tranquillement et régulièrement.»
Purger le sol de ses indigènes tel est le mot du jour. La purge est devenue systématique et écologique. On complètera Marx par une relecture (voir mon texte) du génial Polanyi et des destructions du monde traditionnel par le développement industriel de la culture moderne: fabriquer des abrutis prit du temps.
Sources:
https://traficantes.net/sites/default/files/Polanyi,_Karl...
https://inventin.lautre.net/livres/MARX-Le-Capital-Livre-...
http://www.dedefensa.org/article/polanyi-et-la-destructio...
http://files.libertyfund.org/files/127/0052_Bk.pdf
17:39 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, écosse, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



